19/04/2010
LE DOUAR D’IMERIGUENE (ERWAN BERGOT)
IMERIGUENE (KABYLIE)
Décembre 1957.
La quille viendra, les bleus resteront
Pour laver les gamelles...
Hurlant leur refrain, brandissant des quilles de bois sculpté avec un soin maniaque depuis plusieurs semaines, les libérables sont entassés dans le G.M.C. garé au milieu de la cour du poste, sous l'oeil mi-envieux, mi-amical de leurs camarades, plus jeunes, qui assurent la relève. À leurs pieds s'entassent leurs paquetages et cette valise en carton à laquelle ils se cramponnaient, voici déjà deux ans, au moment de leur incorporation. Ils sont gais, de cette gaieté un peu forcée née, de l'alcool et de la surexcitation, et qu'il faut entretenir vaille que vaille si on ne veut pas qu'elle s'estompe. Pour la plupart d'entre eux, au-delà de la légitime satisfaction d'en avoir enfin terminé avec ce service militaire, avec l'Algérie, avec le poste-même, se profile déjà l'inquiétude du lendemain, de la vie civile.
Alors, ils chantent, ils braillent, le visage congestionné, le calot en bataille, créant eux-mêmes la dynamique de ce tumulte.
À l'avant, encore accroché par la main à la portière du camion, le sergent Rozic adresse un salut au sous-lieutenant Keller. Voici près d'un an qu'ils vivent ensemble, perdus tous deux dans ce poste d'Imériguène, bâti à la sueur de leur front sur la petite croupe qui jouxte le village. Pendant une année entière, le poste a été leur fief, leur maison, leur refuge. Rozic en connaissait toutes les pierres, tous les recoins, tous les défauts aussi. Rien qu'à une certaine densité du vent il pouvait, de nuit et les yeux fermés, dire dans quelle partie de la cour il se trouvait.
Comme il l'a haï, certains soirs de cafard où la pluie désespérante crépitait sur les tuiles mal jointes ! Comme il l'a aimé aussi, au retour d'une patrouille épuisante lorsqu'il apparaissait, quadrilatère grisâtre, au détour de la piste !
– Ecrivez-moi, lui demande le sous-lieutenant Keller.
– Comptez sur moi, mon lieutenant. Je ne vous oublierai pas.
Le G.M.C. démarre, lentement, salué d'un formidable « hourrah ». Les quilles s'agitent au-dessus des têtes, les bleus présentent les armes, d'une manière comique, en prenant des poses provocantes, cachant mal leur jalousie.
Le porche est franchi. Avant d'aborder le premier virage de la piste boueuse qui plonge vers la route, en bas du village, Rozic fait arrêter le camion. Sur le bord du chemin, quatre silhouettes en blanc sont alignées, bâton à la main, burnous sur le dos. Ce matin, les autorités d'Imériguène ont sorti leurs habits de cérémonie.
Rozic descend en voltige, avance vers les quatre hommes, rangés par ordre d'importance, d'abord, Si Hadj Bouterfaya, le chef du village, sa barbe soigneusement peignée, son chèche de notable noué avec soin, puis Sefta, à la fois cadi et instituteur coranique, Bouazza, le garde champêtre et, sa médaille militaire agrafée avec du fil de fer sur sa gandoura effrangée, Hamzaoui, le président des Anciens Combattants du village. Ils saluent tous les quatre, en portant la main à leur front et Rozic leur rend la politesse. Derrière, dans le camion, les libérables se sont tus, pour un instant, peut-être impressionnés par la démarche des Kabyles.
- Puisse Allah vous accompagner tous durant votre voyage, dit Bouterfaya, la voix rauque.
- Puisse Allah maintenir sa protection sur Imériguène, répond Rozic.
- Pourquoi ti-t'en vas ? interroge brusquement Hamzaoui en attrapant le sergent par sa manche. Tu sais bien que la guerre continue...
S'il y a un reproche dans le propos, il est discret, il est fondé aussi, Rozic le sait bien. Au temps où le caporal Hamzaoui Boubakeur servait au 1er régiment de tirailleurs, on ne rentrait à la maison que lorsque la guerre était gagnée.
- D'autres soldats sont là, répond-il. Imériguène n'a rien à craindre.
Il s'éloigne, avec brusquement l'impression désagréable de fuir. Cette ultime démarche, qui, d'un seul coup, lui a fait mesurer l'étendue de son attachement à cette terre, a balayé sa joie du départ. Il se penche par la portière tandis que le G.M.C. s'éloigne, et grave dans ses yeux la dernière image qu'il désire emporter, quatre silhouettes blanches et immobiles, plaquées sur le fond ocre du village, avec, dérisoire contre la montagne, le petit poste où il a vécu un an de sa vie.
Puis, d'un seul coup, tout perd de sa signification émotionnelle. La montagne n'est plus qu'un tas de rochers sur lesquels s'acharne la pluie, le village reprend cette aura de crasse et d'abandon qu'il lui avait trouvée à son arrivée et le poste, même le poste, redevient une construction sans art et sans âme, une verrue de parpaings sur une colline qui a la pelade.
- Comment, mais comment ai-je pu vivre dans un endroit pareil, comme un clochard ou comme un naufragé ?
C'est alors seulement que Rozic comprend qu'il est parti. Une page est tournée.
Et voici Palestro ; la petite ville a bien changé en vingt mois, mais pas dans un sens favorable.
…
LA GUERRE DES APPELÉS EN ALGÉRIE
(1956-1962)
PRESSES DE LA CITÉ
Paris ; 1980
Chapitre XII
08:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook







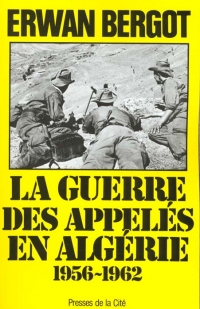
Les commentaires sont fermés.