10/06/2010
Un village au pied de la montagne des Flaï (Eugène VAYSSETTES)
… Nous arrivons au marabout de Sidi-Aïd, au pied de la montagne des Flaï*, chez lesquels, nous devons passer la nuit.
La montée est rude, nos bêtes ont peine à tenir pied, nous-mêmes sommes exténués de fatigue. Le soleil vient de disparaître à l’horizon, et les ombres de la nuit, dans ce pays sans crépuscule, envahissent déjà la plaine, quand, nous faisons notre entrée dans le village..

C’est jour de fête. On célèbre la rupture du grand jeûne et la joie est peinte sur tous les visages. À chaque pas que nous faisons dans ce dédale de ruelles tortueuses et mal pavées, nous sommes arrêtés par des groupes de Kabyles assis par terre et daignant à peine se déranger pour laisser passer nos montures. Les enfants seuls, attirés par notre costume d’étrangers, se mettent à notre suite, et nous suivent en ouvrant de grands yeux et nous interpellant par, cette apostrophe de ïa didou, synonyme de monsieur, que l’on retrouve dans la bouche de tous les indigènes.
Le caïd Rebiè, auquel nous sommes présentés, nous fait d’abord un accueil qui, par son peu d’empressements, semble témoigner du mince plaisir que lui cause notre présence. C’est qu’il a remarqué sans doute, à notre coiffure à larges bords et à notre prosaïque paletot, que nous ne sommes point des gens à épée, des gens à képi, et l’indigène, qui, instinctivement ou pour cause, professe le plus profond respect pour tout ce qui porte galons, n’a guère, au premier abord, que du dédain pour ce qu’il appelle la classe des mercanti, c’est-à-dire tous les civils. Cependant, après la lecture de la missive qui nous a été remise par le bureau arabe pour nous servir d’introduction auprès de lui, les traits du caïd se dérident, et, par ses ordres, nous sommes conduits dans la skifa (corridor, salle de réception) des hôtes.
C’est une pièce au rez-de-chaussée, ouvrant d’une part, sur la rue, et de l’autre, sur une cour destinée à recevoir les bêtes de somme. Deux doukkana ou tambours semblables à des lits de corps-de-garde en maçonnerie, élevés d’un mètre au-dessus du sol, occupent les deux côtés de la pièce. Sur celui de droite on étend une forte natte, que l’on recouvre, pour nous faire fête, de deux tellis (grands sacs pour renfermer les grains), en forme de tapis. Nous prenons place dessus, et, accroupis sur nos genoux ou étendus à la manière arabe, nous attendons la dhifa, ce repas de l’hospitalité.
En face, sur l’autre doukkana, sont rangées trois énormes kouafa (pluriel de koufi), sortes de jarres en terre cuite au soleil, de la contenance de quatre à cinq cents litres, et qui servent à renfermer les grains et les fruits secs, tels que figues, raisins , etc.
Pour nous désaltérer (on a toujours soif en voyage), on nous apporte, dans un pot fait de jonc goudronné, une sorte de liquide blanc et épais, dans lequel il y a autant à manger qu’à boire. C’est de l’ighi ou lait aigre. J’y mouille à peine mes lèvres et, pour me consoler, ne trouve rien de mieux à faire que de savourer à longs traits les bouffées de tabac qui s’échappent en spirales capricieuses de ma modeste pipe.
Pendant que je me livre à cette innocente jouissance, mon compagnon de route s’est étendu, je ne dirai pas mollement, mais le plus commodément qu’il lui a été possible, sur la dure natte qui doit nous servir à la fois et de table à manger et de couche. La fatigue a émoussé sa gaîté ordinaire; il dormirait déjà si ses sens ne venaient d’être soudainement mis en éveil par l’odeur de certains khefaf ou beignets auxquels notre appétit fait d’abord le plus grand honneur. Mais à l’huile qui ruisselle le long de nos doigts et de nos moustaches, à l’odeur forte et nauséabonde qui s’en exhale, nos estomacs soulevés ont peine à digérer cette pâte lourde et grasse, qui nous a été présentée comme un avant-goût du diner qui se prépare. Nous disons barka (c’est assez) ! au grand contentement, sans doute, des bouches qui nous entourent et qui ont, elles, le triste, je devrais dire en ce moment l’heureux privilège de n’avoir pas un palais aussi délicat que le nôtre. Aussi le tout disparaît-il en un clin d’oeil.
Afin de mettre les moments à profit, j’interroge l’un, je questionne l’autre, et, à la lueur d’une lampe fumeuse appendue au mur, voici ce que j’écris :
Le village des Flaï est divisé en deux fractions qui ne sont point cependant ennemies, mais qui ont chacune une origine différente. Il compte environ deux cents maisons dont quelques-unes ont un premier étage. Toutes sont recouvertes en tuiles. Les rues sont étroites et en pente. Çà et là on voit quelques espaces vides, que l’on est tenté de prendre pour des places, et où se tiennent les réunions populaires. Il y a une mosquée. Le chiffre de la population est de 300 zenad ou hommes capables de porter un fusil. Les Kabyles ne se comptent pas autrement : enfants, femmes et vieillards ne sont point compris dans ce nombre.
J’ai dit que c’était la fête au village. Aussi les visiteurs, qui ont ce jour-là fait trêve à leurs travaux habituels, se succèdent-ils, nombreux, dans notre modeste réduit, et quoique l’heure soit déjà avancée, la cité n’en retentit pas moins des cris joyeux des enfants, que mon compagnon se plaît à comparer aux coassements des grenouilles, lorsque, par une belle soirée d’été, elles jettent dans les airs leur couac si peu harmonieux.
Il est neuf heures et demie quand nous voyons arriver un énorme plat de couscoussou. À l’odeur rance qui s’en échappe, nous reconnaissons sans peine qu’il est encore à l’huile. Un instant nous hésitons ; mais bientôt, nous rappelant que ventre affamé n’a pas d’oreilles, nous nous écrions d’une voix commune : Il ne doit pas avoir non plus d’odorat. Et, forts de ce raisonnement, nous mettons de côté tous nos vieux préjugés et faisons honneur au dîner.
Lorsque nous sommes repus, n’ayant rien de mieux à faire, nous nous couchons. Nos paupières se voilent, un sommeil réparateur va enfin succéder aux émotions de la journée ; mais nous avions compté sans nos hôtes. Des puces, ou peut-être pire encore, je n’ose m’en assurer, s’abattent par milliers sur nos pauvres membres harassés de fatigue.
Nous en sommes dévorés. Quelle nuit ! quel supplice! Et pourtant, à côté de nous, au milieu de cette fourmilière d’insectes, des hommes, des enfants reposent en paix. Ce sont nos voisins de droite et de gauche, Kabyles au teint brun et à la peau insensible, dont rien ne saurait troubler le sommeil. Ils sont là, pêle-mêle, couchés sur la terre nue, ignorant même qu’ailleurs on puisse faire différemment.
Ô civilisation! que de besoins tu nous crées ; mais aussi que de bien-être tu nous procures !

Le jour commençait à, peine à poindre que nous étions déjà, on le concevra sans peine, prêts à enfourcher nos bidets. Il fallait aller rejoindre la route, que nous avions quittée la veille, pour atteindre le village des Flaï, et ici nous eûmes un premier échantillon de ce que nous devions plus tard voir en grand dans le pays des Zouaoua ; je veux parler de la difficulté des chemins. Je ne saurais autrement l’exprimer que par cette locution banale, mais qui ici est vraie en tout point : il faut y aller voir pour le croire. En effet, les pentes sont tellement escarpées et les sentiers si hérissés de pierres, de crevasses, d’obstacles de tout genre, qu’il faut avoir une confiance aveugle dans la sûreté du pied de sa monture, pour oser, à cheval, affronter de pareils dangers. Je ne crois pas qu’en France il existe de chemin de traverse, quelque raboteux, quelque difficile qu’il soit, qui puisse leur être comparé.
* rapprochement avec le village d’EL FLAYE ?
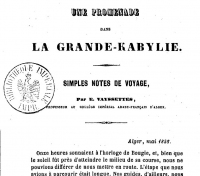 Eugène VAYSSETTES
Eugène VAYSSETTES
Une promenade dans la Grande-Kabylie,
simples notes de voyages
Rodez, Imprimerie de CARRERE aîné.1858
Pages 3 à 6
07:53 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook
Facebook







Commentaires
un grand merci pour ces bons bons souvenirs
Écrit par : tadjadit | 10/06/2010
merci
Écrit par : ahcene | 28/10/2011
Les commentaires sont fermés.