26/03/2015
Sous le burnous (France HECTOR) extrait
LA NOCE DE LA PETITE ZAIRAH
Depuis six mois, chaque vendredi, je la voyais arriver, trottinant derrière la mule de son père, parfois seule, mais le plus souvent une vieille à ses côtés. Elle était tous petite -douze ans à peine- mais si frêle et si mignonne qu’elle en paraissait deux de moins.
Enfant de la vieillesse de Baba Aaroun, sa mère à quatorze ans était morte en couches ; aussi le vieillard la chérissait bien qu’elle ne fût qu’une fille, et lorsqu’elle sentait plier ses jambes ou que ses pieds se meurtrissaient aux pierres du chemin, il la prenait devant lui sur le barda de sa mule, comme il eut fait d’un fils. Mais il la déposait doucement à terre avant d’entrer à Djigelly.
C’est alors que nous la voyions passer, insoucieuse et gaie fillette, devant le bordj des Spahis.
Mais bientôt, comme les sœurs dont parle le Lévitique, elle grandit tout à coup. Sa taille se forma ; ses flancs se dessinèrent ; d’harmonieux et doux globes soulevèrent sa gandoura de coton ; le bouton se faisait fleur. Et timide et rougissante devint la fillette, et en même temps si jolie que, pendant des semaines, Arabes et Berbères venaient s’asseoir, devant la porte au coin du bastion, à l’heure où le marché s’ouvre pour voir passer cette merveille des Ouled-Aïdoun.
Et ils allaient rôder autour de l’étalage de Baba Aaroun, lui achetant des pastèques et des figues pour admirer de près la blonde Kabyle qui reflétait dans ses grands yeux étonnés toutes les nuances de la mer et du ciel.
Il savait bien ce qu’il faisait, le vieux Aaroun ; il savait qu’accompagné de sa fille, la double charge des fruits de son jardin disparaissait comme si un djin bienveillant l’eut touché de son pouce mettant à leur place des poignées de sordis, car il avait pour clients tous les Saphis, tous les Turkos et les Mokalis et tous les jeunes Maures de la ville.
Ses voisins riaient de lui, mais que lui importait. Il savait aussi que, sous son œil, la pucelle resterait intacte bien plus sûrement que s’il la laissait au gourbi, confiée à la surveillance distraite de ses belles-mères ou de ses grandes sœurs.
Autant que les vieillards des villes sont avides du fruit vert, les jouvenceaux de la montagne sont habiles à saisir la proie guettée.
Et tous la convoitaient, tandis qu’elle, embarrassée et honteuse, et comprenant déjà, se sentant brûlée par ces flammes ardées sur elle, cachait en rougissant son visage derrière un coin de son haïk.
Entre tous ces admirateurs, se rencontrait le Chaouch Ali-ben-Saïd.
Malgré quarante ans sonnés au cadran de sa vie, il passait pour un des beaux cavaliers de la ville et un des plus rudes champions près des femmes, ce qui, joint à une conformité toute spéciale l’avait fait surnommer Bou-Zeb , nom difficile à traduire en français.
Bref, il possédait les qualités qu’au temps du prophète Ezéchiel, Oolla et Oolibella, soeurs bibliques et vierges folles, exigeaient de leurs amants.
Coquet et beau parleur, il se distinguait par le luxe de son turban brodé de soie jaune, son gilet chamarré d’or et l’éclatante blancheur de son burnous ; aussi Mauresques et Kabyles lui clignaient de l’œil, et les femmes des Mercantis même, avouaient que pour un Indigène, il n’était pas trop mal tourné, c’est-à-dire qu’elles le trouvaient charmant.
Il parlait, du reste, le français avec facilité, buvait de l’absinthe et du vin, et généralement tout ce qu'on voulait bien lui offrir, portait des chaussettes, se mouchait dans un foulard, fuyait la vermine et s'abstenait du Ramadhan.
Il avait quelque argent et aurait pu vivre sans rien faire en ce pays où un douro quotidien constitue un large patrimoine mais désireux de briller en ce monde et sachant que les femmes n'aiment rien tant que les glorieux, il s'était mis au service du Bureau arabe et portait avec orgueil, aux jours de solennité, le burnous bleu de Chaouch.
…
France HECTOR
Éditions G. Charpentier
Paris 1886
Pages 151 à 155
06:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook







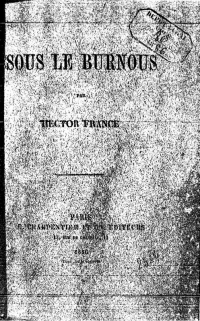
Les commentaires sont fermés.