30/07/2008
Étude sur la domination romaine en Kabylie (Henri AUCAPITAINE)
Excepté le Syda municipium , l’histoire ne mentionne aucun établissement ou tentative d'établissement dans l'âpre région des Jubalènes, ancêtres directs des modernes Igaououen.
J'ai été assez heureux pour signaler à l'attention des archéologues [1] quelques ruines découvertes sur les âpres et difficiles versants des Aïth Iraten. De nouvelles recherches m'ont mis à même de corroborer l’opinion que je n'avais pu d'abord émettre qu'avec doute, savoir que des ruines romaines, parfaitement caractérisées, existent sur les contre-forts des Irdjen [2] et prouvent qu'il y a eu au moins des essais de domination permanente à mi-côte de ces montagnes.
Il existe au bord de la rivière qui sépare les Aïth-Aïssi des Aït-Iraten, et proche le Souk El-A’dni de cette dernière tribu, un mamelon appelé Taks'bet (forme berbère et diminutive du mot arabe kasba : citadelle) ; l'explorateur est toujours certain de glaner quelque intéressant renseignement dans les nombreuses localités qui, en Kabylie, portent ce nom. C'est là que j’ai observé les vestiges du premier poste de la ligne de circonvallation destinée alternativement à bloquer ou à protéger les Jubalènes dont les Raten actuels sont les descendants.
J'ai décrit les vestiges du burgus établi sur un des premiers contre-forts de la montagne, au-dessus du village d'lril-G’ifri à l’intersection du chemin de Thala-Amara et du marché du Mardi ; l’assiette stratégique de ces ruines et leur construction dénotent parfaitement leur destination.
En relisant l'ouvrage si remarquable du capitaine Carette, j'ai été amené à reconnaitre à environ 8 kilomètres d'lril-G’ifri, au centre du hameau d'Agouni ou Djilbân [3] , une ruine assez remarquable. Ces débris présentent environ 20 mètres de longueur sur 7 de large; 3 mètres d'une enceinte massive, construite en fortes pierres s'élèvent encore au-dessus de terre et donnent une idée de ce poste militaire, composé de deux réduits contigus. La porte, comme dans nos blokhaus, devait être élevée au-dessus du sol. On est tout d'abord frappé à la vue de ces ruines par la grosseur des pierres de taille, l'épaisseur des murailles et la solidité du ciment, caractères évidents de constructions militaires.
À 8 kilomètres d'Agouni ou Djilbân sur l’emplacement du marché du Tléta (Mardi) un peu au-dessous du village de Tacheraït, se trouvent quelques pierres taillées, coupées de mortaises, et les affleurements d’une muraille épaisse appartenant à un fortin correspondant aux précédents. Une tradition locale vient appuyer cette présomption : les Kabyles attribuent aux Djouh’ala (idolâtres) l’érection d'une fontaine sise en contrebas du marché, fontaine d’architecture toute berbère, mais dont les matériaux sont de ces pierres de grand appareil qui, en tout pays, caractérisent les édifices romains.
De plus les indigènes racontent qu'à la suite d'une grande bataille, les idolâtres furent tous exterminés et enterrés sous les ruines ! … À défaut de faits précis que recherche une saine critique, contentons-nous donc de cette légende, peut-être récit défiguré d'un dramatique épisode des luttes de l'indépendance berbère.
Ainsi quatre postes fortifiés, placés sur une même ligne, à des distances à peu près égales, pouvant défendre ou faciliter 1'accès des montagnes, garantissaient la sécurité de la route du Syda municipium qui n’est plus éloigné que de 4 kilomètres et séparé d'ailleurs du Ratin par l'Assif-Talerlour (assif : rivière).
Mes recherches dernières confirment donc 1'hypothèse émise dans la Revue archéologique, lorsque je supposais qu'un réseau de burgi analogue au burgus dont on voit les traces sur les frontières du Limes ausiensis, s’étendait jusqu'à Syda.
Baron Henri AUCAPITAINE
Étude sur la domination romaine en Kabylie,
Fort-Napoléon Février 1860
Bulletin de la Société de Géographie
Pages 240 à 242
[1] Ruines romaines chez les Beni-Raten (Kabyles) (Revue archéologique, n° d’avril 1859 p. 25 à 29)
09:14 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook
Facebook
22/07/2008
Une mission médicale en Kabylie (Dr L. LECLERC)
Service médical des Indigènes (Leclerc-L)
pages 123-4
Quand, après l'expédition de 1857, le maréchal Randon nous fit l’honneur de nous désigner pour le service médical des indigènes à Fort-Napoléon, ce fut dans l'espoir que notre ministère pourrait avoir quelques heureuses influences sur des populations jusqu'alors indomptées et récemment conquises.
À notre arrivée, on travaillait à la construction du Fort. Nous nous installâmes sous la tente et fîmes des bons de médicaments ; nous y restâmes jusqu'en décembre. Nos moyens étaient alors restreints : certains sujets durent être envoyés à l'ambulance. On nous y réserva plus tard une salle ou des tentes.
Les malades ne tardèrent pas à devenir nombreux. Pendant les trois derniers mois de 1859, ils dépassèrent le chiffre de 1500. Tel jour nous en donna 50.
Dès le 23 septembre, nous les inscrivîmes avec les renseignements nécessaires, pour suivre la marche de la maladie et du traitement. L’interrogatoire était difficile et long ; les trois quarts de nos malades ne parlant pas arabe, et nos interprètes étant d'une insuffisance désespérante.
Les Kabyles, comme les Arabes, ont aussi l’indolence et la résignation musulmanes. Ils aiment les traitements courts. Quelques-uns avaient une ou deux journées de marche pour arriver jusqu'à nous. Parfois ils ne revenaient plus après une première visite ; souvent ils nous apportaient des affections très graves, difficiles ou même incurables avec des moyens plus étendus que les nôtres. Les moyens durent être longtemps ceux d'une ambulance de campagne ; or notre service comportait bien d'autres exigences. Nous n'avons pas moins consigné tous les cas.
On comprendra facilement, dès lors, comment nos observations seront souvent courtes ou incomplètes. D'une part, le temps nous pressait car outre les indigènes, nous avions les civils plus l’hôpital pendant l'été. D'autre part, nous ne pouvions suivre tous les malades jusqu'à la fin.
Nous avons cru cependant devoir rédiger ce compte-rendu qui repose sur deux notes recueillies scrupuleusement, jour après jour. Le chiffre de nos malades s’élève à 5394. Notre statistique peut donc être considérée comme l'expression à peu près exacte de la pathologie d'une contrée jusqu'alors inexplorée : elle pourra fournir quelques renseignements utiles tant à l'administration qu'aux médecins chargés du service d'une population intéressante et bonne, qui mérite les sacrifices faits pour elle, et qui n'a pas cessé d'être présente à notre mémoire.
Nous avons essayé de faire plus pour deux affections : la syphilis et la fièvre intermittente, qui représentent à elles deux la moitié de nos clients. …
Docteur L. Leclerc
Médecin-Major
Une mission médicale en Kabylie
PARIS 1864
Chez J-B Baillière
09:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
15/07/2008
Promenades en temps de guerre chez les Kabyles (Félix HUN)
Je laisse à droite, à distance, l’emplacement couvert de ruines, de la ville romaine, supposée être ou plutôt avoir été Rusucurum. Il se termine en promontoire dans la mer ; à la pointe est une petite île. Il parait qu’une petite jetée la reliait à la ville et formait ainsi le port. Si ce point, qui, je crois, a été découvert par M. J. Barbier, est, comme il le prétend, à l'abri des vents, je suis étonné qu'on n’en ait pas fait un petit port de commerce pour les villages populeux des environs et de relâche pour le cabotage pendant les gros temps, Dellys étant dans ces circonstances, inabordable. Je crois qu'il n'en coûterait pas grand'chose. Rien n'échappait aux Romains.
Après environ trois heures de traversée de cap en cap, en ligne directe, droite, comme la corde d'un arc tendu, je double, c'est-à-dire mon bateau double une montagne qui s'avance dans la mer, et vient aborder au fond d'une petite crique; c'est celle de mon marabout.
Tout près de l'endroit où je débarque, sur le haut du rivage escarpé, voici le marabout de sidi Khaled. C'est une petite maison, de forme carrée, un peu plus longue que large, sans étage, couverte d'un toit, à deux pentes, en tuiles, semblables aux nôtres. Sa porte n'est pas fermée à clé; chacun peut entrer la nuit, le jour, et s'y reposer. On y trouve une cruche, pour boire, quelques ustensiles en terre cuite et des tapis de sparterie, le tout au service de tous. À l'extérieur contre le mur, du côté de la terre, est un arbre, aussi marabout, chargé de chiffons d'étoffe accrochés à ses branches en ex-voto et offrandes. Ce marabout a une spécialité, au dire de M. J. Barbier, qui le tiendrait des Kabyles, a une spécialité fort utile et curieuse, surtout pour un criminologue, et que lui envierait même le plus fin juge d'instruction. Les Maures de Dellys viennent en bateau apporter du sel, pour approvisionner les populations voisines. Ils déposent dans le marabout une mesure remplie et une mesure vide et s’en vont à la pêche ou partent pour Dellys. Les Kabyles descendent de leurs villages, voient la marchandise, et, si le taux leur convient, prennent le sel, mais laissent à sa place l’équivalent en blé ou en orge, équivalent indiqué par la mesure vide. Or, la plus grande bonne foi, la plus grande loyauté président à ces marchés muets. C'est qu'aussi sidi Khaled, quoique mort depuis un temps immémorial, ou plutôt son esprit, veille sans cesse à ce qu'il en soit ainsi, punit même très sévèrement le vol, la fraude ou la mauvaise foi.
Ainsi, un jour, certain Kabyle, sans foi ni loi, incrédule en son marabout, ou espérant qu’il n’en serait pas vu s'en vint, par un épais brouillard, prendre furtivement et frauduleusement une grosse pierre de sel, puis s'en fut la cachant sous son burnous et la pressant contre son sein, afin que personne ne s'aperçut de rien. Mais ne voilà-t-il pas qu'en toute hâte chez lui arrivé et rentré, voulant se décharger et mettre chose en sûreté, le sel diabolique dans les côtes lui était entré, et si bien, si bien entré, que le malheureux le lendemain fut trouvé, au sel passé et trépassé, sans avoir pu, malgré cela, se conserver.
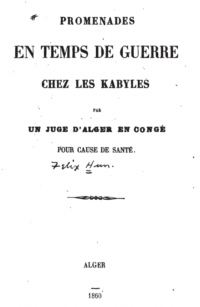 Un juge d’Alger
Un juge d’Alger
(Félix HUN)
Promenades en temps de guerre chez les Kabyles
Alger 1860
Les livres attribués à Félix HUN furent publiés avec la mention :
UN JUGE D'ALGER EN CONGE
POUR CAUSE DE SANTE
07:13 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
07/07/2008
Le voyage de Mohand (Ali MEBTOUCHE)
Dès qu'il eut l'âge de comprendre, Mohand fut obsédé par l'idée de quitter un jour son village natal pour émigrer dans le pays de ses rêves : la France. Après avoir assisté, du début jusqu'à la fin, à la guerre d'indépendance de l'Algérie, Mohand avait atteint l'âge de s'exiler, comme tant de jeunes de son âge, et de partir à la recherche du paradis que les anciens émigrés, après des années passées en France, leur faisaient miroiter.
Pour se rendre en France, Mohand avait dû supplier son père pendant plus d'une année…
Enfin, tous ses papiers étaient prêts: carte d'identité, autorisation de sortie du territoire, certificat d'hébergement, que son oncle Da Lounès, le frère de son père, lui avait envoyé de France, où lui-même travaillait dans la ville de Bitche, en Moselle… Avec tous ces papiers, Mohand acheta son billet, par bateau, aller et retour payé.
Enfin, il allait sortir de ce village où il était enfermé depuis sa venue au monde. Il était impatient d'aller voir ce monde extérieur dont il avait souvent entendu parler par les émigrés, lorsqu'ils revenaient au pays, après avoir séjourné et travaillé comme marchands de tapis dans différentes villes françaises, dont les noms enchantaient ses oreilles : Paris, Marseille, mais surtout des villes situées en Alsace-Lorraine, où la majorité de gens de son village, dont son père et son oncle Da Lounès, avaient séjourné durant les années cinquante et soixante.
Pour voyager en France, Mohand devait partir avec son oncle, le frère de sa mère. Ce dernier avait promis à ses parents de s'occuper de lui et de lui trouver un travail à la gare de tri S.N.C.F. de Lyon-Perrache, là où lui-même travaillait comme conducteur d'un chariot-élévateur.
Patiemment, dès le lendemain de l'indépendance de l'Algérie, en l'année mille neuf cent soixante-deux, alors que son village commençait à se vider de tous les enfants de son âge, Mohand avait attendu ce jour du vingt-sept septembre mille neuf cent soixante-quatre.
Ce matin-là, sa mère s'arrachait les cheveux en lui disant:
" Mohand, tu n'as pas fait changer les deux cents francs que tu dois emporter avec toi ! "
Pour passer la douane algérienne et la douane française, un émigré comme Mohand, qui n'avait jamais travaillé en France, devait faire semblant de venir en touriste. Une fois en France, on pouvait s'installer et travailler, mais c'était à ses risques et périls, car beaucoup d'émigrés étaient refoulés à la frontière, certains à Alger même, d'autres par les autorités françaises, à la descente de l'avion ou du bateau.
Cependant, certains avaient la chance de traverser la frontière et pouvaient chercher du travail en France. Pour cela, il fallait payer son billet de bateau ou d'avion en aller-retour et emporter avec soi la somme de deux cents francs français qui prouvait aux autorités françaises que l'on avait de quoi se nourrir pendant son séjour en France. Dans la précipitation, mais surtout par ignorance, Mohand n'avait pas fait changer les deux cents dinars contre les deux cents francs français.
Il fallait impérativement que la mention " deux cents francs français " apparaisse sur son billet de bateau, avec une signature et un tampon : " Banque Centrale d'Algérie ", banque où il devait se présenter en personne pour faire l'échange. La Banque Centrale d'Algérie ouvrait ses portes à huit heures trente… Il ne restait plus à Mohand qu'une petite matinée pour changer son argent.
Le lendemain, un samedi matin, Mohand se leva à cinq heures. Il n'avait plus que quelques heures de chance devant lui pour se rendre en ville à bord d'un véhicule. Pour aller à Tizi-Ouzou, ville située à douze kilomètres de là, il attendit avec beaucoup de persévérance, sur la route qui passait au-dessus de son village, qu'arrive " un fraudeur ". Un " fraudeur " est un travailleur émigré qui a eu l'opportunité de ramener une voiture de France et qui, sans autorisation légale, transporte des personnes pour la somme de dix dinars aller-retour. " Les fraudeurs " étaient très rares dans le village de Mohand, comme dans la plupart des villages kabyles. À sept heures, Mohand entendit le moteur du seul camion de son village se mettre en route. Quand le camion arriva près de lui, Mohand lui fit signe de s'arrêter, puis il monta et s'installa à côté du chauffeur.
Comme il n'y avait pas d'autre moyen de transport, le propriétaire du camion convoyait aussi bien de la marchandise que des personnes. Des bancs étaient installés à l'arrière pour permettre de s'asseoir ...
Mohand, avait hâte d'arriver à Tizi-Ouzou, … mais le camion s'arrêtait dans tous les villages pour ramasser des gens qui se rendaient au souk de Tizi-Ouzou.
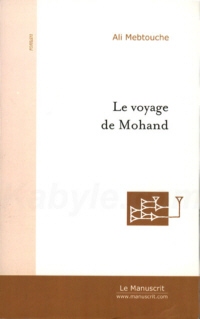 Ali MEBTOUCHE
Ali MEBTOUCHE
Le voyage de Mohand
Autobiographie
Éditions Le Manuscrit,
Paris, 2004
07:13 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook
Facebook







