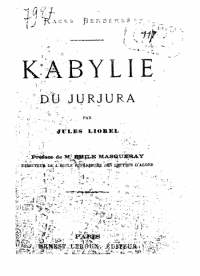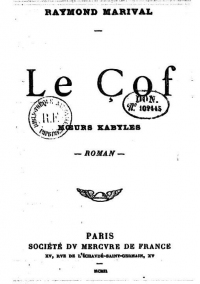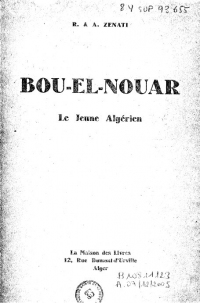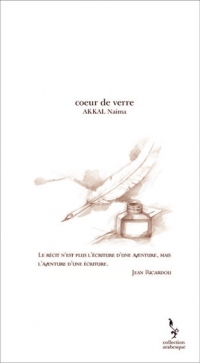31/07/2011
L’Avenir de la Kabylie (Jules LIOREL) 1
L'AVENIR DE LA KABYLIE
DIXIÈME ET DERNIER LIVRE
…
Il faut donc, des écoles et des écoles très nombreuses en Kabylie ; mais quelles écoles? Des écoles neutres, c’est-à-dire celles qui ménagent les croyances des parents. Auprès du maître français, il faut le taleb, le lettré musulman, chargé d'enseigner aux élèves le Coran. Mais c'est encourager, dira-t-on, le fanatisme dont nous avons en déjà tant à nous plaindre ? Tout d’abord il est impossible de songer à faire de l’anticléricalisme en Algérie; ceux qui le voudraient tenter ne prouveraient qu'une chose, leur ignorance profonde du caractère musulman. Ce qu'il faudrait, c'est que le taleb arabe qui aujourd'hui enseigne, tout à fait en dehors de notre influence, le Coran, la grammaire arabe, le droit de Sidi Khelil, soit remplacé par un taleb d'origine berbère, payé par nous, qui par suite de sa situation, ne choisirait pas exclusivement les passages du Coran, les plus violents contre les « Roumis » pour les faire apprendre par cœur à ses élèves. « Nous aurions ainsi un enseignement du Coran, expurgé à l'usage de nos sujets musulmans d'Algérie. Et qu'on ne me dise pas que cela est impossible. On trouve tout ce qu'on veut dans le Coran, comme dans tous les livres sacrés de toutes les religions. Pour ne citer qu'un seul exemple, à côté d'appels brûlants à la destruction des mécréants, on rencontre des passages où les hommes des écritures, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, sont distingués avec soin des infidèles. On voit par ce seul fait, quel parti un homme intelligent et surveillé, peut tirer du choix habile des versets qu'il fera réciter à ses élèves » (Caix de Saint-Aymour). Ce serait, qu'on nous permette de le dire, un clergé national qui éliminerait peu à peu l'élément fanatique, les marabouts arabes. Mais l'école sans le taleb, l'enseignement français sans l'enseignement religieux, n'ont aucune chance de succès. Il y a là une question de préjugés sociaux qui forment une barrière infranchissable. Et que nos libres-penseurs français ne s'en étonnent pas outre mesure ; ils sont eux-mêmes soumis à ces préjugés dont ils voudraient voir se dépouiller les autres. Combien de ceux qui se disent libres-penseurs dans le monde « comme il faut » recevraient chez eux des couples non mariés à l'église? Cette réflexion de M. de Caix de Saint-Aymour n'établit-elle pas, ainsi qu'il le dit lui-même la preuve « que la logique de la conscience intime n'a rien à voir avec l'intransigeance de traditions séculaires. Il faut, en matière de mœurs, bonnes ou mauvaises, beaucoup de temps pour détruire ce que le temps a consacré ».
…
Races berbères
Kabylie du Jurjura
Imprimerie E. JAMIN
Laval 1892
08:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
23/07/2011
Le çof (Raymond MARIVAL)
La veille, en effet, quelques misérables mourant de faim étaient venus protester sous les arbres du jardin de M. Soubiron. Embauchés pour l'empierrement des routes, ces ouvriers attendaient depuis trois jours, sans pain et sans abri, que M. Castaréde, payeur principal, voulût bien verser entre leurs mains les salaires en retard. Et tous les mois la même scène pitoyable se renouvelait. Sous les plus futiles prétextes, M. Castarède, qui vivait au chef-lieu d'arrondissement une existence retirée de fesse-mathieu, retardait son voyage à Gravelotte*, tergiversant parfois durant une semaine avant de se résoudre à l'accomplir. Il était d’une ladrerie sordide. Lorsqu'il maniait des fonds, on aurait cru, à voir ses mains tremblantes, que chacun des écus sortait de sa propre bourse, et que, pour les gagner, il avait dû peiner de longs et douloureux efforts ! On ne savait plus alors quel était le plus triste et la plus lamentable, de celui qui remuait l'argent, ou du manœuvre minable qui attendait, la main ouverte et le ventre creux !
La plupart des colons de la vallée se montraient incapables d'une telle bassesse d'âme. Beaucoup même, parmi eux, conscients des services rendus, témoignaient, dans les rapports avec leurs khammès, sinon de bienveillance, tout au moins d'une louable équité. Tous cependant, et ceux-là même dont l'intelligence paraissait la plus ouverte, conservaient pour l'indigène une répulsion involontaire et irréfléchie.
C'est que le peuple kabyle est le peuple vaincu qui, par droit de conquête, demeure taillable et corvéable à merci ! Dans l'esprit simple et sans lecture du colon, persiste toujours l'instinct des races pillardes. Sur aucun d'eux n'a soufflé le vent humanitaire qui passe ! Tous ignorent qu'il n'y a plus aujourd'hui de peuples déchus, mais que les races, parallèlement, suivant les lois qui les régissent, doivent évoluer la main dans la main. Un jour viendra où ils comprendront, et c'est alors seulement qu'on verra s'épanouir cette floraison d'énergie et de travail qui, pour féconder la terre algérienne, ne demande plus qu'à être dirigée !
Ces temps peut-être ne sont pas lointains. La vie matérielle de l’indigène, encore que précaire, s'est beaucoup améliorée. Ils apprécient nos voies de communication, nos marchés et nos écoles; ils savent gré des efforts accomplis; pour que l'entente nécessaire à nos intérêts mutuels s'exécute, il suffirait sans doute de faire preuve, à leur égard, d'un peu plus de sympathie.
Le malheur est que, pour cela, la collaboration est indispensable de tous les fonctionnaires musulmans, et que jusqu'ici le recrutement de ces derniers a toujours été déplorable.
Cadis, cheiks, kebirs ou mezouars, de plus petit jusqu'au plus grand, presque tous abusent des fonctions qui leur furent départies pour pressurer leurs coreligionnaires et s'assurer des provendes. Accablés sous les impôts, en butte aux vexations sans nombre, les fellahs avec répugnance sentent peser sur eux cette autorité qu'ils n'estiment plus. C'est la lèpre qui ronge les douars et dont André, sous ses yeux, avait des exemples frappants : cadis concussionnaires, cheiks vivant d'exactions et de rapines, oukils rapaces, aouns disposés aux besognes louches, tous gorgés de vols, engraissés d'abus et d'arbitraire, grouillant sur le peuple minable comme une vermine dans une toison !
(Pseudo de Louis VAISSIÉ)
Le çof
Mœurs kabyles
Éditions Mercure de France
1902
Pages 96-99
* Gravelotte : village au nord-ouest de Constantine (Chebligui-Makhlouf ?)
07:48 | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook
Facebook
14/07/2011
Bou-El-Nouar et l’école (ZENATI Rabah et Akli)
Chapitre IV
I
Si Tayeb, le taleb, ne niait pas l'esprit curieux de Bou-El-Nouar. C'était le trait essentiel de l'intelligence de l'enfant. Le maître du Koutab fut vite frappé de cette particularité malgré son manque d'intuition, son peu d'élan vers les nouveautés, son attachement têtu aux vieilles connaissances orthodoxes de son enseignement. Les élèves réduits au rôle d'appareils enregistreurs ne trouvaient un sens à tout ce dont on meublait leur mémoire que très longtemps après leur sortie de l'école coranique et encore quand ils n'avaient pas interrompu leurs études.
Bou-El-Nouar étonnait son maître par ses spirituelles réparties, par les questions aussi judicieusement posées que celle-ci :
" Que signifie ce que je viens de réciter ? Pourquoi n’avons-nous pas des livres comme à l'école française ? Pourquoi les petits Français comprennent-ils ce qu'ils apprennent et nous rien ? "
C'étaient des dispositions étrangères à des bambins de son âge, habitués à un travail de mémoire souvent en défaut devant l’aridité des textes. Aussi le fils Boudiaf inquiétait-il un peu le taleb toujours impressionné par les réponses surprenantes de son élève. Il disait souvent que Bou-El-Nouar n'était pas un élève comme les autres ; non seulement il apprenait très vite mais il raisonnait surtout pomme une grande personne.
Depuis quelques jours il tombait, lorsqu'il rentrait à la maison, dans un silence marqué d'une certaine nervosité contraire à son tempérament. Après le souper, dans la salle commune il s'approchait de son père comme s'il voulait lui dire quelque chose, s'en éloignait, puis renouvelait ce manège plusieurs fois avant d'aller se coucher. Boudiaf ne s'apercevait de rien, mais sa mère, mise en éveil par ce va-et-vient insolite, le suivait avec attention. Son instinct l'avertissait que son fils était en proie à un trouble dont elle ne percevait pas exactement la cause. Un soir Bou-El-Nouar n'y tint plus. Après avoir touché à peine aux aliments, très ému et presque tremblant, il dit brusquement â son père :
— Je voudrais te dire quelque chose, mais promets-moi de ne pas me gronder.
— Dis toujours, nous verrons après, répondit Boudiaf.
— Je crains que tu ne me refuses ce que je désire.
— Si tu me laisses dans l'ignorance de ce que tu veux de moi, je ne risque pas de te donner satisfaction !
— Je ne sais ce qu'il a, intervint Fatma. Depuis quelques jours, je le vois tourner, virer, s'énerver sans motifs apparents. J'ai failli t'en prévenir.
— Parle donc, reprit le père.
— Je ne peux pas, les mots ne viennent pas.
— Alors va te coucher.
Bou-El-Nouar se disposait à sortir quand sa mère le retint par le bras. Elle l'encouragea à parler. Il hésita encore, pétrissant d'une main inquiète sa gorge serrée par l'émotion. Les caresses de Fatma, eurent raison de sa frayeur. Il finit par lâcher dans un souffle :
— Je voudrais aller à l'école française, comme le fils du Cadi.
— Mais, qui t'a encore mis ces idées en tête petit malheureux ? s'emporta Boudiaf. Je parie que c'est encore le Cadi, à moins que ce ne soit son fils aîné. Ce Cadi de malheur ne veut donc pas me laisser tranquille.
— Je le jure par Sidi El Hadj M'Barek, père, que je n'ai été poussé par personne.
— Comment ? tu vas me soutenir que tu as trouvé cela tout seul.
— Je voudrais faire comme les fils du Cadi et comme les fils de tous tes amis du village qui quittent la koutab à huit heures du matin pour se rendre à l'école française. Ils ont des cartables remplis de beaux livres. Ils écrivent sans qu’il soit besoin de leur tenir la main et comprennent ce qu'ils récitent.
— Tu n'as pas besoin de te farcir l'esprit et l'imagination avec toutes ces billevesées. Que tu saches faire convenablement la prière et que tu cultives bien tes champs, c'est ce qui m'importe le plus. Cela suffira d'ailleurs très largement.
— Les fils du Cadi et les autres jouent et parlent avec les petits Français.
— Tu n'as rien à faire avec ces gens là.
— Et pourquoi causes-tu toujours aux colons, toi ? Je voudrais leur parler en français comme le Cadi, et non en arabe comme tu le fais.
Boudiaf sous l'effet de ce qu'il considérait comme une insulte, faillit donner libre cours à la colère qui montait en lui. Il réussit à maîtriser son courroux, mais envoya son fils à tous les diables.
II
Boudiaf n'était guère préparé aux nouvelles perspectives dévoilées par son fils. Il croyait perpétuer les anciennes traditions de sa famille en ne livrant rien au hasard, en se méfiant de toutes les nouveautés, considérant comme hautement respectable tout ce qu'avaient accompli ses ancêtres. Il aimait souvent à répéter comme un principe immuable cette phrase qui, pour lui, résumait toute la vie :
"Les anciens ont tout dit, tout fait, tout prévu. Ce serait une vanité malsaine que de déranger l'ordre établi depuis des siècles, de renoncer aux vieilles coutumes pour des habitudes excentriques dont l'utilité reste à démontrer et qui, par dessus tout, ne sont pas les nôtres, Profitons plutôt de l'enseignement que nous ont laissé ceux qui nous ont précédés et demeurons dans la voie que nous a si bien tracée le dernier des Prophètes."
Bou-El-Nouar
La Maison des Livres ; Alger
1945
07:51 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook
Facebook
11/07/2011
OUALI et l’Amin CHALLAL (Ali MEBTOUCHE)
Si Ouali avait déjà une bonne réputation auprès de son entourage, sa renommée s'accrut encore après cet exploit : il avait su abattre à lui seul cinq bêtes fauves qui, depuis des années, faisaient des ravages parmi le bétail de cette contrée ! La nouvelle se répandit partout et arriva même jusqu'aux oreilles du caïd de la commune, et surtout à celles de l'amin du village voisin nommé Ifuzar, chargé par l'administration de traiter les affaires courantes indigènes. Ce dernier, un indigène du nom de Challal, était très connu pour les méthodes barbares qu'il exerçait sur les plus démunis, pour les faire travailler dans les champs de ses maîtres colonialistes. Il payait ses ouvriers au rabais, sans éprouver aucune pitié, leur faisant moissonner d'immenses champs de céréales. Quand ils fauchaient le blé, l'orge ou le maïs, à l'aide de leurs faucilles, gare à celui qui n'arrivait pas à suivre les cadences : le « chien de garde» des colons était derrière les moissonneurs, une cravache à la main, pour infliger des sévices corporels aux plus lents. Tous les paysans qui étaient obligés de travailler sous ses ordres pour subvenir aux besoins de leur famille se souvenaient de ces procédés inhumains. Cet amin, du nom de Challal, faisait comme tous ceux qui servaient la France coloniale. Il n'hésitait pas à rançonner les indigènes. Pour un oui ou pour un non, il mettait ces pauvres paysans à l'amende, ne serait-ce que pour les déposséder de leur unique chèvre ou de leur unique brebis, pis encore, s'ils possédaient une vache à lait. Malgré tous ces procédés abusifs, personne n'avait jamais osé lever le petit doigt pour le punir, tant ses victimes avaient peur de la justice coloniale.
Qui dit justice coloniale dit «guillotine». Ce monstre coupeur de têtes, installé dans la ville d'Azazga au lendemain de la conquête de la Kabylie, terrorisait en effet toute la population. Depuis qu'il avait menacé, en l'an 1845, le peuple de Kabylie, en jurant haut et fort : «J'entrerai dans vos maisons, je brûlerai vos villages et je couperai vos arbres fruitiers», le général Bugeaud était entré dans la légende, dans le langage kabyle, sous le nom de bichuh (bête méchante). Le mot « Ifinga » (la guillotine), quant à lui, désignait pour les autochtones le châtiment suprême.
Toutes les terres gérées par ce Challal au service des colons appartenaient autrefois à des dizaines de familles qu'on avait expropriées, à l'arrivée des Français, au bénéfice d'une seule famille dont le patriarche était un caïd nommé par l'administration coloniale.
Dans cette vallée nommée Zawya, tout près de la rivière de l'Oued Sibaou et de la ville de Makouda, la France avait attribué des dizaines d'hectares de terre, les plus fertiles de cette contrée, à une seule tribu du nom de Si Moh Ouchikh. Cette famille de religieux, dont le patriarche était un caïd, servi par des amins souvent issus de leur famille, comme Challal, prospérait grâce au système colonial. D'ailleurs, à l'aide des privilèges que la France de cette époque avait accordés à cette famille, cette dernière vit, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, sous la présidence de Boumediene, l'un de ses enfants devenir ministre des transports.
Ces gens qui se sentaient tout-puissants grâce à leurs maîtres, les colons, agissaient sur les paysans de leur commune comme au temps des rois féodaux, pour exploiter, sans aucun état d'âme, les plus démunis. Personne n'osait lever le petit doigt pour protester contre leurs méthodes tellement ils les terrorisaient en s'appuyant sur les lois coloniales. Dans cette riche vallée, devenue le domaine de la famille du caïd Si Moh Ouchikh, on cultivait des légumes verts, des primeurs, en passant par des céréales, jusqu'aux melons et aux pastèques, et le tout poussait en abondance...
Après cette action menée contre des bêtes sauvages qui, à cette époque, faisaient trembler les hommes les plus courageux, Ouali acquit une grande notoriété auprès de toute la population. Il était devenu un personnage charismatique. De partout, les habitants d'Aït Aïssa Mimoun se répandaient en éloges en faveur de leur héros tueur de lions. Toutes ces louanges irritèrent profondément l'administrateur colonial, l'amin. Si auparavant les deux hommes se haïssaient, à cause de leurs différences, la tension n'avait fait que s'accroître entre les deux protagonistes depuis cette affaire. Challal, l'abominable exploiteur du peuple, décida de tout faire pour chercher querelle à Ouali, afin de le traduire devant la justice de ses amis colonialistes ... d'autant plus que leurs villages se faisaient face. Seule une petite rivière coulant au fond d'un ravin les séparait.
Pour chercher noise à Ouali, l'amin Challal s'acharna un jour sur la tante de celui-ci. Pour une histoire ridicule, il la rabroua de sa grosse voix, devant de nombreux témoins ! Le plus grave, c'est qu'il en était arrivé aux mains en la secouant par la manche de sa robe! Il lui reprochait d'avoir laissé son âne brouter quelques bouchées d'herbe de son champ qui donnait sur un chemin public. La malheureuse, qui était rentrée en pleurant, avait caché cet incident pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, mais les témoins présents s'étaient hâtés de rapporter les faits aux oreilles de Ouali. Celui-ci voulut venger l'honneur de sa tante, mais les sages de son village le raisonnèrent en lui conseillant de ne pas tomber dans la provocation, et l'histoire en resta là...
En dépit de tous les témoignages de sympathie affichés par les villageois à son égard, Ouali continua de mener sa dure vie de paysan. Par fierté, et malgré la misère qui le tiraillait, comme tout le monde, Ouali ne voulait pas s'agenouiller et participer au ramassage des récoltes organisé chaque année par l'administrateur, l'amin Challal, dans le domaine de la famille Si Moh Ouchikh. Il préférait travailler dans des endroits très abrupts, pour débroussailler ses lopins de terre envahis de rochers, de bosquets de toutes sortes qu'il fallait déraciner, afin d'y semer quelques mètres carrés de blé, d'orge et de fèves.
…
Pour l’honneur d’un village
Éditions Kirigraphaires
2011
Pages 20 à 23
Livre en vente ici :
http://www.edkiro.fr/pour-l-honneur-d-un-village/
09:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
04/07/2011
L'Aigle de minuit (Naïma AKKAL)
« L’Aigle de minuit »
Au bout de la nuit,
J’entends un triste chant,
Sous le bruit de la pluie,
J’entends un cri d’enfant,
Un cri d’amour,
Un cri de détresse
Petit orphelin de cœur,
Petit ange du malheur,
Que le temps a laissé,
Derrière les barreaux de l’oubli…
Pourquoi ce monde est-il injuste ?
Pourquoi le sang est-il si brusque ?
Que l’on n’a pas le temps de rire,
Que l’on n’a pas le temps de dire,
Que l’on n’a pas le temps d’aimer,
Petite vie si fragile,
Comme un éclat de verre,
Petit orphelin de guerre,
Qui n’a plus personne sur terre,
La solitude le mène,
Vers un monde lointain,
Que son triste destin,
Reste l’allié des chagrins,
À pas de géants vers la victoire,
Des hommes si froids sans âme ni cœur,
Ils cherchent à tracer l’histoire,
Avec les larmes d’un enfant.
…
Cœur de verre
TheBookEdition
2011
Livre en vente en ligne :
http://www.thebookedition.fr/coeur-de-verre-akkal-naima-p-62954.html
08:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook