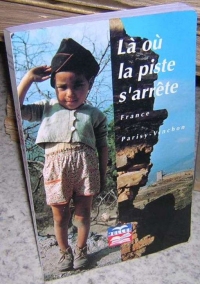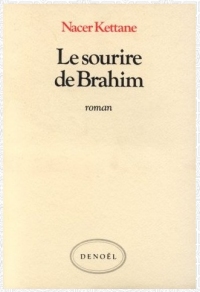26/10/2011
Les heures vraies d’Izerraguène (Slimane ZEGHIDOUR)
Dans une chronique parue dans ‘’Le Quotidien d’Algérie’’ (27 août 1992), Slimane Zeghidour évoque les lieux de son enfance en ces termes : "Avant tout, il faut appeler un chat un chat et le chef-lieu de ma commune natale Merdj Izerraguène, et non pas Errakène, comme le veut l’usage administratif d’une arabisation par l’absurde de cet onctueux nom. Merdj Izerraguène, ‘’Pré aux sentiers qui bifurquent’’ en arabo-berbère. Le nom Errakène fait plus penser au Zaïre ou au Pays Basque qu’à la Kabylie des Babors (…) C’est à perdre son latin, son arabe et son kabyle.
Erraguène me convoque chaque année (…) C’est le berceau, le terroir, le reliquaire de la famille, l’album de l’enfance. Ce n’est pas tout. C’est aussi un concentré explosif de l’Algérie profonde, celle qui n’en finit pas d’écrire l’histoire de ce pays, même si elle n’a toujours pas droit au chapitre. Celle qui ne sait ni lire ni écrire mais qui n’a pas encore dit son dernier mot. L’Algérie du Djebel, un havre de paix que cette cuvette d'eau limpide où se reflète le plus luxuriant maquis qui soit. Ajonc, bruyère, lentisque, chêne vert, peuplier, sureau, frêne et cèdre millénaire donnent le ton : vert bouteille”.
Le texte de Slimane Zeghidour continue en rappelant une vérité de la géographie physique que beaucoup de nos écoliers ignorent et que nos gestionnaires ne trouvent peut-être pas nécessaire de connaître : dans cette région, il pleut trois fois plus qu’à Paris ou à Brest, mais les foyers et les ménages ont toujours soif à côté d’un barrage constituant un lac artificiel stockant quelque 200 millions de mètres cubes d’eau limpide et cristalline venant de la montagne.
"Du temps de la guerre, de mon enfance dans le camp de regroupement du Merdj que recouvre désormais le barrage, la ‘’Citi’’ avait tout d’un village alpin : héliport, cinéma, terrain de sport, piscine, supermarché, librairie, clinique et téléphone bien entendu. Un vrai petit coin de paradis. À ceci près que l’Algérien n’y était admis que comme écolier ou travailleur journalier. Mais, à l’Indépendance, la ‘’Citi’’, au lieu de devenir entièrement algérienne, cessa tout simplement d’être".
La Cité disparaissait chalet après chalet. Toutes les infrastructures ont fini par être anéanties. Slimane Zeghidour, révolté par tant de bêtise et d’aveuglement ayant accompagné l’Indépendance du pays, illustre par des photos accompagnant son témoignage l’état de la cité avant et après l’Indépendance. Ce sont de très belles bâtisses qui occupaient les sommets des collines et qui ont fini par ‘’s’évanouir dans la nature’’. "Ce pays est paradis raté. Sera-t-il un enfer accompli ?", s’inquiète l’auteur avant de déplorer : "L’abandon, l’exode, la lumière de la ville, le kamis relèguent déjà dans l’ombre la gandoura, le conte populaire, le foyer rural, l’attachement au terroir. Ne serait-ce que pour cela, je ne saurais rester indifférent à l’agonie d’El Ouldja".
Dans les vignettes de M’quidech
Installé à Alger, Slimane Zeghidour arrête ses études au Certificat d’études. À partir de 1970, il travaille comme dessinateur de bandes dessinées et il fut l’un des pionniers de ce métier et de cet art en Algérie. Il se souvient de ces moments-là : "Dès 1970, alors que l’Algérie officielle ne jurait sur le papier et par la parole que par l’autogestion, nous avions une cotisation pour financer une route à El Ouldja-Izerraguène. Je me revois encore remettant mon petit salaire de dessinateur du journal ‘’M’quidech’’ à mon grand oncle Messaoud.
Avec cet argent, il avait mis au travail la jeunesse désœuvrée de la mechta. Un an après, la première voiture arriva. Un fonctionnaire venait répertorier la terre à exproprier ‘’au profit de la révolution agraire’’. Comme inauguration officielle, on ne pouvait faire mieux. La ‘’route’’, aujourd’hui mal en point, que nous avions percée pour y ramener le progrès n’aura facilité en fait que l’exode de toute la jeunesse. Ziama, Jijel, Alger, Marseille et Paris pourraient en témoigner". Slimane Zeghidour finira lui aussi par s’installer à Paris à partir de 1974.
Il continuera son travail de dessinateur de BD. En 1979, les éditions de ‘’La Pensée sauvage’’ publient un album de Zeghidour sous le titre : ‘’Les Nouveaux immigrés’’.
…

08:08 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
21/10/2011
Là où la piste s’arrête (France PARISY-VINCHON)
Je sens le genou du Colonel frôler le mien : grande est mon envie de lui donner un bon coup dans la cheville, mais puis-je poser ce geste sans déclencher d'esclandre ? Je ne me contente de croiser les jambes, mon talon en avant-garde. Quand surpris, il se tourne vers moi, mon regard attend le sien :
- Merci de me proposer votre voiture ; je ne suis pas venue rechercher le confort. Dans tout pays différent du sien, pour le connaître et le conquérir, il faut vivre selon ses coutumes. La marche n'en est-elle pas une ici ? Pourquoi m'y soustraire-je ?
Dépité, il s'adresse aux autres officiers sur des sujets moins anodins ; jusqu'au café. Je vais être transparente, heureuse de ce désintéressement. En quittant le mess, après un échange de politesses assez distantes, Monnot et Ferras éclatent de rire.
- Pas content le Colonel ; vous lui avez bien rivé son clou. Notre miss paraît douce et tendre, mais elle cache son jeu. Bravo, on en fera quelque chose de vous si les petits cochons ne vous mangent pas.
Du colonel, je n'ai plus reçu d'invitation durant mon séjour à El-Millia. Mais chaque jour, poliment, nous nous sommes salués. J'ai très vite pris mes habitudes : à midi repas au mess et le soir chez les Hutier. J'évitais de devoir attendre ou déranger quelqu'un pour me remonter en jeep car il m’est totalement interdit de circuler à pied après 19 heures, pour cause de sécurité, et je coupe aux libations nocturnes, aux arrosages pour un anniversaire, une fête, une "perm", une "opé", ou rien quand il n'y avait aucun prétexte possible. Chaque jour, je changeais de table, même si la préférence allait aux tables des jeunes officiers ; avec eux, je riais de bon cœur ; avec les aînés, c'était un peu cérémonieux, parfois maladroitement mondain. Ainsi j'ai connu tout l'état-major du régiment, mais celui du quartier du colonel Trinquier me restait fermé. Grande pourtant était mon envie de rencontrer des paras, mais ils vivaient à part.
J'ai entendu les potins, les racontars, découvrant El-Milia, une petite ville transparente où tout se sait immédiatement, où les langues s'en donnent à coeur joie, déformant le moindre fait, en faisant parfois moi-même les frais.
- On vous voit beaucoup avec le toubib, avec le sous-lieutenant Chauvot. N'essayez pas de nous faire croire que les raisons en sont uniquement professionnelles…
Les jours passent. Je vais devoir choisir : rester ou partir. Dans la balance, en faveur d’El-Milia, il y a "Ladjunkia". "Ladjunkia", ancien hameau composé de quelques maisons groupées autour d'une fontaine et d'une école, maintenant verrue proliférante à la périphérie d’El-Milia. La fontaine coule toujours ; pour des raisons de sécurité, l'école est désaffectée et le hameau est transformé en centre de regroupement. Autour du noyau initial, suivant un quadrillage militaire propre à tout regroupement, se sont accumulées huttes et tentes : 1000 personnes résident là ! Le djebel étant déclaré zone interdite, chassées de leurs douars, les personnes déplacées créent dans toute l'Algérie autour de chaque centre, ces villages de la désolation. N'étant pas regroupés volontaires, c'est-à-dire n'ayant pas abandonné d'eux-mêmes leurs maisons pour réclamer la protection de l'armée française contre les exactions des fellaghas, ils sont a priori suspects d'être favorables à la rébellion et vivent dans des conditions matérielles très précaires : peu ou pas de travail pour les hommes, pas de ressources puisqu'ils ont perdu leurs cultures et leurs maigres bestiaux. Les divers chantiers d’El-Milia ne peuvent absorber toute cette main-d'oeuvre disponible. Alors ils vivent de distributions gratuites de nourriture. Ils apprennent la paresse, la mendicité, deviennent des assistés.
Monot rêve d'implanter là une annexe de l’A.M.G. et de rouvrir l'école avec quelques classes de débutants. Il a tout organisé dans sa tête. Le toubib viendrait deux fois par semaine ; le reste du temps l'infirmerie serait tenue par un infirmier algérien sous ma "haute" gouverne. Avant de me présenter Lamhri, le capitaine situe le bonhomme :
- Pour le moment il loge au C.T.T., si vous préférez au centre de tri et transit, un camp où sont enfermés les Arabes douteux, supposés en collusion avec les fells. Les vrais fells, pris dans des embuscades sur le terrain, sont prisonniers militaires, gardés par l'armée ou par les gendarmes. Mais les autres, les civils les traînards récupérés en zone interdite, les rôdeurs d'après le couvre-feu, les détenteurs de tracts fells, sont bloqués au C.T.T. pour un stage de réflexion, dans l'attente d'un jugement. Lamhri fait partie du lot, suspecté d'avoir piqué à l’A.M.G. des flacons de pénicilline pour les repasser aux fells. J'ai des doutes sur sa culpabilité, ou tout au moins sur les buts de son vol : commerçant dans l'âme, l'argent compte plus à ses yeux que la politique. Pourtant, il vit comme un prince : lisant et écrivant l’arabe aussi bien que le français, il se loue comme écrivain public et se fait de bonnes journées. Excellent infirmier, l'hôpital où l’A.M.G. le réclament de temps en temps pour un coup de main : il sort le matin rentre le soir dans un régime de semi-liberté. Surveillé par vous, Lamhri ne jouera pas au con ; d'ailleurs je l'ai briefé. Ouvrir une infirmerie à "Ladjunkia" aurait un effet psychologique considérable sur la population …
Là où la piste s’arrête
Éditions MULLER
1993
07:51 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook
Facebook
17/10/2011
Le sourire de Brahim (Nacer KETTANE) 2
OCTOBRE À PARIS (1961)
– Yahia Djazaïr, Algérie algérienne, résonnaient dans le ciel de Paname.
Les youyous stridents reprirent de plus belle, avec chaleur et gaieté. La rage au cœur, l'espoir aux lèvres, la foule comme un seul homme scandait sa liberté. Une clameur colorée, comme ce quartier des arts et des lumières n'en avait peut-être jamais entendu. Pendant que les cœurs palpitants vibraient à l'unisson, la manifestation avançait.
Brahim serrait très fort la main de sa mère. Avec Kader dans les bras au milieu d'autres femmes elle reprenait les slogans venus de la tête du cortège. À ses côtés une femme manifestement enceinte s'évanouit : elle fut tout de suite dirigée vers une voiture qui tardait à repartir.
Presque tous laissaient éclater leur joie. Néanmoins certains visages tendus reflétaient l'inquiétude. Peut-être était-ce pour mieux l'étouffer que les cris se firent de plus en plus fort. Quelques jeunes tambourinaient sur une derbouka ou un bendir, tout en chantant comme pour mieux rythmer la marche. Foulards verts noués autour du cou, petits drapeaux vert et blanc brandis, quelques hommes s'évertuaient à discuter avec les passants pour leur expliquer les raisons de la manifestation. Une véritable marée humaine remontait le boulevard et il semblait que rien ne puisse s'opposer à sa progression.
À la hauteur de la place de la Sorbonne, un vent de panique souffla sur les manifestants. Des C.R.s. embusqués chargeaient la tête du défilé et au même moment le bruit de balles venues on ne sait d'où déchirait la nuit. Un cri s'éleva au-dessus de la foule en rumeur. Fatima hurlait de douleur, en tenant la tête de son fils ensanglantée.
– Ammi Ammi... (mon fils! mon fils!).
Chacun essayait de s'enfuir mais les matraques pleuvaient. Brahim se serrait contre sa mère. Fatima regardait autour d'elle sans voir son mari. Par chance, elle fut entraînée dans une ruelle attenante au boulevard par deux militants. Ils réussirent à se faufiler sous une porte cochère. Deux cents mètres plus loin le massacre continuait et au fracas des matraques se mêlaient les sirènes de voitures. Un groupe de policiers tenait en joue plusieurs dizaines d'hommes, le visage tourné vers un mur, les mains levées au-dessus de leur tête. Indignation, dégoût et fureur se lisaient dans leurs yeux. Par terre traînaient quelques drapeaux cassés, des mouchoirs tachés de sang, des vestes déchirées, des sacs. Deux hommes le visage en sang gémissaient dans le caniveau. Quelques passants regardaient le spectacle sans broncher quand ils n'accéléraient pas leur marche.
Les cars de C.R.S. et les voitures de police avaient maintenant complètement encerclé le quartier. Plusieurs centaines de manifestants étaient là, immobiles, parqués comme des bêtes, leur révolte grondait intérieurement. Deux cars de la R.A.T.P. sortirent de l'ombre et on fit monter tout le monde. Pendant que les bus prenaient une direction inconnue, les policiers finissaient de « nettoyer » la place et le boulevard.

Fatima, accompagnée des deux hommes, avait réussi à remonter la ruelle et à héler un taxi. Pendant que la place disparaissait au loin, le boulevard se remplissait d'une autre foule, celle des sorties de cinéma.
Dans le taxi, les larmes de Fatima n'en finissaient plus de couler. Kader était mort et l'univers semblait s'effondrer. Sa tête comme celle d'un ange reposait sur le coeur de sa maman, il semblait sourire et dire : « Ne t'en fais pas, je suis toujours là et je t'aime! »
Le visage de Brahim s'était durci. Il semblait vieilli de plusieurs années tout d'un coup. Pas une larme ne coulait de ses yeux. Il caressait le visage de son frère qui le regardait mais qui ne le voyait plus.
Ce jour-là, le sourire de Brahim s'envola.
Le père de Brahim ne fut relâché que très tard dans la nuit. Ils l'avaient emmené avec tous les autres à la porte de Versailles. Il y avait retrouvé la plupart de ses camarades arrêtés à Bonne-Nouvelle, à l'Opéra, à l'Étoile...
– À Bonne-Nouvelle, ils nous ont carrément mitraillés, disait Boualem le collecteur de fonds. On aurait dit qu'ils voulaient tous nous fusiller, rajouta-t-il dans un frémissement de moustache.
– On nous y reprendra à manifester pacifiquement! lança un autre.
– Eh oui, ils ne comprennent qu'avec les armes, surenchérit son voisin.
– L'un d'entre vous sait-il combien sont restés sur le pavé ?
– À Bonne-Nouvelle, une bonne dizaine au moins, dit Bouale.
– À Saint-Lazare, au moins trois! dit quelqu'un dans le fond.
La fouille avait été minutieuse. Tous furent fichés, avec les sarcasmes et les vexations de routine : « sales bougnoules », « sales bicots, on aura votre peau ».
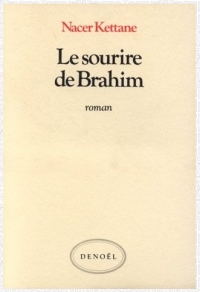 Nacer KETTANE
Nacer KETTANE
Le sourire de Brahim
Éditions Denoël
Paris ; 1985
08:26 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
07/10/2011
Le sourire de Brahim (Nacer KETTANE) 1
OCTOBRE À PARIS (1961)
Dans les discussions des grands, Brahim ne comprenait pas toujours très bien, mais sans cesse revenaient dans les bouches toujours les mêmes mots F.L.N., M.N.A., O.A.S...
La place Saint-Michel était maintenant en vue. Un bateau sur la Seine rugissait et le décor ressemblait à une carte postale jaunie, fripée.
La veille, la mère avait roulé le couscous des jours de fête et les pâtisseries aux formes, aux couleurs multiples se disputaient la place dans l'énorme tadjin familial.
Autour du père qui, pensif, pilait son tabac à priser, Brahim jouait avec Kader et Myriam sa petite soeur. Dans un coin de la pièce un vieux transistor émettait des sons parasités.
– Ici Saout el Arab, le colonel Gamal Abdel Nasser va s'adresser à la population.
À ce moment le père de Brahim interrompait son activité et montait le son. Les rares fois où Fatima avait vu le raïs à la télévision, elle disait en kabyle « Il est beau comme un lion. »
Comme des millions de personnes, les parents de Brahim étaient subjugués par le magnétisme que dégageait Nasser quand il s'adressait à la foule. De temps en temps, ils entendaient frapper à la porte; le cousin Djillali fidèle à son habitude venait s'enquérir.
– Ça va bien, vous n'avez besoin de rien ?
– Sacha Djillali, répondait Fatima. Koulchi mleh (tout est bien).
La mère mettait un point d'honneur à ne pas trop dépendre des autres, d'autant plus que Françoise, la femme de Djillali, n'avait jamais accepté totalement leur présence, même s'ils partageaient le loyer et les charges. De nature à la fois craintive et belliqueuse, il lui suffisait de peu pour semer la discorde. Tout le contraire de son mari, qui se « pliait en quatre » pour faire plaisir. Parfois Fatima le remerciait avec son beau sourire qui semblait sorti du royaume de Vénus, un sourire à faire pâlir la Joconde.
Pourtant la vie à six n'était pas facile dans cette minuscule pièce qui ressemblait beaucoup à une chambre de bonne. Grâce à un talent d'organisatrice peu commun, Fatima l'avait rendue vivable et le sieur « superflu » n'avait jamais osé s'inviter. Quelquefois le dimanche, et à condition que Françoise soit de bonne humeur, ils pouvaient admirer la boîte à images. Souvent Brahim avait essayé de trouver l'Algérie-4ur la grosse boule du journal télévisé, mais elle tournait trop vite.
…
Ils étaient maintenant place Saint-Michel, avec la fontaine en face d'eux. La foule commençait à se faire nombreuse. Les regards se croisaient, des accords tacites se nouaient. Il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes mais toutes les tranches d'âge étaient représentées, jusqu'à de très jeunes enfants. Certains étaient encore en bleu de travail, d'autres avaient mis leur costume, ou leur blouson de cuir. Les femmes avaient sorti leurs plus jolies robes et rivalisaient de beauté.
Tous semblaient à la fête, pourtant ce n'était ni Noël ni l'Aïd. C'était ou plutôt ce devait être beaucoup mieux : le début d'une nouvelle vie. Cette manifestation devait dire non une bonne fois pour toutes à la situation de sous-hommes faite aux Algériens de Paris : après vingt heures, impossible d'acheter des victuailles, de prendre l'air ou d'aller rendre visite à des amis. Une idée géniale de Maurice Papon, préfet de police, qui allait inventer un homme nouveau, « le raton » avec son cortège de bienfaisance, « les ratonnades », inspirées du dictionnaire de la haute pratique raciste.
Certains groupes commençaient à se former et les bouches de métro continuaient de déverser leur flot d'hommes et de femmes qui, le plus souvent, arrivaient de la proche et grande banlieue de Paris : les jours précédents, le F.L.N. n'avait pas arrêté de sillonner cette banlieue, jusqu'à faire du porte à porte, pour annoncer l'événement.
Derrière un cordon d'une vingtaine d'hommes, les familles prirent place et le signal de la marche fut donné pour remonter le boulevard vers le Luxembourg. Quelques commerçants, affolés, se précipitaient pour fermer leur magasin. Un cri strident retentit!
– Youuouuou...
Les passants stupéfaits s'arrêtaient comme pétrifiés. Les voitures ralentissaient puis repartaient rapidement.
– Yahia Djazaïr, Algérie algérienne, résonnaient dans le ciel de Paname.
Le sourire de Brahim
(pages 13 à 19)
Éditions Denoël
Paris ; 1985
09:45 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
05/10/2011
Georgette (Farida BELGHOUL)
Même un Mau-Mau y garde sa terre !
(pp. 129-130)
Un jour, je suis à la maison, la tête baissée devant mon père. Il est furieux et m'a frappée à coups de poing et à coups de pied à mort à cause de cette cinglée.
- Si tu m'écoutes pas, moi... Qui c'est qu' tu vas écouter ? Ta maîtresse ? Oui, écoute-la ! C'est normal : elle est diplômée, tout ça. Mais j'te l'ai déjà dit : écoute-la mais faut jamais la croire. Sinon, tu t' fais enterrer vivante. Ton frère, il est tordu comme toi, il écoute les voyous dans la rue. Il m'a dit : ta terre, vende-la! Mais faut rien à vendre du tout. Même un Mau-Mau y garde sa terre. Si tu la vendes, y'a personne qui te connaît. C'est grâce à notre terre qu'on porte le nom de la famille. Si t'en a pas de terre, t'en a pas un pays. T'es un bohémien, t'es un gitan. Alors que nous, j' l'ai gardée pour mes enfants. On peut faire la maison, planter les arbres, cultiver l'jardin. Si on veut faire 1'cimetière dans notre bled, on s'enterre là éternellement, personne qui te déterre. Tu vois pas qu'ici, il faut payer la place tous les dix ans ou tous les vingt ans. Si tu payes pas, on va t'déterrer tes os et on t'jette à la poubelle. Mais si tu m'écoutes, on t'couche dans la bonne terre quand t'es morte. On te met pas vivante dans les ordures d'ici.
En vérité, mon père se trompe à moitié. Cette folle furieuse c'est une cannibale. Elle mange les grenouilles et me bouffe jusqu'à la moelle. Elle me grignote, et ma viande disparaît sur mes os. Ensuite, elle trempe mon squelette dans le vase à la place de la rose. Je reste sec là-dedans éternellement. Personne se ramène pour m'enterrer, même sous un tas de feuilles pourries. Plus tard, une autre maîtresse débarque dans la classe. La mienne est morte avec toutes ses dents. L'autre fait le ménage à son bureau.
- Pouah ! Qu'est-ce que c'est cette horreur ?
Elle prend mes os avec un mouchoir en papier ; et ce coup-ci il a raison, elle me jette à la poubelle. Je connaîtrai jamais la terre. Je porterai jamais de nom.
Georgette
Éditions Barrault
Paris 1986
07:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook