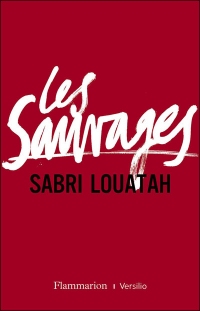25/02/2012
L’an mil aux At-Yenni (Ramón BASAGANA) 1
Extrait du « Roman de l’an mil ».
Cette fiction, à la fois historique et fantastique, raconte l’histoire de deux enfants juifs (Alcym et Rébecca) dont le père, Samuel de Tolède, médecin personnel du calife de Cordoue, a été assassiné en Gaule.
L’épisode ci-après se déroule aux At-Yenni (Béni-Yenni) en l’an 990.
13.
Le sentier montait en zigzaguant, bosselé, tassé par les sabots des ânes. Emmitouflés dans leurs burnous, couverts de boue, les trois cavaliers avançaient prudemment, par crainte de partir en glissade. Le mari de Ouardia avait fini par accepter – à contre-cœur – l’idée qu’un autre homme que lui puisse toucher l’intimité de sa femme. A vrai dire, il n’avait pas eu le choix : tous ses frères travaillaient chez Mohand et lui-même dépendait financièrement de son beau-père. La sentence du marin était tombée comme un couperet : « Si Ouardia meurt, il n’y aura plus aucun lien entre ta famille et la mienne ».
La pluie fine qui les avait escortés une partie de la nuit venait à peine de s’arrêter. Un couple de chacals traversa le sentier, effarouchant la jument, qui s’ébroua. Alcym lui tapota l’encolure avec une sorte de tendresse respectueuse : « Tu es la plus belle jument du monde ! »
Il n’avait jamais tenu les rênes d’une monture aussi légère, aussi élégante et rapide ! Une arbalète et un carquois pendaient aux arçons de sa selle. « Ne pars jamais sans ces accessoires ! » avait insisté Saadi en les lui tendant.
Ils franchirent Tassaft-Ouguemoun –un village construit autour d’un chêne, au sommet d’une colline– et empruntèrent la mauvaise route qui menait aux At-Yanni. Une bouffée d’air froid leur fouetta le visage. At-Larba, l’un des villages de la tribu – connu pour ses forges et ses ateliers d’armes – se dressait, puissant et austère, sur le plus haut sommet de la chaîne. Mohand lui expliqua que les habitants de ces contrées sauvages se groupaient – depuis la nuit des temps – sur les pitons. « Pas plus les Romains, que les Carthaginois ou les Arabes, n’ont pu nous déloger ! » ajouta-t-il en parcourant du regard la kyrielle de villages, posés comme des coiffes, sur les crêtes du massif.
At-Larba frappa Alcym par la sobriété de ses constructions et la disposition des rues, concentriques autour du sommet. Un chemin bien entretenu contournait les habitations: Mohand lui expliqua qu’il permettait aux voyageurs n’ayant pas affaire dans le village d’aller leur chemin sans y entrer.
Lorsqu’ils passèrent sous l’arche de la Tajmaât *, des chiens se mirent à aboyer. Le village dormait. Mohand et Aflah descendirent de leur monture ; Alcym les imita. Le marin expliqua que l’entrée du village était sacrée. Il récita alors à haute voix :
Sslam n-Nbi fellawen, ay iâasasen illan da !
(Que la paix du Prophète soit sur vous, ô Saints qui habitez en ces lieux !)
Ils grimpèrent par une ruelle étroite en direction du sommet, puis bifurquèrent vers la gauche. La maison d’Aflah, plongée comme toutes les autres dans le silence des fins de nuit, occupait le fond d’une impasse.
Le maître des lieux déplaça un moellon et passa la main derrière une imposte. Un bruit mât de penne en bois qui s’abaisse et la porte tourna sur ses gonds. Elle ouvrait sur une petite cour intérieure assez vaste pour abriter les trois montures. Plusieurs maisons donnaient sur cet espace clos. Habdah hennit, des serrures grincèrent, il y eut des voix de femme, une torche.
Ouardia gisait sur une couche à même le sol, recouverte d’une couverture en laine. Son front était pâle, trempé de sueur. Ses yeux, enfoncés dans les orbites, avaient perdu tout éclat. Complètement indifférent aux femmes qui gémissaient dans un coin, Mohand s’agenouilla près de sa fille, prit les mains exsangues et les porta à ses lèvres. De grosses larmes roulèrent sur ses moustaches. Ouardia ouvrit péniblement les yeux et une étincelle se faufila hors de ses pupilles pour se muer en sourire. La petite main serra imperceptiblement les gros doigts.
Puis l’étincelle s’évanouit dans la nuit, la petite main devint flasque et les yeux se révulsèrent. Lorsque des soubresauts épars soulevèrent la poitrine de sa fille Mohand fut pris de vertige et son hurlement glaça le sang des femmes.
Quelques minutes avaient suffi pour que les voisines envahissent la pièce. La qibla s’approcha du pirate : « Dieu m’est témoin que j’ai tout fait pour sauver ta fille. Il faut me croire, Si-Mohand ! »
- Je te crois, Melha. De toute façon, que sommes-nous pour contrer les desseins d’Allah ?
Alcym posa une main sur l’épaule de Mohand. Il se sentait sincèrement touché par la souffrance de cet homme rude, redoutable et redouté, qui réagissait comme tous les pères du monde devant la mort de leur fille.
…
Roman de l’an mil
Éditions Les Nouveaux Auteurs
2012
* Construction sous laquelle a lieu l’assemblée du village.
10:45 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
20/02/2012
Le chef de çof (Hanoteau et Letourneux)
La solidarité dans l’étendue d’un groupe n’est pas, à beaucoup près, aussi complète qu’entre les çofs d’une même tribu ou d’un même village. Lorsqu’une tribu est en proie à la guerre civile, les çofs du groupe envoient fréquemment des contingents armés, pour soutenir leurs amis respectifs. Mais, si les causes de la guerre sont locales et n’intéressent pas directement les voisins, ces secours s’achètent le plus souvent à prix débattu.
Les autres genres de secours, en argent, vivres et munitions, sont donnés, au contraire, avec une véritable libéralité, et si le sort des armes force un parti à s’expatrier momentanément, il est sûr de trouver chez ses amis un accueil empressé et une cordiale hospitalité. On n’attend pas que les « émigrés » [imegadjan] viennent eux-mêmes demander asile; on va processionnellement à leur rencontre, musique en tête et bannières déployées; des montures sont fournies aux femmes, aux enfants, aux vieillards, et le cortège ramène ses hôtes au bruit de la fusillade. Après un repas abondant, chacun des émigrés choisit la maison où il veut s’établir avec sa famille. Il y est toujours le bienvenu ; le chef de maison qui refuserait d’accueillir un membre du çof dans le malheur soulèverait contre lui l’opinion publique, et serait puni d’une forte amende.
À la paix, chacune des familles qui a reçu des émigrés donne en cadeau à ses hôtes des vêtements neufs pour les femmes et les enfants, des ustensiles de ménage, des provisions pour les premiers besoins, puis la même escorte qui a amené les fugitifs les reconduit triomphalement dans leurs villages. Si des maisons ont été incendiées, des moissons dévastées, des plantations détruites, les bras de tous les adhérents sont à la disposition des victimes ; les habitations sont reconstruites, les champs labourés, les arbres remplacés, sans qu’il en coûte rien à leurs propriétaires.
Les fonds nécessaires aux besoins du çof sont fournis par des cotisations volontaires. Cet impôt est celui que les Kabyles payent le plus volontiers, et le seul qu’ils acquittent sans l’avoir consenti, sans chercher même à en connaître l’emploi. Lorsque les chefs ont besoin d’argent pour nouer des intrigues, acheter des consciences, préparer une trahison, négocier l’assassinat d’un ennemi dangereux, ils se concertent entre eux, contractent des emprunts, soldent les dépenses et ne font connaître à la foule que la somme à payer. Le secret reste entre trois ou quatre personnes au plus. Les dépenses plus avouables, et qui ne demandent pas de mystère, sont débattues et contrôlées par le çof tout entier.
Les chefs ou, comme disent les Kabyles, les « têtes de çof », sont nécessairement des personnages importants dans le pays. Ils ne dirigent pas, il est vrai, toujours à leur gré les actes du parti, mais ils ont sur lui une influence considérable, et peuvent, à un moment donné, disposer de forces importantes. Ce sont des hommes qui se sont fait remarquer, soit par leur bravoure à la guerre, soit par leur finesse et leur habileté dans l’intrigue; ils appartiennent, d’ordinaire, à des familles déjà puissantes par le nombre et par la fortune. L’aisance est une condition indispensable pour figurer à la tête d’un parti : outre la considération qui s’attache à la richesse, en Kabylie comme partout, elle procure les loisirs nécessaires à la mission d’un chef et les moyens de faire face aux dépenses obligées de la position. Les occupations d’un homme investi de la confiance d’un çof sont aussi nombreuses que variées ; c’est à lui qu’on a recours en toutes circonstances : il écoute les plaintes, se lient au courant des affaires du pays, donne des conseils, fournit des secours, doit s’occuper, en un mot, non-seulement des questions générales, mais encore des intérêts particuliers.
Il doit surveiller en même temps et déjouer les manœuvres du çof opposé, étudier avec soin les éléments de discorde qui s’y produisent et les faire tourner à son profit, en les envenimant. Sa tâche la plus délicate est le maintien de la bonne harmonie entre les membres de son parti. Tantôt deux plaideurs passionnent les esprits, tantôt une dette de sang jette la division entre deux kharoubas et menace de dissoudre le çof. Le chef doit pourvoir à tout et, à force de patience, d’adresse et d’expédients, désarmer les colères, apaiser les haines et ménager des transactions. Tous ne réussissent pas également; mais beaucoup d’entre eux font preuve, dans ces luttes toujours renaissantes, d’une grande souplesse d’esprit et d’une véritable connaissance du cœur humain. Le sacrifice de son temps n’est pas le seul devoir imposé à un chef de çof : il est aussi astreint à des dépenses nombreuses. Une hospitalité généreuse est de rigueur; elle est la base de sa puissance. Si le couscous est de bonne qualité, si le beurre et le miel n’y sont pas épargnés, les poètes chanteront ses louanges, et leurs vers, répétés dans le pays, entoureront son nom d’une inattaquable popularité.
Il contribue en outre largement à toutes les cotisations du çof; très-souvent même, pour ne pas refroidir l’ardeur des adhérents par des appels de fonds trop répétés, il supporte seul les dépenses. Ses revenus ne suffisent pas toujours à de telles charges; il y dissipe parfois son patrimoine. Mais ni lui ni ses parents ne songent à s’en plaindre : une famille kabyle saurait-elle payer trop cher l’honneur qu’elle ambitionne le plus au monde, celui de voir un des siens à la tête d’un parti nombreux, uni et bien discipliné ?

Hanoteau et Letourneux
La Kabylie et les Coutumes kabyles (Vol 1 1893)
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
12:06 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
13/02/2012
Les Pères-Blancs dans la Guerre (Georges OUDINOT) 1
Page 107
CHAPITRE 1 : CAP SUR l'ALGÉRIE
Jacquotte et Raynaud (SAS de Ouadhias et Beni-Douala) ont lancé leur projet de bordj pour matérialiser leur volonté de présence. À la SAS de Mekla, on n'en est pas encore là.
...
Au cours de ce premier et cordial contact, j'ai mis le doigt sur une source de difficultés non encore évoquée : la présence dans le paysage de Communautés de Pères-Blancs et de Sœurs-Blanches. Deux SAS, pour l’instant, sont concernées : celle de Jacquotte, aux Ouadhias, et celle de Raynaud, à Beni-Douala. Ces présences créent des situations ponctuelles qui s’avèrent difficiles à gérer ; j'aurai l'occasion d'y revenir.
Page 117
CHAPITRE 2 : BENI-DOUALA
Le terrorisme ayant commencé à frapper au cours de l'été 1955, le Pays s'est peu à peu replié sur lui-même. Mon prédécesseur, le capitaine Raynaud, a créé la SAS à Beni-Douala le 15 novembre 1955.
…
Quinze jours avant son arrivée, le 1er novembre 1955, une grève générale ordonnée par le FLN a paralysé toute l'Algérie ; elle a été effective partout en Kabylie par crainte de répressions terroristes.
…
Les quelques instituteurs qui avaient rejoint leur poste en octobre, menacés à nouveau, ont quitté leurs fonctions ; les écoles vont rester désespérément fermées. Quelques-unes seront brûlées ou saccagées ; les Pères-Blancs, qui avaient ouvert les leurs, ont eux aussi obtempéré à l’ordre de grève FLN.
Pages 126-127
En juin (1956), j'ouvre à Beni-Douala une école « symbolique », baptisée « Cours de vacances » : deux puis trois classes, avec des Instituteurs-Paras. Les gosses affluent, parfois de loin, récompensés de l'effort consenti par le « casse-croûte » de midi ; on ne tarde pas à y chanter À la claire fontaine et, bien sûr, Debout les Paras !

Page 149
Les Fells vont recruter …
Un matin, je vois arriver dans mon bureau le Père Duplan, le plus jeune des quatre Pères-Blancs, le seul avec qui j‘avais eu jusque-là des relations convenables en apparence, mais chaleureuses en privé. Il m’explique qu'un certain nombre de jeunes de Taguemount-Azzouz*, anciens élèves des Pères, scolarisés en secondaire au lycée d'Alger, sont remontés au village.
Il craint que, désœuvrés, ils ne se laissent recruter par les Fells... Il m’affirme qu'il y a des contacts... Il ne voit qu'une solution : les occuper pour les soustraire au désoeuvrement et si possible aux ravages de la propagande. Il a arraché à son supérieur l'autorisation d’ouvrir une espèce de foyer dans une annexe de leur école où il compte les réunir.
- De quoi as-tu besoin ? lui demandai-je.
Il sort une petite liste de sa poche. Je lis « balles de ping-pong, jeux d ‘échecs et de dames... ». Étonné par la modicité de sa demande, je l’interroge du regard... Il reprend :
- Si j’osais, je te demanderais si tu n'as pas quelques machines à écrire, du papier, des crayons, quelques cahiers, de la craie. Le père Martz a refusé de m’ouvrir son stock de fournitures scolaires actuellement inutilisées.
J’avais une dizaine de machines à écrire portatives récupérées auprès des anciens secrétaires de Centres : elles firent l'affaire. Pour le reste, le problème fut vite réglé.
Un mois plus tard, j'ai vu revenir le Père pour me demander un laissez-passer et... me faire ses adieux : « Je suis viré comme un malpropre parce que j’ai sollicité et accepté ton aide », me dit-il.
Le Père Martz lui avait fait rendre le matériel prêté au poste militaire le plus proche et lui avait intimé l'ordre de se présenter dès le lendemain au supérieur de leur ordre, à Maison-Carrée...
Une dizaine de jours après son départ, j'ai pu vérifier qu'une demi-douzaine de jeunes gens avaient pris le maquis, condamnés à mourir sous nos balles, les uns après les autres, dans les mois qui vont suivre, par la faute d'un prêtre français...
Une triste réalité face à laquelle j'étais impuissant !
* Ce village est le plus important avec près de 3 000 habitants.
UN BÉRET ROUGE EN KÉPI BLEU
MISSION EN KABYLIE … 1956-1961
L’esprit du livre éditions
2007
06:47 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
07/02/2012
Les sauvages (Sabri LOUATAH)
Chapitre 7.
Quartier de Montreynaud, 16 heures
Quelques instants plus tard, dans la voiture de tonton Bouzid, Krim envoya un texto à Gros Momo pour qu’il se renseigne sur le MDMA. Et puis il s’aperçut en attendant la réponse qu’il était en train de perdre ses superpouvoirs. Des visages dont il ne se souvenait plus, des voix qu’il confondait, bientôt, sans doute, les fausses notes allaient lui échapper, et il pourrait même se mettre, à moyen terme, à aimer la musique nasillarde de ce Cheb quelque chose qui faisait crépiter l’autoradio de tonton Bouzid. Celui-ci baissa le son et enclencha l’allume-cigare.
- Bon Krim, j’ai promis à ta mère qu’on allait avoir une petite discussion. Tu as dix-sept ans. C’est quand ton anniversaire ?
- C’était hier.
- Bon. Depuis hier tu as dix-huit ans, alors écoute-moi bien… Krim savait parfaitement de quoi il s’agissait. Il se mit en pilote automatique et entreprit d’acquiescer toutes les quinze secondes.
Pendant qu’il s’entendait reprocher d’avoir démissionné de McDo après deux jours, d’avoir souffleté sa cheftaine à chignon et de tuer sa mère à petit feu, Krim se délecta de la conduite souple de son oncle, qui lui rappelait celle de son père et ces soirs où, parce que tout le monde était de bonne humeur, il était autorisé à monter devant et à savourer les moindres aspérités qu’offrait la route éclairée par la pleine lune. Krim retrouvait ces émotions sur GTAIV : il ne faisait aucune partie, se tenait à l’écart des missions, des gendarmes et des voleurs, se contentait de rouler sans fin dans ces tentaculaires villes virtuelles où le monde s’arrêtait comme au bon vieux temps où la terre était plate, aux limites d’un océan abstrait au-delà duquel il était inconcevable de s’aventurer.

Le tonton Bouzid, comme son père et comme lui au volant d’une voiture de pixels, prenait des virages amples et généreux. Chez le tonton c’était certainement par déformation professionnelle : chauffeur à la STAS, il conduisait le redoutable 9 qui reliait le quartier sensible de Montreynaud au centre-ville. L’habitude des anticipations larges et d’un volant trois fois plus gros se ressentait dans sa façon de tourner en oubliant les lignes. Certains de ces virages faisaient frissonner Krim de bien-être. Il se sentait beau, digne et important à côté de ces hommes qui menaient si bien leur véhicule qu’on s’abandonnait à rêver qu’il finirait fatalement, un jour, par en aller de même avec leurs vies. Mais ça ne se passait pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité le tonton Bouzid commençait à s’échauffer. Il regardait de plus en plus le rétroviseur et de moins en moins Krim :
— … et puis à un moment donné faut avoir un peu d’honneur, le néf, tfam’et ? Moi aussi j’ai fait des conneries quand j’étais jeune, tu crois quoi ? que t’es le seul ? on est tous passés par là. Mais voilà, faut grandir à un moment donné. Et puis faut arrêter de traîner avec tes petits weshwesh là. Les gens ils disent : Sarkozy, le karcher… Mais la vérité il a raison ! Toutes les petites racailles moi aussi je te les extermine au karcher. Je les vois toute la journée moi, les petits wesh-wesh, j’aime autant te dire que si y en a un qui allume une clope ou qui emmerde une petite vieille il va trouver à qui parler. Non mais tu crois quoi, que c’est les loubards qui vont faire la loi ? Bon alors maintenant tu prends tes responsabilités. Surtout avec l’élection de Chaouch. J’espère que t’as ta carte hein ? T’as dix-huit ans, ça y est hein, tu peux voter. Non, à un moment donné faut… Krim reçut un texto au moment où la voiture quittait la voie express et s’engageait dans la route en lacets qui escaladait la colline de Montreynaud. Il le consulta en cachant l’écran phosphorescent avec son autre main.
Reçu : Aujourd’hui à 16:02.
De : N
J-1, j’espère que t’es prêt.
Krim se rembrunit. Ces derniers mois Nazir lui avait envoyé une moyenne de dix textos par jour, qui allaient de « Ça boume ? » à des maximes philosophiques comme « C’est l’espoir qui rend les gens malheureux ». Krim avait appris à penser par lui-même depuis qu’il s’était rapproché de son grand cousin à qui il devait probablement d’être encore de ce monde. Mouloud Benbaraka ne lui aurait peut-être que crevé les yeux ou coupé les couilles. La rumeur disait qu’il avait immolé par le feu un type qui avait manqué de respect à sa vieille mère… Nazir avait pu parlementer avec lui et sauver la peau de son petit cousin parce que Nazir était de la même trempe que Mouloud Benbaraka : sans illusions. Il voyait les choses comme elles étaient au lieu de se raconter des histoires : les textos qu’il avait envoyés à Krim en étaient le témoignage et Krim les avait soigneusement archivés, malgré l’interdiction formelle et insistante de Nazir. Il était même allé jusqu’à recopier les plus importants sur une feuille de papier pliée en trois, qui ne quittait plus jamais la poche de son jogging.
À ce texto-ci Krim répondit simplement qu’il allait bien, qu’il se sentait prêt, et puis la voiture s’immobilisa à un feu rouge et fit face à un portrait de Chaouch qui regardait Krim droit dans les yeux. Krim détourna le regard et ajouta à son message un « c koi le MDMA ? » qu’il imputa à l’influence du shit et auquel Nazir répondit de façon bizarrement sèche :
Reçu : Aujourd’hui à 16:09.
De : N
T’occupe. Et au fait, pas de drogues aujourd’hui.
Les sauvages
Flammarion –Versilio
2012
07:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
01/02/2012
Hold-up à la Casbah (Tarik DJERROUD) 3
Les accents patriotiques du général se voulaient convaincants. Le visage du Roi s’éclaircit et son regard brillait avec la sérénité d’une âme satisfaite :
- Je ne doute point ! Nous allons triompher parce qu’on n’a rien à perdre, mon général !
Sentant le moment opportun pour quêter le succès et ensevelir à tout jamais un passé pour lequel il espérait tant et si bien d’en prendre ses distances, De Bourmont fondit d’un large sourire, franchement béat, fit le serment autour de lui de ne rien laisser filtrer de cette brève réunion, et sortit en compagnie du baron d’Haussez, son acolyte, pour se dilater la rate, en laissant flotter derrière eux le parfum d’un rapide triomphe.
Le 2 mars 1830, le ciel parisien grondait dès le petit matin et lâchait des trombes d’eau incessantes. Charles X portait chichement des habits d’officier sur le chemin menant à la salle des Gardes du Louvre entourée d’un jardin qui brillait d’une verdure lavée. Parvenu à la tribune avec une lumière étincelante dans le regard, il demanda aux Pairs et aux députés de s’asseoir avec une voix rauque. D’une bonne oreille, l’assistance s’impatientait d’écouter l’oracle du jour : « Au milieu des graves événements dont l’Europe était occupée, clamait le Roi, j’ai dû suspendre le juste ressentiment contre une puissance barbaresque ; mais je ne puis laisser plus longtemps impunie l’insulte faite à mon pavillon ; la réparation éclatante que je veux obtenir, en satisfaisant à l’honneur de la France, tournera, avec l’aide du Tout-Puissant, au profit de la Chrétienté ! »
Les présents étaient froids et pantois mais impuissants à changer quoi que ce fût. Depuis, tous les arcanes de l’État étaient résolument tournés vers le port de Toulon, tandis qu’au Palais des Tuileries, le Roi se lovait dans une ambiance empreinte de satisfaction d’avoir mis deux bons fers au feu et appelait vivement la Providence à soutenir ses bataillons.
Et pendant ce temps, guère enthousiasmé, le pauvre peuple parisien suivait assidûment la fronde que menait le député de la Seine, Alexandre de Laborde, pour faire échouer l’expédition. Un petit matin, de nombreux tracts signés solennellement du nom du député étaient collés sur les murs de Paris, où les passants lisaient : « … Nos mesures présentaient le singulier résultat que le seul créancier, en faveur duquel on avait reconnu la créance, fut le seul qui n’en reçut aucune part ». Sur un autre papier, on pouvait lire : «… Mais enfin, cette guerre est-elle juste ? Non vraiment, je ne crains point de le dire, non. Un jury politique, un congrès européen, comme le rêvait Henri IV, ne l’aurait point pensé. Il aurait résumé cette affaire : le Dey réclame, on le vole, il se plaint, on l’insulte ; il se fâche, on le tue ! Cette guerre est-elle utile ? Cette guerre est-elle légale ? Une voix s’élèverait plus ancienne, plus haute que la Charte, celle de la morale publique et du droit naturel. Elle assignerait les ministres à comparaître à la barre de la France et de l’humanité : à la barre de la France qui a droit de leur demander compte de la vie et de la fortune de ses enfants, qui leur dirait : « Varus, rends-moi mes légions ! Varus, rends-moi mes trésors ! »
Le lendemain, sur les étals des marchands de presse, la Une du Figaro était traversée par une éloquente manchette, encore plus frondeuse et injurieuse, savamment étudiée, et mise en exergue avec une langue ou le vif mécontentement de la décision de la guerre le disputait au choix impudent du général en chef : « M. de Bourmont veut être maréchal : il mérite le bâton ! »
L’hiver était rude. Devant l’instabilité politique chronique, la hargne des Chambres et la fébrilité de la monarchie, le Roi avait solennellement cautionné une expédition monstre sur une contrée encore plus vulnérable, seul exutoire qu’il trouva pour mieux se changer de ses oripeaux éclaboussés par les nombreux échecs de sa politique intérieure.
Tarik DJERROUD
Hold-up à la Casbah
Edifiions Belles Lettres
2012
08:56 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook