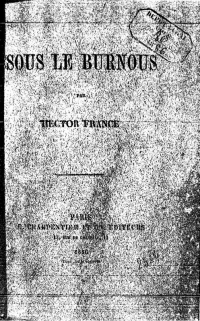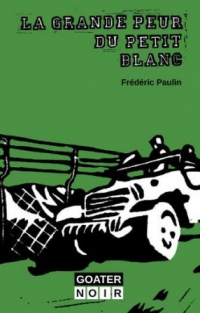26/03/2015
Sous le burnous (France HECTOR) extrait
LA NOCE DE LA PETITE ZAIRAH
Depuis six mois, chaque vendredi, je la voyais arriver, trottinant derrière la mule de son père, parfois seule, mais le plus souvent une vieille à ses côtés. Elle était tous petite -douze ans à peine- mais si frêle et si mignonne qu’elle en paraissait deux de moins.
Enfant de la vieillesse de Baba Aaroun, sa mère à quatorze ans était morte en couches ; aussi le vieillard la chérissait bien qu’elle ne fût qu’une fille, et lorsqu’elle sentait plier ses jambes ou que ses pieds se meurtrissaient aux pierres du chemin, il la prenait devant lui sur le barda de sa mule, comme il eut fait d’un fils. Mais il la déposait doucement à terre avant d’entrer à Djigelly.
C’est alors que nous la voyions passer, insoucieuse et gaie fillette, devant le bordj des Spahis.
Mais bientôt, comme les sœurs dont parle le Lévitique, elle grandit tout à coup. Sa taille se forma ; ses flancs se dessinèrent ; d’harmonieux et doux globes soulevèrent sa gandoura de coton ; le bouton se faisait fleur. Et timide et rougissante devint la fillette, et en même temps si jolie que, pendant des semaines, Arabes et Berbères venaient s’asseoir, devant la porte au coin du bastion, à l’heure où le marché s’ouvre pour voir passer cette merveille des Ouled-Aïdoun.
Et ils allaient rôder autour de l’étalage de Baba Aaroun, lui achetant des pastèques et des figues pour admirer de près la blonde Kabyle qui reflétait dans ses grands yeux étonnés toutes les nuances de la mer et du ciel.
Il savait bien ce qu’il faisait, le vieux Aaroun ; il savait qu’accompagné de sa fille, la double charge des fruits de son jardin disparaissait comme si un djin bienveillant l’eut touché de son pouce mettant à leur place des poignées de sordis, car il avait pour clients tous les Saphis, tous les Turkos et les Mokalis et tous les jeunes Maures de la ville.
Ses voisins riaient de lui, mais que lui importait. Il savait aussi que, sous son œil, la pucelle resterait intacte bien plus sûrement que s’il la laissait au gourbi, confiée à la surveillance distraite de ses belles-mères ou de ses grandes sœurs.
Autant que les vieillards des villes sont avides du fruit vert, les jouvenceaux de la montagne sont habiles à saisir la proie guettée.
Et tous la convoitaient, tandis qu’elle, embarrassée et honteuse, et comprenant déjà, se sentant brûlée par ces flammes ardées sur elle, cachait en rougissant son visage derrière un coin de son haïk.
Entre tous ces admirateurs, se rencontrait le Chaouch Ali-ben-Saïd.
Malgré quarante ans sonnés au cadran de sa vie, il passait pour un des beaux cavaliers de la ville et un des plus rudes champions près des femmes, ce qui, joint à une conformité toute spéciale l’avait fait surnommer Bou-Zeb , nom difficile à traduire en français.
Bref, il possédait les qualités qu’au temps du prophète Ezéchiel, Oolla et Oolibella, soeurs bibliques et vierges folles, exigeaient de leurs amants.
Coquet et beau parleur, il se distinguait par le luxe de son turban brodé de soie jaune, son gilet chamarré d’or et l’éclatante blancheur de son burnous ; aussi Mauresques et Kabyles lui clignaient de l’œil, et les femmes des Mercantis même, avouaient que pour un Indigène, il n’était pas trop mal tourné, c’est-à-dire qu’elles le trouvaient charmant.
Il parlait, du reste, le français avec facilité, buvait de l’absinthe et du vin, et généralement tout ce qu'on voulait bien lui offrir, portait des chaussettes, se mouchait dans un foulard, fuyait la vermine et s'abstenait du Ramadhan.
Il avait quelque argent et aurait pu vivre sans rien faire en ce pays où un douro quotidien constitue un large patrimoine mais désireux de briller en ce monde et sachant que les femmes n'aiment rien tant que les glorieux, il s'était mis au service du Bureau arabe et portait avec orgueil, aux jours de solennité, le burnous bleu de Chaouch.
…
France HECTOR
Éditions G. Charpentier
Paris 1886
Pages 151 à 155
06:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
19/03/2015
La grande peur du petit Blanc (Frédéric PAULIN) extrait2
À Paris, les Mekchiche durent à nouveau se presser dans les rues grises. Une pluie fine mouillait la capitale de la France et les Parisiens faisaient d'épouvantables grimaces. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'immense hall de la gare Montparnasse, ils virent le mot « OAS » peinturluré sur un mur.
Malgré les patrouilles de soldats et de policiers qu'ils croisèrent à plusieurs reprises, on ne les inquiéta jamais.
- Ils sont là pour l'OAS, précisa son père comme sa mère s'inquiétait de voir des hommes en armes si loin de l'Algérie.
- Et ils n'ont pas peur du FLN ?
Le père haussa les épaules:
- Il paraît que le Général de Gaulle et Belkacem Krim ont engagé des négociations.
- Des négociations pour quoi faire? demanda sa mère qui semblait découvrir qu'on lui avait menti.
- Pour l'Indépendance, répondit le père en haussant à nouveau les épaules mais, cette fois, de l’air de celui qui en sait plus que les autres. Ne fais pas l'étonnée, tu savais bien que le FLN allait gagner,
La mère se tut, ses yeux étaient vides. Puis elle hocha la tête :
- Oui, oui, je savais bien...
Ils s'installèrent alors dans leur wagon pour la dernière partie du voyage. Sur le quai, ils virent passer les autres familles harkis. De part et d'’autre de la fenêtre, les émigrés se sourirent, un peu plus sereins de se sentir un peu plus nombreux.
Emigré. Ce fut son père qui employa le premier ce mot.
- On sera toujours des étrangers, maintenant, avait murmuré sa mère, alors que tout le monde dormait sur le bateau.
Son père sourit de ce petit sourire triste qui ne le quittait plus :
- Pas des étrangers, Fouzia. Des émigrés. Comme beaucoup d'Algériens, de Marocains ou même de Portugais en France. Ce n'est pas anormal des émigrés en France.
Par ce long voyage, les Mekchiche étaient donc devenu des émigrés. Mais Rochdi ne crut pas son père: il sentait bien que, désormais, il était aussi un étranger. En France, bien sûr, mais également en Algérie.
Émigrés ou étrangers, il se trouvait qu'en France les Algériens n'étaient pas les bienvenus. Lorsque le train s'arrêta en gare de Redon, une compagnie de gardes mobiles, fusils au poing, encerclait la gare. À Philippeville, les Mekchiche ii avaient vu des gendarmes et des militaires, eux aussi la mitraillette en bandoulière, ce n'était pas là le problème. D'ailleurs, en Algérie, les avions et les véhicules blindés faisaient également partie du quotidien ; ici il n'y en avait pas. Mais dans la gare de cette petite ville de Bretagne, Rochdi et les siens réalisèrent vite que c'était pour les Harkis que les Forces de l'ordre avaient sorti leurs armes. Pas pour le F.L.N.
Quelques gradés et deux civils se tenaient en avant de la troupe.
On interdit d'abord aux Algériens de descendre du train. Les autres passagers, les Français, furent priés de se dépêcher de quitter les lieux après que leurs papiers eurent été vérifiés. Son père déclara qu'il n'y avait rien à craindre, que le lieutenant Gascogne avait tout prévu, que ce n'était qu'une opération de routine et qu'il ne fallait pas s'affoler.
Un long moment avait passé.
Puis, un capitaine et trois gendarmes montèrent dans le train. L'officier demanda aux hommes de descendre.
La discussion entre Français et émigrés fut brève. Les émigrés baissaient la tête et les Français secouaient la leur, comme le faisait l'instituteur lorsque Rochdi n'avait pas appris sa leçon.
Tous les Harkis furent ensuite regroupés dans un seul wagon. Quatre policiers en civils montèrent à leur tour dans le train : leur mission était de s'assurer que les Algériens retournent en Algérie.
– Vous savez parfaitement qu'en tant qu'ex-soldats français, votre venue en France est illégale, expliqua d'un ton paternaliste le capitaine avant da quitter le wagon.
Pendant une heure encore, le train resta immobile. Personne ne dit un mot ; les vieilles femmes pleuraient doucement.
Dehors, la ville ne ressemblait en rien à ce qu'avait imaginé Rochdi : pas de mer bleue et pas de petites maisons blanches et propres. C'est pourquoi le retour en Algérie lui sembla finalement une alternative tout à fait acceptable, à lui. …
 La grande peur du petit Blanc
La grande peur du petit Blanc
Frédéric PAULIN
Éditions Goater "Noir"
2013
08:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
14/03/2015
La grande peur du petit Blanc (Frédéric PAULIN) extrait1
Algérie, France, Algérie, août 1961
…
Le grand départ eut lieu au mois d'août 1961. Philippeville était baignée par le soleil.
Son père avait entraîné Rochdi dans le salon. Il caressa ses cheveux quelques minutes tendrement. C'était la première fois qu'une telle intimité physique les unissait, l'enfant était un peu inquiet.
– Nous allons quitter Philippeville.
– On déménage ?
Le père haussa les épaules :
– Oui, on déménage très loin : on va en France.
Du haut de ses dix ans, la nouvelle troublait Rochdi :
…
Une heure après avoir débarqué à la gare d'Alger, la famille Mekchiche au complet s'installait sur une banquette du pont intérieur. Les places alentours étaient occupées par d'autres familles algériennes dont les pères connaissaient celui de Kader. L'un d'eux le salua même à la militaire en disant « bonjour caporal ».
Son père avait eu un sourire triste:
– C'est fini tout ça. Plus de caporal, plus de harkis, plus d'Algérie.
La traversée de la Méditerranée avait été un moment de tranquillité comme les Mekchiche n'en avait plus connu depuis longtemps. À bord de El Djezaïr, il semblait que les esprits s'étaient refroidis, son père paraissait triste mais aussi plus détendu que lorsqu'ils étaient encore sur le sol algérien. Les femmes s'étaient toutes changées: elles avaient quitté leur djellaba et retiré leur haïk et s'étaient vêtues à l'européenne. Sa mère avait revêtu une jupe qui arrivait juste au-dessous de ses genoux et un imperméable beige, elle avait noué ses cheveux en un petit chignon. Elle était très belle.
Ensuite, les harkis avaient peu parlé. Les pères avaient discuté un petit moment à voix basse, un peu plus loin sur le pont. Et au bout de quelques heures, tous s'étaient endormis comme m'ils n'avaient plus dormi depuis des jours. Sa grand-mère parlait en dormant, ça avait fait rire les enfants, et aussi, parfois, leurs parents. Rochdi, lui aussi, souriait: la France était peut-être un pays où tout le monde souriait.
Mais en France, plus on avançait, plus le ciel devenait gris. C'était pourtant l'été. Quant aux Français, ils ne souriaient pas. À Marseille, ils regardaient même le groupe d'Algériens avec de la haine. Cette haine les harkis la connaissaient pour l'avoir vue chez certains Européens à Philippeville.
– C'est l'invasion des felloches, dit même un vieux monsieur qui fumait une pipe.
– Ils mettent pas assez le bazar chez eux, ils ont besoin de venir chez nous, ben c'est du propre confirma un peu plus tard un jeune cycliste.
Son père expliqua alors aux autres hommes harkis qu'il valait mieux que les familles voyagent séparément, afin d'éviter d'attirer l'attention. On se donna donc rendez-vous, peut-être à Paris, à la gare Montparnasse, et plus certainement à Rennes ou à Redon. Pour Rochdi, Rennes et Redon étaient des noms d'un exotisme incroyable: malgré ce qu'il avait vu de la France, sa grisaille et sa tristesse, il s'imaginait des villages au bord d'une mer bleue et de petites maisons blanches et propres. Une manière d'Algérie parfaite, sans la guerre et la méfiance entre les Algériens et les Français.
Dans le wagon, les Mekchiche se retrouvèrent pour la première fois seuls au milieu des Français. L’inquiétude reprit possession de la famille. Rochdi, lui, s'efforçait de s'absorber dans la contemplation du paysage. Mais le beau temps n'était toujours pas de la partie: au bout de deux heures, le ciel nuageux déversa même des trombes d'eau.
– J'ai froid, maman, murmurait de temps en temps Souhila.
Sa mère la serrait contre elle et la fillette se rendormait.
Par la fenêtre, on voyait beaucoup d'églises au centre des villages qui apparaissaient au loin. Rochdi s'étonna de l'absence de minarets. Il s'étonna aussi de la pâleur des gens : en Algérie, même les Français n'avaient pas la peau blanche. Dans le compartiment, le couple et son petit garçon qui faisaient face aux Mekchiche avaient la peau presque aussi blanche qu'un cachet d'aspirine. Et puis, le mari et la femme n'en finissaient plus de hausser les sourcils lorsque leurs regards s'arrêtaient sur la famille algérienne. Rochdi pensa que c’étaient les ronflements de sa grand-mère qui les ennuyaient.
Frédéric PAULIN
Éditions Goater "Noir"
2013
08:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook