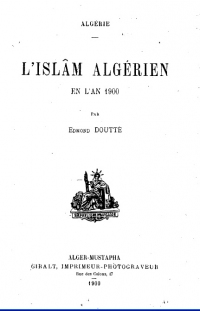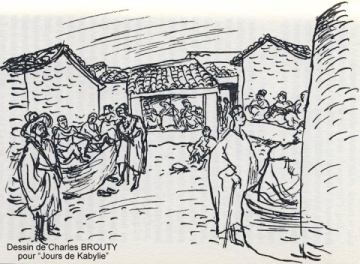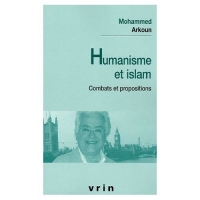26/09/2010
Le Ramadhân en l’an 1900 (Edmond DOUTTÉ)
I
Les dogmes de l’Islam, le culte musulman, la loi
…
4° Le jeûne, (çawm ou ciyam).
Il a lieu pendant tout le mois de Ramadhân. Il commence chaque jour à l’aube, à partir du moment où il est possible de distinguer un fil blanc d’un fil noir et se continue jusqu’au coucher du soleil. Il consiste dans la privation absolue de toute espèce d’aliments ou de boissons. On ne doit rien avaler : on ne doit même pas fumer, ni respirer des parfums ; les rapports sexuels sont formellement interdits. Lorsque le Ramadhân tombe au mois de janvier, comme cette année, ces prescriptions sont supportables. Mais lorsqu’il vient, par suite du manque de coïncidence de l’année lunaire avec l’année solaire, à tomber au mois de juillet, par exemple, elles sont extrêmement pénibles, car il ne reste plus au fidèle que quelques heures de nuit pour manger et prendre un peu de repos, si ses moyens ne lui permettent pas de passer le jour à ne rien faire. Le moment du coucher du soleil que l’administration fait annoncer par un coup de canon est en général fiévreusement attendu par les fidèles affamés et à peine a-t-il retenti que la ville est en liesse. Alors, ont lieu pendant la nuit des réjouissances, voire des orgies, qui ne contribuent pas à reposer les croyants. Aussi la fin du Ramadhân les trouve-elle en général fort affaiblis. Cependant ce jeûne est observé avec la plus grande rigueur ; les musulmans mettent beaucoup d’ostentation et ceux qui ne l’observent pas sont maltraités par les autres. Le jeûne n’est obligatoire que pour les individus majeurs ; les femmes enceintes, les malades, les voyageurs, ne sont pas astreints au jeûne en ramadhân ; mais ils doivent, plus tard, s’acquitter de cette obligation. Pour s’assurer si un jeune homme a l’âge de jeûner, voici comment l’on procède ici : il prend une ficelle, il la double ; lorsqu’elle est doublée, il fait le tour du cou avec et il coupe les deux extrémités de façon que, doublée ainsi, elle ait juste la longueur de la circonférence du cou ; puis il prend entre les dents la double extrémité, et dédoublant la ficelle, il cherche à taire passer sa tête dans la boucle ainsi formée ; s’il réussit, il peut jeûner, sinon il doit encore attendre.
L’ISLÂM ALGÉRIEN EN L’AN 1900
Giralt, Imprimeur
Alger-Mustapha
1900
Pages 8 et 9
09:36 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
22/09/2010
Souvenirs de TAOURIRT-MIMOUN (Mohammed ARKOUN) 3
…
Parmi l'assistance, ceux d'en-bas étaient choqués par un mode de domination qu'ils croyaient révolu ; d'autres, ne comprenant pas exactement l'enjeu de l'admonestation, furent simplement amusés de la scène. Mouloud et moi avons souvent commenté devant des amis divers -en riant et en faisant rire comme il savait bien le faire avec son art de conter- les propos et l'indignation de Da Salem. C'est une des dernières, mais très significatives manifestations des mécanismes de contrôle de la parole porteuse de pouvoir en société kabyle. L'authenticité ethnologique du propos est soulignée par l'emploi répété de Dâdâk qui souligne des rapports de respect, c'est-à-dire, en fait, de pouvoir de l'aîné sur les cadets dans la famille et, plus généralement, des plus âgés sur les plus jeunes dans toutes les relations sociales, l'âge pouvant signifier la sagesse, la connaissance et le respect strict du code de l'honneur, un sens de la dignité personnelle et du dévouement à la communauté.
Je n'ai pas été apostrophé par mon prénom, mais par un rappel généalogique qui me renvoyait à ma place et à mon statut dans le « clan » (dont le souvenir est pourtant très estompé depuis longtemps) et le village. De même, la mention de lâarsh souligne le caractère exceptionnel et solennel d'une audience qui dépasse celle du village. À ce niveau, L’Amîn est le médiateur ou porte-parole incontournable. Seul le « marabout » habilité à solliciter la bénédiction divine au début et à l'issue de toute réunion importante, peut valablement s'exprimer pour ajouter une consécration religieuse aux propos « séculiers » de L’Amîn. Au sein de Thajmayth (assemblée de village) les représentants des familles peuvent prendre la parole dans le code précis des ordres de préséance et sous la présidence de L’Amîn.
Un dernier trait intéressant de l'apostrophe de Da Salem est la remarquable ouverture à la connaissance de langues autres que le kabyle. L'arabe et le français sont considérées comme des langues de promotion culturelle et sociale (avec une prime supplémentaire pour l'arabe, langue sacrée du Coran et moyen d'accès aux enseignements de l'islam). La maîtrise de ces langues rehausse le statut non seulement de l'individu, mais de la famille. C'est pourquoi Da Salem réaffirme la vocation des Mammeri à contrôler, à gérer ces facteurs nouveaux (pour le kabyle) de mobilité sociale et, éventuellement, de transformation du capital symbolique qui cesse d'être lié exclusivement à l'usage du kabyle. Ainsi l'histoire met en mouvement des structures archaïques et les structures réagissent à « l'innovation » (la fameuse bid'a traquée par les juristes théologiens musulmans à une échelle plus vaste et avec les enjeux plus complexes de vérité divine opposée à la vérité humaine) par la voix de ceux qui y puisent la légitimité de leur pouvoir.
Il y a ouverture aux langues, mais monopolisation du prestige qu'elles confèrent, parce qu'il s'agit de renforcer un ordre ancien et non de le remettre en question par l'apport culturel de ces langues. Quand on compare cette attitude et celle du Front islamique du salut qui, dans l'Algérie de 1989-1999, réclame la suppression de l'enseignement du français pour assurer le monopole de l'arabe, on constate une régression de l'attitude pratique devant l'étude des langues comme voie d'émancipation de la société.
Mouloud Mammeri était, bien sûr, très conscient de toutes ces contradictions ; mais il poursuivait avec sérénité et confiance la tâche difficile de collecter et de publier les trésors de la littérature kabyle. Il avait le privilège de puiser à bonne source ; il demeurait très à l'aise dans le système de valeurs qu'incarnait et défendait son père ; je ne partageais pas cette aisance parce que, pratiquant les trois langues devenues enjeux de pouvoir et refuges d'identités conflictuelles après l'indépendance, je suis davantage sensible aux enrichissements que la personnalité algérienne peut recueillir d'une politique linguistique équilibrée et respectueuse des données historiques et scientifiques irrécusables. Mais ni l'Etat colonial, ni les Partis-États issus des luttes de libération n'ont pu se passer de la langue comme point d'appui et véhicule du pouvoir « légitime ». La colonisation a légué partout une situation idéologique qui ne pouvait générer que les attitudes rigides observées depuis une quarantaine d'années dans un grand nombre de sociétés de l'ex Tiers-Monde.
La leçon de Taourirt-Mimoun mérite ainsi d'être méditée, analysée, diffusée dans tout l'espace maghrébin : historiquement et anthropologiquement, les Maghrébins ont traversé et traversent encore -avec des lucidités et des obscurantismes variables- des tensions identiques à celles que Mouloud et moi -avec beaucoup d'autres- avons toujours érigées en exercices éducatifs, en efforts de recherche pour un humanisme maghrébin.
Mohammed ARKOUN
Humanisme & Islam
Éditions Vrin ; 2005
Éditions Barzakh ; 2008
06:39 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
20/09/2010
Souvenirs de TAOURIRT-MIMOUN (Mohammed ARKOUN) 2
…
Cet ensemble de données brièvement rappelées seront mieux comprises dans un événement socioculturel dont j'ai été l'acteur principal en 1952. Je venais d'obtenir ma licence de langue et de littérature arabes à l'Université d'Alger. Face à Mouloud si à l'aise, si favorisé par la naissance, l'histoire et la fortune, je ressentais, pour la première fois, une petite compensation aux handicaps sociaux de mon statut de « protégé » : je connaissais une langue, l'arabe, et avais accès aux sources de la religion vraie ; je pouvais donc m'autoriser à prendre la parole publiquement dans un foyer rural (sorte de maison de la culture) récemment créé par Driss Mammeri, docteur en médecine qui venait de s'installer au village pour le bonheur de toute la population (jusque là, il n'y avait qu'un humble dispensaire tenu par des Sœurs Blanches à Aït Larbâa, village voisin de Taourirt-Mimoun).
Driss Mammeri participait au prestige de la famille, notamment par l'aisance matérielle ; il était beaucoup moins engagé que Mouloud dans la culture et l'animation de la mémoire ancestrale ; mais parce qu'il était un Mammeri, il pouvait prendre l'initiative de créer un foyer rural pour offrir aux jeunes de tout le douar la possibilité inespérée de se rencontrer et d'organiser des activités culturelles. J'eus le privilège de participer à l'inauguration du foyer par une conférence sur La condition de la femme kabyle et l'urgence de son émancipation.

Il y avait dans cette initiative plusieurs nouveautés de portée « sacrilège » : un obscur jeunet de ceux d'en bas prenait la parole devant un public élargi au douar (selon une coutume très établie, les représentants mâles des différents villages ne se réunissaient que pour des raisons très solennelles à ce niveau « confédéral » : enterrement d'une personnalité reconnue, règlement d'un problème commun, célébration d'un événement inhabituel). En outre, ce jeunet osait traiter d'un sujet tabou : l'émancipation des femmes sur lesquelles se concentraient les contrôles les plus tatillons et les contraintes les plus archaïques fixées par le code de l'honneur (al-nîf). Ce code, bien antérieur à l'islam, était superficiellement sacralisé par des références rudimentaires à une loi religieuse (sharî'a) médiatisée par des marabouts eux-mêmes plus enracinés dans la langue et la culture orales locales que dans les traités guère accessibles du droit dit musulman (fiqh).
La conférence eut lieu devant un public réjoui, intéressé, très jeune, ouvert. J'étais pourtant très mal préparé à une épreuve aussi redoutable, car, grandi dans une culture orale, j'avais intériorisé toutes les règles de l'autocensure et tout le rituel du discours et des conduites en public. En outre, certains concepts couramment utilisés en français ou en arabe, n'avaient pas de correspondants exacts en kabyle et j'avais peur, par dessus tout, de transgresser, soit un article du code de l'honneur, soit telle disposition du droit musulman ou de la coutume. Il est vrai aussi qu'une importante partie de l'auditoire communiait facilement avec ma gêne, puisqu'il ressentait les mêmes obstacles et les mêmes limitations dans une épreuve aussi inhabituelle.
On parla de l'événement dans tous les foyers et, bien entendu, Da Salem en eut connaissance. Son pouvoir d'Amîn était déjà déclinant depuis l'instauration d'une municipalité élue ; on n'avait donc pas sollicité son autorisation pour donner la conférence. Le lendemain, sûr de me retrouver au café où se réunissaient traditionnellement la plupart des jeunes, il vint vers moi levant sa canne en signe de menace d'une correction physique méritée, et fit cette déclaration publique qui résume parfaitement les modes et les voies de contrôle du discours social et du capital symbolique dans la société kabyle traditionnelle :
Fils de Lwannâs Ath-Waârab, me dit-il d'une voix menaçante au milieu d'un public étonné, comment as-tu pu t'autoriser à prendre la parole devant la confédération (lâarsh) des Béni-Yenni, sachant que ton respecté (dâdâk) Salem est toujours L’Amîn du village ? Ne sais-tu pas que tu appartiens à ceux d'en bas et que si quelqu'un doit prendre la parole en kabyle, il revient à dâdâk Salem de le faire ; et s'il faut la prendre en arabe, il revient à dâdâk Lwannâs de le faire et si, enfin, quelqu'un doit s'exprimer en français, seul Dâdâk al-Mulûdh (Mouloud) peut le faire ! Tu as transgressé les hiérarchies établies ; heureusement que ton père est connu pour sa droiture ; je t'invite à suivre strictement son exemple.
J'ai bien sûr demandé pardon à Da Salem, homme unanimement respecté ; j'ai expliqué que l'initiative de toute l'affaire venait d'un Mammeri et que j'avais voulu simplement préciser les rapports et les différences entre nos coutumes et le droit musulman qui n'avait jamais été appliqué en Kabylie (et ne l'a pas été jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962) ; en matière de statut personnel, les Kabyles pouvaient ainsi opter pour le régime kabyle, musulman ou français.
…
Mohammed ARKOUN
Humanisme & Islam
Éditions Vrin ; 2005
Éditions Barzakh ; 2008
Combats et Propositions (APPENDICE)
09:48 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook
Facebook
18/09/2010
Souvenirs de TAOURIRT-MIMOUN (Mohammed ARKOUN) 1
AVEC MOULOUD MAMMERI À TAOURIRT-MIMOUN
… Comme Mouloud (MAMMERI), je suis né et j'ai passé mon enfance et mon adolescence à Taourirt-Mimoun, l'un des sept villages qui forment le douar des Béni-Yenni en Kabylie. À ce titre, je puis évoquer quelques souvenirs de portée ethnographique, anthropologique et historique.

Mouloud appartenait à une famille aisée, de haute renommée, non seulement dans le village, mais dans l'ensemble du douar et même au-delà. Selon les divisions courantes dans les villages, les Mammeri faisaient partie de ceux d'en haut 'Ath-ufella ; leur maison toute blanche se voyait de tous les autres villages parce qu'elle se dressait au sommet de la colline à laquelle s'accrochaient l'ensemble des maisons de Taourirt-Mimoun, selon une hiérarchie descendante correspondant à l'histoire et au statut des familles. Les Ath-wârab (ma famille) faisaient partie de ceux d'en bas (Ath wadda) parce que vers la fin du XVIIIe début XIXe siècle, ils ont dû quitter la région de Constantine pour demander protection (lânaya) aux Béni-Yenni. La mémoire orale, dans ma famille, a conservé le souvenir précis d'un certain Larbi, qui, exerçant la vengeance selon les règles bien connues dans toute l'aire méditerranéenne, aurait tué sept personnes et, pour échapper au cycle des ripostes, se serait réfugié à Béni-Yenni. Ce qui est sûr, c'est que l'emplacement de notre maison tout en bas de la colline, traduit très exactement le statut de protégé qui est confirmé par l'ordre de préséance dans la prise de parole dans l'assemblée du village (îhâajmâyth), ordre qui était encore respecté au début des années 1950.
Dans les années 1945-1952, Mouloud était l'intellectuel brillant, élégant, admiré, écouté au village. Il avait eu le privilège d'étudier à Paris (licence de lettres classiques), de séjourner au Maroc auprès de son oncle Lwannâs, précepteur, puis chef de protocole du sultan Mohammed V. Les tout jeunes comme moi le suivaient du regard pour admirer sa chemise, son pantalon et son burnous en soie fine et dorée ; on l'écoutait avec ravissement lorsqu'il devisait ou plaisantait avec ses amis, le soir, au clair de lune, sur cette place nommée Thânsaouth dont il a évoqué la richesse poétique et la fonction socioculturelle dans la Colline Oubliée.
« Colline Oubliée », déjà en 1950. Pourtant, son père Salem maintenait vivante et vivace la vieille mémoire du village et de la Kabylie. Da Salem était L’Amîn du village : homme de confiance, dépositaire de la mémoire collective, protecteur intègre du code de l'honneur (annîf) qui assure la sécurité des personnes, des biens, des familles, des communautés parentales. Jusqu'en 1962, le douar n'a connu ni police, ni gendarme, ni justice de paix, ni percepteur. L'administration des communes dites mixtes était lointaine et ne s'intéressait guère aux villages enfouis dans la montagne. L'Amin puise sa légitimité dans la mémorisation parfaite des coutumes, des valeurs, des alliances, des contrats, de la geste fondatrice du groupe, des statuts des familles, du capital symbolique, du patrimoine littéraire, architectural, religieux... C'est de son père que Mouloud a reçu ce sens élevé d'une culture parfaitement intégrée et à grand pouvoir d'intégration, bien qu'elle fût et reste largement encore orale.
Produit lui-même de la culture française écrite, centralisatrice, urbaine, dominatrice, il ressentit très vite la nécessité de consigner par écrit les trésors qui ne vivaient déjà plus que grâce à de rares survivants ou résistants d'une culture orale menacée par l'oubli, la marginalisation, la disqualification, la désintégration. Moi-même, j'ai conservé de mes contacts avec les porteurs de la mémoire collective encore vivante (mes grands parents, mes oncles, mes tantes et d'autres personnes en dehors du cercle familial), l'idée indéracinable que la frontière entre l'écrit et l'oral est certes politique et idéologique ; mais elle a, bien sûr, des conséquences incalculables sur les rapports entre langue et pensée, donc sur l'exercice même de la raison, comme l'a bien montré J. Goody, dans Entre l’oralité et l’écriture.
L'Amîn ne se confond évidemment pas avec le caïd, fonction créée par l'administration coloniale. Les Mammeri avaient reçu des Français cette fonction ; mais Mouloud soulignait avec fierté que son père était Amîn, non Caïd ; son oncle avait même lavé en quelque sorte la famille de toute compromission avec le régime colonial puisqu'il servit un sultan musulman au prestige considérable pour la conscience musulmane maghrébine avant les indépendances. Mouloud recueillait ainsi le bénéfice de deux légitimités fondatrices : celle d'une mémoire authentique renvoyant aux origines les plus lointaines du peuple berbère s'étendant de l'Atlantique à Benghazi et de la côte méditerranéenne à la boucle du Niger. Ses séjours au Maroc et ses voyages au Sahara (Mozabites et Touaregs), lui avaient permis de vérifier la continuité linguistique et ethnoculturelle de ce vaste espace berbère (on dit désormais Amazigh) plus ou moins travaillé par la langue et la culture arabo-islamiques. Féru de culture gréco-latine et de littérature française, Mouloud n'insistait pas beaucoup, cependant, sur le versant islamique de sa famille. Il ignorait l'arabe autant qu'il savourait la poésie et la littérature kabyles. En tant qu'analyste critique, il a cependant commis l'erreur de forcer une littérature orale à entrer dans les cadres définis par la critique littéraire française de la première moitié du XXe siècle.
…
Humanisme & Islam
Éditions Vrin ; 2005
Éditions Barzakh ; 2008
Combats et Propositions (APPENDICE)
09:22 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook
Facebook
15/09/2010
Lucie ou Tharrha (DRAÏNA) extrait
Lucie représente la vue de son frère, le serment à la vierge prononcé par sa mère d’appeler l’enfant suivant du nom de la Sainte. Et le père de Lucie, venu de l’Ombre, trouve qu’elle a une tête pas plus grosse qu’une orange. Lucie est une fille. Ce n’est pas valorisant d’être une fille. Dans ce petit mot, simple comme bonjour, il y a comme un manque, comme un maillon oublié, comme quelque chose d’imparfait, d’incomplet. En outre Lucie est plus menue que les autres, ses frères et sa soeur, et surtout elle est la dernière. Ce mot pèse lourdement dans le psychisme enfantin lorsqu’il est prononcé par une mère, qui détient les clefs de la Vérité pour un être qui dépend totalement d’elle.
Elle est la dernière de la famille et porte sur ses épaules une pyramide de six personnes : sa grand-mère maternelle, Carmela, son père et sa mère, Vincent et Anne, ses deux frères, Pierre et Sauveur et sa soeur Marie. Elle est donc la septième. Curieusement ce chiffre sept la suit partout, et souvent lui est aussi néfaste que les sept plaies de l’Egypte. Rien n’est plus simple au plus jeune que de se laisser commander, diriger, assister par les plus grands.
Peut-être parce que les parents disent aux aînés :
- Fais ceci car ta soeur ne peut pas le faire, vas s’il te plaît, Pierre !
- Habille-là, ma fille, ça ira plus vite.
- Tu veux bien donner à manger à Lucie, Marie ? Regarde, elle s’en met partout.
- Occupe-toi de ta soeur tu vois bien qu’elle est plus petite, voyons !
- Tiens-lui la main, elle va tomber.
- Prends son manteau, tu vois bien qu’elle ne peut pas l’attraper, c’est trop haut pour elle.
- Mets-lui ses chaussures, ça m’avancera.
- Tu ne veux pas la mettre sur le pot, je suis occupée.
- Coiffe-là au moins pendant que je me prépare… !!
Les mots s’enfilent aux mots, tous plus dévalorisants les uns que les autres parce qu’ils montrent en permanence au plus jeune, qu’il est le plus petit, qu’il ne peut pas agir, qu’il ne sait pas, qu’il ne comprend pas, qu’il ignore, qu’il lui est impossible, qu’il ne va pas assez vite. Il est le seul de la famille, le seul des sept à tout ignorer du sens des mots. Dans l’acquisition du langage, il répète un mot mal perçu, il le répète mal, le déforme et les autres le reprennent pour le lui faire redire correctement, quand ils ne se moquent pas de lui. Oh ! c’est sûr, ils ne se moquent pas méchamment, mais même avec indulgence, c’est tout aussi cruel car cela montre bien l’infériorité du plus jeune par rapport aux autres. Quand on agit méchamment il y a une part de méchanceté qui laisse présager à l’autre une certaine part de mensonge de l’acte méchant, l’acte méchant étant volontaire il n’est pas pris totalement comme réel, alors que l’indulgence renforce la véracité de ce qu’on vous reproche : l’ignorance, l’incapacité, la faiblesse. Et puis au-dessus du dernier de la fratrie il y a ceux qui savent, ceux qui agissent pour eux-mêmes, ceux qui oeuvrent pour le bien de la famille et ceux qui agissent pour vous. Seulement, ce sont toujours les mêmes, ce sont ceux qui commandent, mais vous, vous ne faites pas partie de ce groupe, vous êtes seule dans le vôtre. Et puis il y a aussi les ordres de ceux qui commandent :
- Tu enlèveras les serviettes, pendant que ta soeur ôtera les verres et les assiettes, parce que toi, tu risques de les casser.
Quelle humiliation de n’être capable que de plier et de ranger des serviettes. Quant aux frères, que font-ils ? Pour réussir dans les études n’ont-ils pas l’obligation de travailler à leurs devoirs scolaires ? Au début, il faut bien l’admettre, le rôle du plus jeune est facile, car on ne lui impose rien de difficile ou de fatigant. Il attend, passif, et il tire sa petite victoire devant les mécontentements de ceux qui ont la charge la plus pénible. Car, les frères et la soeur doivent bien rouspéter un peu devant la tâche à accomplir !
- Encore c’est moi qui fais la vaisselle, vivement qu’elle grandisse pour prendre la relève ! Mince consolation, car l’être humain est là, sur terre, pour agir.
Petit à petit, Lucie devient Tharrha.
L’ombre du père plane…
Elle doit se battre, se battre pour faire valoir son droit à agir ; se battre pour combler le vide du silence dans cette famille dont les membres ne communiquent pas entre eux ; se battre pour dépasser les autres, les premiers, les premiers en sagesse, les premiers à l’école, les premiers nés !!! Les plus forts sont masculins, Tharrha n’aime pas sa condition féminine, sa condition de deuxième plan. Elle n’admet pas son infériorité.
DRAÏNA
Pages 12 à 14
Publibook ; 2010
08:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook