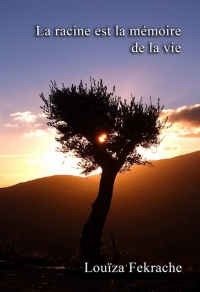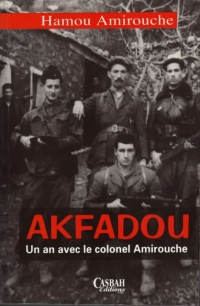28/10/2012
La racine est la mémoire de la vie (Louïza FEKRACHE)
Mon frère A. avait la grosse tête, des idées absurdes et voulait tout avoir sans rien faire, avoir le « pouvoir » tout simplement.
Ma mère voulait qu'il ait plus de responsabilités dans les magasins de mon père, mais celui-ci refusait tout ce qu'elle demandait en lui précisant que tout allait rester tel quel.
En septembre 1965, mon père fut obligé de partir en France pendant trois mois pour se faire soigner. Mon frère R. le remplaçait, mais ne faisait pas preuve de beaucoup d'autorité envers les autres du fait de l'absence de mon père. Personnellement, je n'ai pas de rancune envers mon frère R. qui m'accueillait au retour de l'école. Toujours triste, il travaillait de plus en plus et ne comptait que sur lui-même.
Les ouvriers l'aidaient dans son travail et ses amis le soutenaient moralement.
Lorsque j'éprouvais le besoin de parler, il venait dans la cuisine avec moi et répondait à mes questions :
« As-tu des nouvelles de papa ? »
Il me répondait :
« Tu dois être très forte, tu es une grande fille. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je ferai tout ce que je peux pour te le donner... Ne pleure pas, petite soeur, papa va bien... »
Mon frère R. me rassurait, mais a été « détruit » par un mensonge ou peut-être parce qu'il connaissait la vérité...
Au bout de quelques mois, mon père est revenu à la maison. J'en étais très heureuse, non seulement pour notre famille, mais aussi parce que mon frère A. ne pouvait plus me donner des ordres et me frapper comme il l'avait fait en l'absence de mon père.
Absence au cours de laquelle j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, mais ma mère m'avait interdit d'en parler à mon père !
Un moment donné, ma mère m'avait d'ailleurs suppliée de ne rien dire et de me taire, sous le prétexte que je devais laisser mon père se reposer quelque temps. J'ai toujours respecté ma mère, mais ce jour-là...
Mon père avait bien compris que cela n'allait pas du tout, il voulait tout savoir et savait que j'allais tout lui raconter. Ma grande sœur Z. tenait beaucoup à fêter le retour de notre père et à remercier Dieu de nous l'avoir ramené vivant. Mon frère R., sa femme, ma sœur Z. et son mari D.M. préparaient le dîner pour toute la famille et d'autres invités.
Pendant ce temps-là, ma mère parlait avec son fils préféré A. Elle lui faisait croire qu'il n'était pas considéré à sa juste valeur, mais bien comme un bon à rien ! Il croyait tout ce que ma mère disait et fit sa mauvaise tête. Bien que ce n'était ni le jour, ni le moment, il se plaignit auprès de notre père. Il lui expliquait qu'on s'occupait moins de lui, qu'il n'était pas content de travailler sous les ordres de son grand frère R., qu'il se sentait inférieur à lui et même aux ouvriers qui travaillaient pour lui. La réalité était pourtant tout autre.
Toujours bien habillé, à 18 ans, il avait déjà son permis de conduire et prenait la voiture quand il le voulait, tout en puisant de l'argent dans la caisse sans demander la permission à personne ! Il faut dire que mon père ne l'avait jamais véritablement empêché de faire cela.
Il s'est fiancé à 21 ans avec une fille du village voisin. Mon père organisa une grande fête pour célébrer le mariage en septembre 1967.
Quelques mois plus tard, en février 1968, il est parti en France pour rendre visite à son frère M. . Il y est resté deux mois et lors de son retour, mon père m'a immédiatement prévenue :
« Fais attention à toi, ma fille, il a le ventre plein... »
…
Mon frère A. aurait dû épargner un peu lorsqu'il travaillait encore chez notre père et que les affaires étaient encore florissantes.
…
Malheureusement, mon frère A. n'avait pas compris à quel point le grand frère M. pouvait être dangereux, jusqu'au jour où il découvrit que tout l'argent qu'il avait durement gagné avait disparu !
Il n'avait plus d'argent, ni chez lui, ni à la banque. Tout était parti en fumée.
La racine est la mémoire de la vie
Pages 74 à 80
Auto-Édition
Lille 2011
07:28 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
23/10/2012
OUZELLAGUEN (Hamou AMIROUCHE) 2
(En juillet 1963)
…
Avant de rejoindre la rue principale qui menait vers la gare, je marquai un dernier arrêt devant l'école primaire de Tazmalt. J'eus une pensée affectueuse pour Mr. Fernand Avril, cet instituteur mémorable qui avait fait obtenir aux élèves de Tazmalt leurs premiers diplômes de Certificat d'Etudes de l'histoire. Parce que l'instituteur avait osé donner un coup de baguette sur la tête à son cancre de fils, le colon-maire, M. Robert Barbaud, l'avait fait chasser de Tazmalt.
À la gare de chemin de fer de Tazmalt, je sentis des regards par en dessous en raison certainement de ma veste américaine, de mes lunettes noires et surtout de ma barbe fournie qui faisait rarement partie du décor en 1963. Je pris un billet aller-retour pour Ighzer Amokrane en me demandant dans quel état d'âme j'allais accomplir ce pèlerinage.
Durant le voyage, debout devant la fenêtre, je regardai défiler au loin sur la montagne, au ralenti, les villages où nous avions vécu les moments terribles d'opérations montées contre le colonel Amirouche, ou inoubliables, d'accueil enthousiaste et d'hospitalité hors du commun : Ivehlal, Tallent, Ighram, Iammouren etc. Au bout d'une heure environ, le train entra en gare d'Ighzer Amokrane.
Il était un peu avant midi et le soleil de juillet commençait à taper dur. Debout devant la gare, je dirigeai mes regards vers la montagne qui se dressait devant moi. Je pris la large piste barrée de part et d'autre d'une haie de cactus qui revenaient doucement à la vie comme les habitants. Les troupes coloniales les avaient rasées au bulldozer car elles servaient de cachette dans les embuscades montées par les commandos de l’ALN.
L'escalade commença à environ un kilomètre de la gare. Je me sentis léger comme une plume en pensant que je n'avais ni mitraillette, ni cartouchière, ni porte-documents qui puissent ralentir mon rythme. Et je cheminais en plein jour dans ma patrie libérée ayant chassé ces reîtres. Je pressai le pas : j'avais rendez-vous avec des esprits et des âmes qu'il s'agissait de ne pas faire attendre.
Je n'avais nul besoin de demander mon chemin aux paysans que je croisais sur le sentier.
Au bout de deux heures, je pénétrai au village d'Ouzellaguen, près de Tifri, lieu historique où se tinrent les assises du Congrès de la Soummam le 20 août 1956. Je pouvais apercevoir, ça et là des gourbis en ruine ou totalement détruits, appartenant très probablement à des maquisards «vendus», trahis.
Je n'avais plus aucune mémoire du lieu où était aménagé le refuge et où, vers huit heures du matin, un jour de janvier 1958, une fusillade nourrie nous avait surpris ; ni du bouquet de chênes maigrichons sous lesquels Si Amirouche avait déployé notre petit groupe. Mais je savais qu'il se trouvait à mi-distance entre le village et les pitons sauvages et dénudés d'Aït Zikki.
Je m'y dirigeai et au bout d'une demi-heure, je décidai que l'endroit exact où nous avions vécu le «feu d'enfer» de l'aviation et de l'artillerie françaises importait peu ; je m'adossai à un chêne et promenai mon regard sur les murets en contrebas d'où le bataillon de choc de Chaïb Mohand Ou Rabah avait lâché sa mitraille.
…
Hamou AMIROUCHE
Un an avec le Colonel Amirouche
Casbah Éditions
2009, Alger
09:00 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
18/10/2012
OUZELLAGUEN (Hamou AMIROUCHE) 1
(En janvier 1958)
…
L'armée française, sans doute renseignée monta une opération de ratissage de la région d’Ouzellaguen où nous nous étions rendus en inspection, à la suite de l'évacuation soudaine du village par l'armée française. Une rencontre inopinée égaya ma soirée : Messaoud Ouchouche, un camarade de l'école de Tazmalt et un ami d'enfance était là. Si Mohamed Zermouh, de même que le bataillon de choc de Chaïb Mohand Ourabah superbement armé d'une partie des mitrailleuses d'El Hourane, y étaient installés quand nous sommes arrivés. Je me rappelle encore ma surprise d'apercevoir le lieutenant Chaïb Mohand Ourabah, se promenant imprudemment au village, sans kachabia, son uniforme et son calot rouge visibles pour n'importe quel observateur des camps avoisinants et notamment celui d'Ighzer-Amokrane.
Le lendemain de notre arrivée, vers 8 h du matin, le chasseur T6, l'obsession de tout Moudjahid, fit son apparition au dessus du village et les sentinelles signalèrent l'arrivée d'un peloton de l'armée française.

Les djounoud du bataillon de choc se déployèrent, l'un après l'autre, pour éviter d'attirer la mitraille du T6 et allèrent à la rencontre des soldats français qu'ils attendirent, embusqués derrière les maigres buissons de la région ou derrière les murettes de clôture de séparation des champs de figuiers et d'oliviers. Si Amirouche et notre petit groupe s'éparpillèrent et montèrent vers les crêtes mieux pourvues de bruyères et d'oliviers touffus. Le T6 piqua vers nous et je me rappelle encore la crispation de tout mon corps et le tremblement qui envahit brusquement mes genoux, lorsque je me rendis compte que la crosse de ma mitraillette qui faisait une bosse énorme sous ma kachabia allait déclencher la mitraille de la du chasseur.
Mais une fusillade nourrie se fit soudain entendre bas, à l'orée du village et le T6 vira vers l'accrochage. Notre petit groupe grimpa encore de quelques centaines de mètres et s'installa sous les chênes. Plus haut que nous, se dressaient les pitons dénudés du Djurdjura derrière lequel se nichait le village d'Aït Zikki. Mais il était hors de question de tenter de l'atteindre avec les B26 qui venaient de faire leur apparition et les obus de canons de 105 qui se mirent à pleuvoir sans relâche. Je fis connaissance ce jour-là pour la première fois avec le napalm et pour la nième fois avec «l'ajel», le destin.
Les B26 comme des oiseaux d'enfer tournoyaient au dessus de nous et larguaient leur cargaison mortelle. Les obus de 105 explosaient de plus en plus près de nous comme si, connaissant notre position exacte, les artilleurs ajustaient le tir. Curieusement, nous n'observâmes pas les règles habituelles de maintien d'espace entre nous. Le danger était si proche, si présent que les membres de notre groupe de cinq - Si Amirouche, ses deux aides-de-camp, Tayeb Mouri , Abdel Hamid Mehdi, Rachid Laïchour, la liaison de la Wilaya et moi - étions littéralement soudés les uns aux autres. Chacun de nous, silencieux comme dans une prière, s'efforçait de puiser dans l'autre le courage nécessaire pour rester digne et s'empêcher de trembler.
J'eus l'impression, à ce moment-là que ma vie, ou plutôt l'ébauche de vie, allait s'achever d'un moment à l'autre, qu'elle était entièrement derrière moi. Elle était scellée, cachetée et empaquetée et le paquet prêt à être expédié chez le Tout-Puissant. Il y avait dans ce paquet bien des choses inachevées, inaccomplies, des désirs inassouvis, des rêves d'amour romantique jamais réalisés. Au terme d'une vie si vide, si courte, j'en demeurai persuadé, j'aurais voulu dire : c'était une belle vie, mais ni moi, ni personne ne pouvaient porter un tel jugement sur elle. Ce n'était qu'une esquisse, si peu dégauchie que l’armada française n'allait avoir aucun scrupule à l’anéantir.
Les obus de 105 annoncés par un sifflement effrayant explosaient alentour dans un bruit assourdissant, projetant leurs éclats et pulvérisant les rochers. Je reçus ma première (et seule) blessure de la guerre, légère, provoquant une bosse sous mon calot. Un fragment de rocher projeté en l'air par le souffle puissant d'une explosion me toucha à la tête. Je me palpai et, me voyant sans doute pâlir, Si Amirouche, imperturbable sous les bombardements, plus que jamais paternel, me demanda d’une voix douce :
«Thougadhedh e-h ? (Tu as peur hein ?)
- Non, Si Amirouche, je n'ai pas peur», mentis-je.
Pour Si Amirouche, les obus de 105 n'étaient rien d'autre que du bruit, déplaisant tout au plus pour les oreilles sensibles. Toute la journée, les canons et les B26 de l'armée coloniale pilonnèrent sans relâche nos positions et larguèrent leurs barils de napalm.
…
Hamou AMIROUCHE
Un an avec le Colonel Amirouche
Casbah Éditions
2009, Alger
08:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
13/10/2012
IHITOUSSEN, le village des forgerons (Hamou AMIROUCHE) 2
...
Les frères travaillaient d'arrache-pied durant la saison des labours, d'octobre à février, à forger principalement des socs pour araires, puis ils rentraient chez eux pour trois mois avant de retourner début mai façonner des faucilles ou des fourches pour la saison des moissons, et clouer des fers aux ânes, mulets et chevaux. Avant d'entamer le dur apprentissage de la forge, à l'âge de treize ans, mon père eut la chance rare de fréquenter l'école de trois classes, d'Aït Ikhlef qui desservait tous les «Aït Idjer», une région qui s'étendait de Hora et Aït Ghovri à l'Est jusqu'à Ifigha à l'Ouest. Il put ainsi apprendre quelques rudiments de lecture et d'écriture qui devaient déterminer l'essentiel de sa vie et de son destin.
C'est ainsi qu'il apprit en déchiffrant le journal quotidien à Saint Arnaud (El Eulma) qu'un besoin de main-d'œuvre en France se faisait cruellement sentir, sitôt la guerre de 14-18 terminée. Un cousin lointain, Hamadache, du village voisin, Ivouyisfen, installé comme gargotier à Marseille, l'encouragea à tenter l'aventure. Il décida d'en parler à son père : «Si tu permets, Vava, il y a à peine de quoi occuper Arezki et Mohand dans cette forge. Avec ta permission et ta bénédiction, Rabah et moi pourrions tenter notre chance en France.» «Vous êtes trop jeunes pour partir si loin». «Non, vava ; fais-nous confiance» répondit doucement mon père. Je parle leur langue. «À deux, on s'en sortira.»
Mon père considérait qu'il était hors de question de partir sans la bénédiction de mon grand-père, à même de conjurer les malheurs : trop de fils furent broyés par une calamité aussi soudaine que prévisible quand la malédiction des parents, «ed'oussou», était lâchée sur eux sans retenue. C'est ainsi que mon père et son frère Rabah âgés respectivement de 16 et 18 ans franchirent la Méditerranée en 1920. Après un court séjour à la gargote de Hamadache à Marseille, où ils servirent les repas en échange du gîte et de la nourriture, ils se retrouvèrent à Clermont-Ferrand aux usines Michelin. Très vite, ouvriers spécialisés affectés au tournage, leurs économies transférées à Ihitoussen permirent à leur père d'acquérir trois champs de figuiers et... la première vache de l'histoire du village.
Quand elle arriva, escortée par une douzaine de parents et cousins de Mohand, et intriguée par tant de sollicitude, le village lui réserva un accueil triomphal et entra en ébullition. «C'est l'équivalent de dix chèvres» murmurait-on. «Oui, mais le goût du lait de chèvre est incomparable». D'autres voyaient déjà au-delà du lait et du beurre et salivaient à l'idée d'un couscous gigantesque offert à toute la tribu. «D'accord, mais la viande est bien meilleure pour la sauce de couscous». Finalement, la vache séjourna très peu dans le village montagneux où il n'était pas question de la laisser dehors exposée aux attaques de chacals ni dedans où l'étable minuscule permettait à peine d'accommoder une chèvre et son petit. Elle fut sacrifiée à l'occasion d'une «Thimachrat», une fête traditionnelle qui permettait à chaque famille moyennant une somme d'argent d'avoir sa part de viande.
Les deux frères travaillèrent trois ans dans les usines de Michelin. Mon oncle Rabah, des années après, ne tarissait pas d'éloges pour la région de Clermont-Ferrand où les pommiers et poiriers poussaient «dans la forêt» et permettaient chaque dimanche, pendant la saison de remplir des sacoches de «frouits» mûrs et parfumés. Puis l'ordre d'appel au service militaire força mon père à rentrer au pays en 1921. La guerre du Rif au Maroc venait d'éclater et elle suscita un engouement singulier mais mitigé chez mon père. Pendant qu'il effectuait son service militaire, à Dellys, il se demandait avec une grande appréhension s'il n'allait pas devenir le deuxième insoumis de la famille au cas où il serait envoyé au Maroc combattre Abdelkrim, futur héros d'épopée qui devait tailler en pièces une colonne de l'armée espagnole dans le Rif.
En effet, je l'appris des années après, une armée espagnole forte de 60.000 hommes fut presque totalement anéantie dans la bataille d'Anoual et le général Sylvestre qui la commandait devait se suicider. Il fallut l'intervention de la France, puissance occupante, qui craignait la «contagion» et ne reculant pas devant l'utilisation d'armes chimiques pour vaincre les troupes rifaines en 1924.
Ce qui sauva mon père fut, nul doute, son niveau d'instruction. Il fut promu «caporal d'ordinaire», chargé de l'intendance et échappa à la terrible épreuve d'affronter ses frères et redoutables guerriers qui, d'après la légende ne tiraient jamais une balle avant de lui murmurer «wakeltlek Rabbi wa n'bi idha ma jit'ch fel ham aw filaâdham» (Dieu et le Prophète te demanderont des comptes si tu ne te loges pas dans la chair ou l'os de l'ennemi). Naturellement, jamais il n'aurait imaginé que des Marocains, conduits par leur officier français, allaient un jour de mai 1945 envahir et dûment piller sa demeure et assister, sans état d'âme, à son supplice devant sa famille éplorée et impuissante.
Démobilisé en 1924 ou 1925, il repartit en France, cette fois-ci seul et à Paris où, en sa qualité de forgeron, il fut embauché encore comme ouvrier spécialisé. C'est là que son destin devait emprunter le tournant décisif qui imprima un souffle nouveau à son existence même si sa famille devait quelque peu en pâtir. Tout commença, d'après mon père, en 1925 quand l'Etoile Nord-africaine (ENA) naquit des cerveaux de quelques nationalistes menés par l'Emir Khaled et Hadj Ali Abdelkader. Apparue dans le cadre d'une association satellite du Parti Communiste Français, «l'Union inter coloniale», qui regroupait les ouvriers originaires des pays colonisés,
Hamou AMIROUCHE
Un an avec le Colonel Amirouche
Casbah Éditions
2009, Alger
Chapitre 2
IHITOUSSEN, LE VILLAGE D'ORIGINE DES FORGERONS D'ALGÉRIE
08:14 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
08/10/2012
IHITOUSSEN, le village des forgerons (Hamou AMIROUCHE) 1
«There is no present or future, only the past happening over and over again»*
(Il n'y a ni présent ni avenir, il y a seulement le passé se reproduisant indéfiniment)
* Eugene O'Neill évoquant l'Irlande sous occupation anglaise.
Ahitous, mon père, tenait son surnom de son village Ihitoussen où il était né le 24 février 1904. Perché sur un piton d'argile et de rocaille, à l'instar de tous les villages kabyles, Ihitoussen dominait en contrebas les maigres parcelles de terre parsemées de figuiers et d'oliviers qui avaient cessé d'être nourriciers depuis bien longtemps. La quasi-indifférence dont ces terres ingrates étaient gratifiées, sauf en automne où les figues fraîches commençaient à mûrir, les ravalait automatiquement au niveau de la responsabilité des femmes. Celles-ci, véritables bêtes de somme, souvent s'occupaient de jardinage, près des sources, d'un peu d'agriculture de subsistance, toujours de l'orge plus frugale que le blé, de la corvée de bois et d'eau quasi-quotidienne. On apercevait parfois leurs silhouettes au loin, en pantalon bouffant, moissonnant et même menant d'une main ferme le mulet ou l'âne — les bœufs étant rares dans ces contrées — sur l'aire de battage. En hiver elles faisaient la cueillette des olives, produisaient une ou deux jarres d'huile qui devaient impérativement tenir jusqu'à la récolte suivante. Le tissage de burnous, de couvertures et de l'inévitable tapis artistique (akhellal) que les filles emportent avec elle au moment de leur mariage servait de «loisirs» durant les rudes hivers, presque toujours enneigés d'Ihitoussen, et complétait l'autarcie des familles. Je garde encore le souvenir vivace et ému d'une tante aux yeux d'un vert extraordinaire, veuve, célèbre au village d'Es'Sahel au bord de l'Oued Sebaou pour les melons, pastèques et légumes qu'elle produisait et acheminait elle-même sur le marché hebdomadaire de Tslatha à Aït Ikhlef.
Ahitous, mon père, était le quatrième fils d'une famille de quatre garçons et une fille. Cette dernière, comme vexée par l'indifférence affective mêlée d'hostilité qui l'accueillit à sa naissance, malgré son nom, Aziza, (aimée) tombait souvent malade et, chose étrange qui avait frappé l'imagination des parents, quelques jours avant sa mort, elle s'était mise à fredonner sans cesse le chant funèbre traditionnel malgré les exhortations sévères de ma grand-mère très superstitieuse, qui y voyait un mauvais présage.
Aziza ne tarda pas à s'éteindre à l'âge de cinq ans, victime d'une terrible épidémie de typhus. Elle fut ensevelie discrètement dans une fosse minuscule, creusée par mon grand-père lui-même, au cimetière Ebbwanar sur une crête qui domine la vallée du Haut Sébaou et qui offre, lorsqu'on n'est pas affamé, l'un des plus beaux paysages offerts par la nature.
Aziza n'eut pas droit à la litanie mortuaire rituelle ni au cortège funèbre réservés aux adultes, et seul, le chant des cigales dans la canicule inhabituelle au pied du Djurdjura l'accompagna dans son sommeil éternel. De l'au-delà, elle dut être bien surprise, cependant, par les larmes de mon grand-père qui perlèrent brièvement sur un visage impassible, selon ma grand'mère, alors qu'il la portait lui-même, enveloppée dans un minuscule linceul de drap blanc, à sa dernière demeure. La sélection naturelle, bien qu'un peu assistée, respectait les coutumes en choisissant d'emporter une fille qui, de surcroît était «tsavarkant» brune.
Souvent, d'ailleurs, survivance d'une pratique païenne, pour influer sur les décisions divines, on mettait des boucles d'oreilles aux garçons, pensant que Dieu, les prenant pour des filles allait dédaigner de les rappeler à Lui. Les quatre garçons survécurent grâce à une maigre pitance à base de glands séchés, moulus et mélangés à un peu d'orge, de figues sèches et d'huile d'olive, mais surtout grâce à la chèvre, souvent le plus important membre de la famille.
Mais comme il arrive à toute communauté humaine ou groupement animal, lorsque la subsistance menace de se tarir, on quitte le terroir où l'on a vu le jour. Le père Boudjemaâ, forgeron à l'instar de ses ancêtres depuis la nuit des temps, décida un jour de partir «a r waaraven», chez «les Arabes» comme on disait à l'époque, avec ses quatre fils. Ce qui précipita son départ fut la mobilisation forcée, introduite soudain par le colonisateur pour la guerre 14-18 et qui toucha son fils cadet Arezki, le premier insoumis de la région d'Aït Idjer. Il quitta les confins rocheux de sa Kabylie natale et se rendit, avec ses fils à pied, à mulet et en train à Saint-Arnaud (El Eulma) où il ouvrit un atelier de forge. À peine installé, en 1916, il apprit des paysans que des révoltes avaient éclaté partout dans les Aurès contre la mobilisation forcée des Chaouis, ce qui augmenta encore ses appréhensions pour son fils.
Il eut alors l'idée judicieuse de contacter lui-même les gendarmes de «Satarno» (Saint-Arnaud) et de se faire connaître : «Voilà, je suis forgeron, maréchal-ferrant et je suis installé à la sortie Est du village», annonça-t-il au chef de brigade. «Et alors ? D'abord, d'où es-tu et d'où viens-tu ?» «Je suis kabyle», chef. «Et qu'est-ce que tu veux ?» «Je sais que vous avez des chevaux. Amenez-les-moi quand vous voulez. Je leur forgerai de beaux fers tout neufs.»
Comme il ne faisait jamais payer les gendarmes pour ses services, et peut-être parce que son fils avait la peau bien claire et les yeux bleus, Arezki ne fut jamais interpellé ou questionné sur sa situation militaire. Hélas, très peu de temps après, mon grand-père contracta une grave maladie des yeux, probablement le trachome, et perdit la vue. Il fut raccompagné à Ihitoussen, cloîtré dans sa demeure nuit et jour, sauf le vendredi, où un membre de la famille l'accompagnait à la mosquée.
Un an avec le Colonel Amirouche
Casbah Éditions
2009, Alger
Chapitre 2
IHITOUSSEN, LE VILLAGE D'ORIGINE DES FORGERONS D'ALGÉRIE
09:36 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook