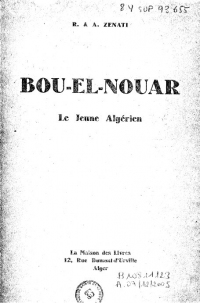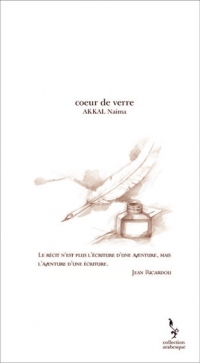14/07/2011
Bou-El-Nouar et l’école (ZENATI Rabah et Akli)
Chapitre IV
I
Si Tayeb, le taleb, ne niait pas l'esprit curieux de Bou-El-Nouar. C'était le trait essentiel de l'intelligence de l'enfant. Le maître du Koutab fut vite frappé de cette particularité malgré son manque d'intuition, son peu d'élan vers les nouveautés, son attachement têtu aux vieilles connaissances orthodoxes de son enseignement. Les élèves réduits au rôle d'appareils enregistreurs ne trouvaient un sens à tout ce dont on meublait leur mémoire que très longtemps après leur sortie de l'école coranique et encore quand ils n'avaient pas interrompu leurs études.
Bou-El-Nouar étonnait son maître par ses spirituelles réparties, par les questions aussi judicieusement posées que celle-ci :
" Que signifie ce que je viens de réciter ? Pourquoi n’avons-nous pas des livres comme à l'école française ? Pourquoi les petits Français comprennent-ils ce qu'ils apprennent et nous rien ? "
C'étaient des dispositions étrangères à des bambins de son âge, habitués à un travail de mémoire souvent en défaut devant l’aridité des textes. Aussi le fils Boudiaf inquiétait-il un peu le taleb toujours impressionné par les réponses surprenantes de son élève. Il disait souvent que Bou-El-Nouar n'était pas un élève comme les autres ; non seulement il apprenait très vite mais il raisonnait surtout pomme une grande personne.
Depuis quelques jours il tombait, lorsqu'il rentrait à la maison, dans un silence marqué d'une certaine nervosité contraire à son tempérament. Après le souper, dans la salle commune il s'approchait de son père comme s'il voulait lui dire quelque chose, s'en éloignait, puis renouvelait ce manège plusieurs fois avant d'aller se coucher. Boudiaf ne s'apercevait de rien, mais sa mère, mise en éveil par ce va-et-vient insolite, le suivait avec attention. Son instinct l'avertissait que son fils était en proie à un trouble dont elle ne percevait pas exactement la cause. Un soir Bou-El-Nouar n'y tint plus. Après avoir touché à peine aux aliments, très ému et presque tremblant, il dit brusquement â son père :
— Je voudrais te dire quelque chose, mais promets-moi de ne pas me gronder.
— Dis toujours, nous verrons après, répondit Boudiaf.
— Je crains que tu ne me refuses ce que je désire.
— Si tu me laisses dans l'ignorance de ce que tu veux de moi, je ne risque pas de te donner satisfaction !
— Je ne sais ce qu'il a, intervint Fatma. Depuis quelques jours, je le vois tourner, virer, s'énerver sans motifs apparents. J'ai failli t'en prévenir.
— Parle donc, reprit le père.
— Je ne peux pas, les mots ne viennent pas.
— Alors va te coucher.
Bou-El-Nouar se disposait à sortir quand sa mère le retint par le bras. Elle l'encouragea à parler. Il hésita encore, pétrissant d'une main inquiète sa gorge serrée par l'émotion. Les caresses de Fatma, eurent raison de sa frayeur. Il finit par lâcher dans un souffle :
— Je voudrais aller à l'école française, comme le fils du Cadi.
— Mais, qui t'a encore mis ces idées en tête petit malheureux ? s'emporta Boudiaf. Je parie que c'est encore le Cadi, à moins que ce ne soit son fils aîné. Ce Cadi de malheur ne veut donc pas me laisser tranquille.
— Je le jure par Sidi El Hadj M'Barek, père, que je n'ai été poussé par personne.
— Comment ? tu vas me soutenir que tu as trouvé cela tout seul.
— Je voudrais faire comme les fils du Cadi et comme les fils de tous tes amis du village qui quittent la koutab à huit heures du matin pour se rendre à l'école française. Ils ont des cartables remplis de beaux livres. Ils écrivent sans qu’il soit besoin de leur tenir la main et comprennent ce qu'ils récitent.
— Tu n'as pas besoin de te farcir l'esprit et l'imagination avec toutes ces billevesées. Que tu saches faire convenablement la prière et que tu cultives bien tes champs, c'est ce qui m'importe le plus. Cela suffira d'ailleurs très largement.
— Les fils du Cadi et les autres jouent et parlent avec les petits Français.
— Tu n'as rien à faire avec ces gens là.
— Et pourquoi causes-tu toujours aux colons, toi ? Je voudrais leur parler en français comme le Cadi, et non en arabe comme tu le fais.
Boudiaf sous l'effet de ce qu'il considérait comme une insulte, faillit donner libre cours à la colère qui montait en lui. Il réussit à maîtriser son courroux, mais envoya son fils à tous les diables.
II
Boudiaf n'était guère préparé aux nouvelles perspectives dévoilées par son fils. Il croyait perpétuer les anciennes traditions de sa famille en ne livrant rien au hasard, en se méfiant de toutes les nouveautés, considérant comme hautement respectable tout ce qu'avaient accompli ses ancêtres. Il aimait souvent à répéter comme un principe immuable cette phrase qui, pour lui, résumait toute la vie :
"Les anciens ont tout dit, tout fait, tout prévu. Ce serait une vanité malsaine que de déranger l'ordre établi depuis des siècles, de renoncer aux vieilles coutumes pour des habitudes excentriques dont l'utilité reste à démontrer et qui, par dessus tout, ne sont pas les nôtres, Profitons plutôt de l'enseignement que nous ont laissé ceux qui nous ont précédés et demeurons dans la voie que nous a si bien tracée le dernier des Prophètes."
Bou-El-Nouar
La Maison des Livres ; Alger
1945
07:51 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook
Facebook
11/07/2011
OUALI et l’Amin CHALLAL (Ali MEBTOUCHE)
Si Ouali avait déjà une bonne réputation auprès de son entourage, sa renommée s'accrut encore après cet exploit : il avait su abattre à lui seul cinq bêtes fauves qui, depuis des années, faisaient des ravages parmi le bétail de cette contrée ! La nouvelle se répandit partout et arriva même jusqu'aux oreilles du caïd de la commune, et surtout à celles de l'amin du village voisin nommé Ifuzar, chargé par l'administration de traiter les affaires courantes indigènes. Ce dernier, un indigène du nom de Challal, était très connu pour les méthodes barbares qu'il exerçait sur les plus démunis, pour les faire travailler dans les champs de ses maîtres colonialistes. Il payait ses ouvriers au rabais, sans éprouver aucune pitié, leur faisant moissonner d'immenses champs de céréales. Quand ils fauchaient le blé, l'orge ou le maïs, à l'aide de leurs faucilles, gare à celui qui n'arrivait pas à suivre les cadences : le « chien de garde» des colons était derrière les moissonneurs, une cravache à la main, pour infliger des sévices corporels aux plus lents. Tous les paysans qui étaient obligés de travailler sous ses ordres pour subvenir aux besoins de leur famille se souvenaient de ces procédés inhumains. Cet amin, du nom de Challal, faisait comme tous ceux qui servaient la France coloniale. Il n'hésitait pas à rançonner les indigènes. Pour un oui ou pour un non, il mettait ces pauvres paysans à l'amende, ne serait-ce que pour les déposséder de leur unique chèvre ou de leur unique brebis, pis encore, s'ils possédaient une vache à lait. Malgré tous ces procédés abusifs, personne n'avait jamais osé lever le petit doigt pour le punir, tant ses victimes avaient peur de la justice coloniale.
Qui dit justice coloniale dit «guillotine». Ce monstre coupeur de têtes, installé dans la ville d'Azazga au lendemain de la conquête de la Kabylie, terrorisait en effet toute la population. Depuis qu'il avait menacé, en l'an 1845, le peuple de Kabylie, en jurant haut et fort : «J'entrerai dans vos maisons, je brûlerai vos villages et je couperai vos arbres fruitiers», le général Bugeaud était entré dans la légende, dans le langage kabyle, sous le nom de bichuh (bête méchante). Le mot « Ifinga » (la guillotine), quant à lui, désignait pour les autochtones le châtiment suprême.
Toutes les terres gérées par ce Challal au service des colons appartenaient autrefois à des dizaines de familles qu'on avait expropriées, à l'arrivée des Français, au bénéfice d'une seule famille dont le patriarche était un caïd nommé par l'administration coloniale.
Dans cette vallée nommée Zawya, tout près de la rivière de l'Oued Sibaou et de la ville de Makouda, la France avait attribué des dizaines d'hectares de terre, les plus fertiles de cette contrée, à une seule tribu du nom de Si Moh Ouchikh. Cette famille de religieux, dont le patriarche était un caïd, servi par des amins souvent issus de leur famille, comme Challal, prospérait grâce au système colonial. D'ailleurs, à l'aide des privilèges que la France de cette époque avait accordés à cette famille, cette dernière vit, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, sous la présidence de Boumediene, l'un de ses enfants devenir ministre des transports.
Ces gens qui se sentaient tout-puissants grâce à leurs maîtres, les colons, agissaient sur les paysans de leur commune comme au temps des rois féodaux, pour exploiter, sans aucun état d'âme, les plus démunis. Personne n'osait lever le petit doigt pour protester contre leurs méthodes tellement ils les terrorisaient en s'appuyant sur les lois coloniales. Dans cette riche vallée, devenue le domaine de la famille du caïd Si Moh Ouchikh, on cultivait des légumes verts, des primeurs, en passant par des céréales, jusqu'aux melons et aux pastèques, et le tout poussait en abondance...
Après cette action menée contre des bêtes sauvages qui, à cette époque, faisaient trembler les hommes les plus courageux, Ouali acquit une grande notoriété auprès de toute la population. Il était devenu un personnage charismatique. De partout, les habitants d'Aït Aïssa Mimoun se répandaient en éloges en faveur de leur héros tueur de lions. Toutes ces louanges irritèrent profondément l'administrateur colonial, l'amin. Si auparavant les deux hommes se haïssaient, à cause de leurs différences, la tension n'avait fait que s'accroître entre les deux protagonistes depuis cette affaire. Challal, l'abominable exploiteur du peuple, décida de tout faire pour chercher querelle à Ouali, afin de le traduire devant la justice de ses amis colonialistes ... d'autant plus que leurs villages se faisaient face. Seule une petite rivière coulant au fond d'un ravin les séparait.
Pour chercher noise à Ouali, l'amin Challal s'acharna un jour sur la tante de celui-ci. Pour une histoire ridicule, il la rabroua de sa grosse voix, devant de nombreux témoins ! Le plus grave, c'est qu'il en était arrivé aux mains en la secouant par la manche de sa robe! Il lui reprochait d'avoir laissé son âne brouter quelques bouchées d'herbe de son champ qui donnait sur un chemin public. La malheureuse, qui était rentrée en pleurant, avait caché cet incident pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, mais les témoins présents s'étaient hâtés de rapporter les faits aux oreilles de Ouali. Celui-ci voulut venger l'honneur de sa tante, mais les sages de son village le raisonnèrent en lui conseillant de ne pas tomber dans la provocation, et l'histoire en resta là...
En dépit de tous les témoignages de sympathie affichés par les villageois à son égard, Ouali continua de mener sa dure vie de paysan. Par fierté, et malgré la misère qui le tiraillait, comme tout le monde, Ouali ne voulait pas s'agenouiller et participer au ramassage des récoltes organisé chaque année par l'administrateur, l'amin Challal, dans le domaine de la famille Si Moh Ouchikh. Il préférait travailler dans des endroits très abrupts, pour débroussailler ses lopins de terre envahis de rochers, de bosquets de toutes sortes qu'il fallait déraciner, afin d'y semer quelques mètres carrés de blé, d'orge et de fèves.
…
Pour l’honneur d’un village
Éditions Kirigraphaires
2011
Pages 20 à 23
Livre en vente ici :
http://www.edkiro.fr/pour-l-honneur-d-un-village/
09:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
04/07/2011
L'Aigle de minuit (Naïma AKKAL)
« L’Aigle de minuit »
Au bout de la nuit,
J’entends un triste chant,
Sous le bruit de la pluie,
J’entends un cri d’enfant,
Un cri d’amour,
Un cri de détresse
Petit orphelin de cœur,
Petit ange du malheur,
Que le temps a laissé,
Derrière les barreaux de l’oubli…
Pourquoi ce monde est-il injuste ?
Pourquoi le sang est-il si brusque ?
Que l’on n’a pas le temps de rire,
Que l’on n’a pas le temps de dire,
Que l’on n’a pas le temps d’aimer,
Petite vie si fragile,
Comme un éclat de verre,
Petit orphelin de guerre,
Qui n’a plus personne sur terre,
La solitude le mène,
Vers un monde lointain,
Que son triste destin,
Reste l’allié des chagrins,
À pas de géants vers la victoire,
Des hommes si froids sans âme ni cœur,
Ils cherchent à tracer l’histoire,
Avec les larmes d’un enfant.
…
Cœur de verre
TheBookEdition
2011
Livre en vente en ligne :
http://www.thebookedition.fr/coeur-de-verre-akkal-naima-p-62954.html
08:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
28/06/2011
La Vie est un grand mensonge (Youcef ZIREM) 2
Extrait
…
Les fleurs parfumées de l’œillet parsèment les nuits de Farid. Un rêve étrange. Toujours le même, chaque soir. Un rêve qui l’éloigne considérablement de son quotidien morose. Un rêve pour lequel il donnerait même sa vie pour qu’il se réalise un jour. Un jeune homme, un civil, un collier d’œillets autour du cou, est élu président de la République, il y a seulement un bout de temps. Il se débrouille fort bien et il a beaucoup de punch. Pourtant, au second tour des élections présidentielles, il n’avait battu son adversaire, de trois ans son aîné, que de quelques milliers de voix. Le choix fut difficile. Le souvenir des précédentes présidentielles, peu heureuses, est ainsi effacé. Depuis que les vieux responsables politiques et militaires ont été mis à la retraite, le pays a retrouvé la paix et la santé. Les barons de ce que l’on appelait le système ont été jugés et ont écopé de sanctions qu’ils ont amplement méritées. Auparavant, plus dure que cela a été l’élection d’une assemblée constituante, laquelle a laborieusement doté la République de lois claires et incontournables. Ainsi, la séparation du religieux et du politique a été clairement prononcée. À un certain moment, quelques illuminés essayèrent de parler d’État islamique mais leur discours fut rejeté par la population. Il est bien loin le temps où ils récupéraient aisément le mécontentement populaire. Désormais, ce ne sont plus les mêmes qui sont au pouvoir et, pour une fois depuis l’indépendance, les gouvernants sont véritablement légitimes. La crise de logement n’est plus aussi aiguë. Les milliers de logements inoccupés d’Alger sont maintenant habités. La même opération a été réalisée dans les autres villes du pays. L’argent transféré dans les banques suisses par les anciens dirigeants est aujourd’hui propriété du peuple. Les femmes sont heureuses et libérées ; le code de la famille n’est plus qu’un lointain mauvais souvenir. Le secteur du bâtiment carbure à pleine vitesse, de nombreux jeunes y sont récemment employés. L’impôt sur la fortune est opérationnel et participe à l’instauration d’une allocation chômage raisonnable. Les travailleurs de la terre et du domaine touristique voient s’ouvrir devant eux de nouvelles perspectives. L’or noir se vend bien et la compagnie pétrolière nationale a triplé sa production après avoir doublé ses effectifs. À plusieurs niveaux, une grande partie des gestionnaires ont été remplacés par ceux qui n’ont jamais trempé dans des combines douteuses. Les entrepreneurs privés sont encouragés et la bureaucratie est combattue d’une manière intransigeante. Les syndicats sont libres et ne sont pas dirigés par ceux qui ont fait leurs classes au sein du parti unique. Même la presse est incommensurablement libre et déjà plusieurs quotidiens ont augmenté leur tirage. Des publications nouvelles et de niveau sont sur les étals des buralistes et dialoguent réellement avec la population. Il est vrai aussi que leurs journalistes n’ont rien à voir avec la triste école du Tout va bien. Les Droits de l’homme sont scrupuleusement respectés et la torture, qui jadis avait fait ravage, est définitivement bannie. La justice est indépendante et ce n’est pas un vain slogan. Le pays est rempli de couleurs chatoyantes, le rire est revenu et la joie de vivre retrouve ses habitudes d’autrefois. À l’université, l’intelligence refait progressivement surface. Les sciences et la technologie y sont enseignées en français et en anglais, ce qui ne diminue en rien le mérite des deux langues nationales que sont l’arabe et le berbère. Le régionalisme a tendance à s’effriter vu que la médiocrité et la kleptocratie ne règnent pas. Les trabendistes ( trafiquants en argot algérien ) en tous genres sont mal vus. La culture reprend ses droits, les maisons d’édition ne chôment pas, leur activité est encouragée. En un laps de temps, ceux qui étaient privés de parole parce qu’ils n’avaient pas un nom ou parce qu’ils pensaient différemment sont publiés. C’est alors un foisonnement de créations éblouissantes. Beaucoup d’exilés sont revenus. Ceux qui étaient convaincus que rien ne changerait, un jour, au pays de leurs ancêtres, perçoivent la situation d’une autre manière et ont confiance en la jeune équipe dirigeante nouvellement élue. Ils ont décidé de ne plus repartir à l’étranger. « Le pays a besoin de toutes ses filles et tous ses fils », avait dit le jeune président de la République dans son premier discours. Son appel a eu des échos favorables. « C’est un rêve magique mais apparemment impossible et c’est terrible »‚ se dit à lui-même Farid.
La Vie est un grand mensonge
Éditions Zirem 116 pages,
Prix: 260 DA
Date de parution: septembre 2005
07:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
21/06/2011
La vie est un grand mensonge (Youcef ZIREM) 1
Extrait 1 :
…
« Tel un forcené, Nacer monte rapidement les escaliers du pavillon de l’Institut du pétrole. Arrivé au quatrième étage, en un laps de temps, il est au bout du couloir où se trouve la chambre commune à Jeff et à Farid. Sans frapper à la porte, il y entre avec un terrible fracas. À bout de souffle, il s’écrie : « les frérots, les sales frérots ! » Allongés confortablement sur leurs lits respectifs, Farid savourait une chronique ciné de l’inimitable Serge Daney, parue dans Libération de la veille, tandis que Jeff terminait de lire Désert. À la vue de Nacer, hors de ses états, ils se relèvent d’un seul coup, prêts à la riposte.
- Les frérots, les sales frérots ! continue de râler Nacer.
- Qu’est-ce qu’ils ont encore fait ces frères musulmans de malheur ? questionne violemment Farid.
- Ils ont tué un étudiant, ils l’ont sabré.
- Où ça ? Comment est-ce que cela est arrivé ? demande avec une grande anxiété Jeff.
- À l’université de Ben Aknoun ; ils ont mis fin à sa vie parce qu’il avait affiché un appel à l’assemblée générale pour le renouvellement démocratique du comité de cité, bredouille Nacer.
- Et les gens du Mouvement, qu’ont-ils fait ? interroge Farid.
-Ils ont essayé de se défendre mais en vain. Les barbus étaient plus nombreux. Ils avaient des renforts importants. Leurs complices non-étudiants étaient une légion. Ils avaient des couteaux, des sabres, des haches.
Tout de suite après, Farid et ses deux amis sont dans les rues de Sedrem. La cité-dortoir est encore calme. Les habitants vaquent normalement à leurs occupations, cependant les Land Rover de la gendarmerie vont et s’en viennent d’une manière inhabituelle. En fin de journée, la triste nouvelle se propage dans toute la région. Les visages deviennent effarés, les regards torves sont à chaque coin de rue, les allusions à la vengeance, à peine voilées, sont sur beaucoup de lèvres. Les islamistes se font prudents et se regroupent dans les locaux qu’ils ont aménagés en mosquées. La nuit venue, les gendarmes de Sedrem découvrent dans la cour de l’Institut des industries légères un fourgon bourré d’explosifs et d’armes blanches, appartenant aux barbus. Les gendarmes ne font rien du tout. L’ordre vient d’en haut : il faut prêter main forte aux islamistes, il faut les aider afin qu’ils détruisent la revendication identitaire berbère. Le lendemain matin, Jeff et Farid sèchent leurs cours et prennent le train à destination de Tizi-Ouzou, la métropole kabyle. À leur arrivée au centre universitaire de Hasnaoua, des milliers de personnes sont déjà là. Elles attendent les moyens de transport en direction du village meurtri de Tiferdoudt. Sur ces collines oubliées, elles vont saluer pour la dernière fois, Amzal Kamel, lâchement assassiné le 2 novembre 1982, à l’âge de vingt-deux ans. »
La Vie est un grand mensonge
Éditions Zirem 116 pages,
Prix: 260 DA
Date de parution: septembre 2005
07:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook