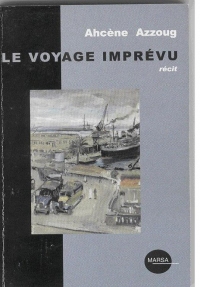24/09/2012
Le voyage imprévu (Ahcène AZZOUG)
« Citons le cas de ma famille : ma femme et moi étant originaires du même village nous discutons en kabyle. Lorsque notre première fille est née, nous l’avons bercée avec la langue kabyle. Ses premières paroles étaient en kabyle. Les dessins animés en français, comme l’école maternelle n’ont pas détrôné le parler de la famille. Elle s’est trouvée, sans le savoir, bilingue à l’âge de 3-4 ans. Elle avait ses propres repères : parler en kabyle à la maison et en français dehors.
C’est après la naissance de ses frères et sœurs que tout s’est redéfini autrement. Pourtant nous avions essayé de garder le kabyle à la maison et le français à l’école, dehors, et à la télé. Les enfants parlaient entre eux en français. Il nous semblait que les deux langues coopéraient. Nous n’avions pas prêté attention à ces perpétuelles rentrées scolaires, les croyants bénéfiques. Nous voyions d’un bon œil les progrès de nos enfants qui communiquaient en français sans accent. Nous avons aidé nos enfants à faire leurs devoirs et apprendre les leçons.
La langue française de l’extérieur a commencé à prédominer. C’est la langue kabyle de la maison qui a fini par sortir. Mais pour aller où ? À sa perte ! Elle n’a pas sa place dehors non plus ! Nous avons retrouvé notre langue sous le paillasson. Plus grave : c’est avec nos séjours de vacances au pays que nous constations l’importance des dégâts, insurmontables par nous seuls, les parents. Seul son enseignement comme celui des autres langues pouvait la sauver. Avions-nous une part de responsabilité ? Etait-ce la conséquence de nos erreurs ? Etait-ce lâcheté de notre part ? C’est ce qu’on nous reproche parfois.
Nous avons tenté de remettre notre langue kabyle à la place qui lui revenait. Mais notre médiocre pédagogie ne pouvait rivaliser avec celle de l’école et de ses professionnels. Il est devenu presque normal d’entendre les adultes parler en kabyle à leurs enfants et les enfants leur répondre en français. Ils tiennent une conversation en deux langues. Nos compatriotes du pays rigolent bien de nous.
Les victimes sont plus encore les enfants d’Algériens berbérophones qu’arabophones. En effet, ces derniers ont plus de chance : la mosquée donne lieu à des échanges entre adultes et à l’alphabétisation en langue arabe. De plus, les parents équipent leurs téléviseurs d’antennes paraboliques leur permettant de capter de nombreuses chaînes qui émettent en arabe. Ils peuvent ainsi suivre les différentes émissions et mesurer la nécessité de savoir parler sa langue. Les enfants kabyles, et berbères en général, ne disposent d’aucune aide. Des associations visant à développer la pratique de la langue se multiplient, mais leurs maigres moyens ne leur permettent pas d’égaler l’enseignement officiel et les technologies à sa disposition. Quelques associations tentent d’organiser des cours de berbère (amazigh) en alphabet latin, arabe ou tifinagh. Ces initiatives sont si lourdes à assumer que, finalement, les motivations s’effritent chez les organisateurs comme chez ceux qui veulent apprendre. »
Observations : « Des lumineux paysages de Kabylie aux brumes de l’Est français, des durs ateliers de Peugeot aux drames du village natal, c’est tout un pan de la mémoire centenaire de l’immigration algérienne que brosse Le voyage imprévu. Ce récit fourmillant d’anecdotes d’ici et de là-bas, relate petits bonheurs et grandes souffrances, et pose des questions importantes sur les relations entre les communautés. » (Note de l’éditeur).
Ahcène Azzoug, émigré algérien, ouvrier chez Peugeot à Montbéliard depuis sa jeunesse, a participé au débat sur « L’écrivain-migrant » organisé à l’occasion du Salon du livre des droits de l’Homme dédié au thème « Migrations, les mots et les cris » (Paris, Février 2006). Son livre est épuisé… À quand une édition française ?
Le voyage imprévu
Pages 99-101
Éditions Marsa
Alger, 2003
07:28 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
19/09/2012
Itinéraire d'une Femme kabyle (Zehira KARA) 2
… Je ne retrouve pas cette atmosphère d’autrefois, parce que les visages de ceux que j’ai aimés ne sont plus là …
On se remémore le souvenir pour dire que nous ne les avions pas oubliés. Le savent-ils ? Mais savent ils aussi que, sans eux, on vit autrement, que leur absence nous pèse et que des années après on n’a toujours pas fait le deuil et, par moment, on croit entendre leur voix, leur rire, leurs pas. On croit voir leurs silhouettes, leurs gestes dans la pénombre, dans le clair obscur. Je me souviens de l’enterrement de mon père ; il est mort sans que j’aie eu l’occasion de son vivant de le voir une seule fois. Il est mort au maquis, m’a-t-on dit bien plus tard après sa mort. Un jour en rentrant à la maison j’ai trouvé du monde ; c’était la première année de l’indépendance. Nous habitions la villa Joseph Jacob ; je crois bien du moins c’est ce que ma grand-mère disait. J’étais curieuse de voir en face de moi ce fameux JOSEPH JACOB pour lui dire que sa villa était trop belle, enfin bref. Je ne me souviendrai jamais de la date. J’ai compris que je ne verrai jamais mon père. Il était dans un petit cercueil en bois couvert du drapeau algérien.
Il n y’avait pas que mon père. Il y avait deux de ses compagnons que l’on n’avait pas réussi à identifier. Quant à mon père, il ne l’avait été que grâce à sa montre dont seule ma grand-mère détenait le secret. Elle ne pouvait donc ne pas le reconnaître. J’étais petite, moi. J’avais 6 ans ; je me souviens de ma mère et de ma grand-mère qui pleuraient ; je pleurais, moi aussi, mais je ne savais si je pleurais parce que ma mère pleurait, ou bien si je pleurais ce père que je ne connaissais pas. J’essayais de comprendre le pourquoi de mes larmes. Était-ce des larmes de contagion ou bien ceux d’une fillette fragile, à qui sa mère et sa grand-mère faisaient beaucoup de peine, car je savais malgré mon très jeune âge que pleurer était une façon d’extérioriser sa douleur. Les larmes de ma mère et de ma grand-mère avaient pour effet d’initier ma sensibilité aux émotions, une sorte d’entraînement, car pour moi, la dépouille que contenait ce corbillard n’avait pas une grande signification, même si tout le monde, autour de moi, avait l’inébranlable conviction que les restes de mon papa reposaient bel et bien au fond de cette boite étrange, peut être vermoulu ou encore complètement pulvérisé. Je me posais la question, si l’on pouvait en effet pleurer un père que l’on ne connaissait point. Mes sanglots secouaient mon petit corps chétif …..
Je pleurais et ces larmes me paraissaient justifiées plus tard mais dans un autre sens que personne ne pouvait deviner. Elles ont eu raison de couler sur mes joues parce que le destin allait me réserver bien des souffrances. On enterre mon père et ses compagnons ; une vie vient de se terminer pour moi, celle de petite fille insouciante, inconsciente, une autre, impitoyable vient de commencer, celle de la prise de conscience, des choses sérieuses, des tracas de la vie, des imprévus dangereux pour la frêle créature féminine que j’étais. Au cimetière des Chouhadas, pendant longtemps, ma mère Fatma et moi et ma grand-mère nous allions chaque AÏD visiter les tombes de mon père et de ses deux compagnons. Chaque occasion de fête de l’Aïd, je lui posais cette question curieuse de façon récurrente « Et si tu étais là, papa, mon amour ? »
J’ai aimé Tadmaït dès que j’ai ouvert les yeux, j’ai aimé ses gens, j’ai aimé tout ce qui m’entourait, j’ai amé le parfum des fleurs des orangers qui nous parvenait des vergers du bord du Sébaou, j’ai aimé le bruit du vent dans les eucalyptus quand, avec ma grand-mère, nous allions récupérer du bois. J’aimais ces aubes ou parfois nous nous réveillions très tôt et allions ramasser des olives. OH ! Qu’il était bon le pain que nous mangions !
Zehira KARA
Itinéraire d'une Femme kabyle de 1962 à nos jours. Tadmaït-Nanterre (Récit)
Éditions L’Harmattan
Paris. 2009
09:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
13/09/2012
Itinéraire d'une Femme kabyle (Zehira KARA) 1
Ça déballe ça court, ça dérange. J’aime quand ça dérange. J’aime les parfums enivrants qui viennent de loin, de l’enfance innocente et insouciante. J’aime ces nuages de poussière et le bruit des sabots au moment où le bétail rejoint son écurie. J’aime ces détours quand je suis à califourchon sur un âne, ma tête couverte d’un chapeau de paille. Nous arrivons enfin à la maison où ma tante et ma grand-mère maternelle nous attendaient sur le pas de la porte. Des bassins d’eau nous accueillaient pour nous débarbouiller, nous dégraisser conviendrait mieux. Ensemble, MERZOUK, MELHA, mon oncle OUALI et naturellement ma sœur FADMA. J’aime à me replonger dans ces moments quand ma tante nous tendait ces beignets chauds ! On se gavait vraiment. Ils sont drôlement bons, très sucrés, ces gâteaux traditionnels. Ce qui convenait parfaitement à nos caprices d’enfants.
Le soir tombé, le paysage qui s’offrait à nous était féerique. Les derniers rayons de soleil caressent la surface de la rivière. Mon Dieu ! que tout ça dure ! comme une sorte d’héritage, toute ma vie future ; ça vient de mon berceau, à ma naissance… Moi qui suis privée du moindre souvenir du sourire paternel, je retrouve, en échange celui la nature divine qui m’envoûte et me procure une joie immense que je savoure en cachette, à l’intérieur de moi-même. C’est peut être cela le bonheur.
Nous sommes maintenant autour du kanoun. C’est le moment des devinettes. Elles fusent comme des flèches de partout. Nos esprits étaient intensément sollicités. C’est un véritable concours qui s’organisait spontanément, et de façon très ordonnée. Très tard dans la nuit, quand tout le monde est lassé, bercé par le sommeil, c’est à ce moment que je me glissais entre tante Melha et Fadma, j’écoutais et alors que la fatigue me brisait, les images de la course pour récupérer les agneaux sous les oliviers finissaient par me vider de mes dernières énergies. Pour manger, je me rappelle bien : je tendais la main mais je n’arrivais pas à porter la cuillère à la bouche, morte de fatigue. Je me laissais alors, volontiers tomber dans les bras de Morphée.
On se lève le matin, une fois de plus le soleil jette son dévolu sur l’oued Sebaou. Il est à moitié vide ; c’est l’été et dans les grandes crevasses remplies d’eau paisibles, les écailles de poissons d’eau douce étincellent aux rayons du soleil argenté. L’horizon est cerné par un fond d’un vert d’orangers ; je me frotte les yeux. La nuit, j’ai beaucoup dormi et j’ai crié dans mon sommeil « Yemma ! », Melha me réveilla, alluma la lampe à pétrole, me rassura et je me rendormis aussitôt, blottie contre son corps chaud.
Comme je voudrais repartir dans ce monde. Redécouvrir encore et encore cet amour qui m’a permis de tenir sur mes jambes fragiles. Les après-midis, nous jouions aux osselets à l’ombre des vergers pendant que les adultes faisaient la sieste. Le parfum des poiriers, des grenadiers nous enivrent mais nous n’avions pas le droit de cueillir ces fruits qui n’étaient pas encore mûrs. Hélas ! L’interdiction n’était jamais respectée car c’était moi-même qui cueillais ces fruits « défendus ». Alors, pour ne pas être grondés, on ménageait l’humeur des adultes en enterrant les pelures des grenades qu’on dégustait.
Qu’est ce que j’aimais Jeddi, ce vieillard aux cheveux argentés ! Qu’est ce que j’aimais ses retours de marché quand dans ses énormes poches, sous son burnous blanc je trouvais les bonbons qu’il nous achetait. Je m’endormis ce soir, je fermais les yeux sur les visages de ceux que j’aimais dans mon enfance, ces visages, ces sourires qui m’avaient fait oublier le froid, la faim, qui m’avaient essuyé les larmes …
Quelques mois après l’indépendance, je ne me souvenais point de la guerre. Les images qui me revenaient étaient celles des premiers jours de la fin de cette guerre qu’on disait atroce, de camions remplis de gens allant manifester leur joie partout.
Quel bonheur d’être un peuple libre !
Mais hélas, pour ne plus jamais l’être par la suite. …
Je profite de ces jours pour me reposer, je suis très fatiguée, Décembre est un mois que je déteste ; je déteste les jours de fête, je déteste aussi les retrouvailles en famille parce que je ne retrouve pas cette atmosphère d’autrefois, parce que les visages de ceux que j’ai aimés ne sont plus là …
Itinéraire d'une Femme kabyle de 1962 à nos jours. Tadmaït-Nanterre (Récit)
Éditions L’Harmattan
Paris. 2009
09:07 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
06/09/2012
Chronique québecquoise (Arthur BUIES)
Chronique québecquoise
30 août 1906
Faire une chronique québecquoise n’implique pas nécessairement qu’on soit à Québec. Pour le commun des lecteurs cette nécessité semble absolue ; mais le journaliste s’affranchit aisément du despotisme des titres, et son imagination doit être aussi libre que sa profession. Le chroniqueur surtout a un sublime dédain du convenu, ce tyran universel ; il dit ce qu’il veut quand il veut, comme il veut. Donc, je date aujourd’hui ma chronique québecquoise de Saint-Thomas, comté de Montmagny, à dix lieues de la capitale.
Puisque je ne suis pas à Québec, j’ai le droit d’avoir des idées à moi. Or, une de mes idées en ce moment, c’est que je voudrais bien être un habitant de Mycone, l’une des îles Cyclades, dans le Levant. Là, paraît-il, la nouvelle mariée, en arrivant à la demeure nuptiale, trouve au seuil de la porte un crible sur lequel elle doit marcher en entrant. Si le crible ne se brise pas sous ses pieds, le mari conserve des doutes sur la candeur de son épouse.
Ceci est logique ; on s’accorde à ne pas admettre la vertu chez la femme légère ; or, une femme légère courrait grand risque de ne pas défoncer le crible ; donc, la femme lourde offre toutes les garanties désirables. Une femme lourde, bien nourrie, bien épaisse, est donc le desideratum de tout épouseur tant soit peu soupçonneux.
Cela m’a donné à réfléchir, à moi qui suis célibataire, Dieu merci, et quelque peu incrédule, et j’ai résolu de ne plus voyager qu’avec une balance, en cas que la faiblesse commune à tant de mes semblables s’emparât aussi de moi.
Dire qu’il y a un moyen si simple d’être à jamais fixé sur son sort, et que si peu de gens l’emploient !...
Chaque pays cependant a ses moeurs ; il y en a, comme le Canada, où les femmes sont si vertueuses, si fidèles, qu’on peut les épouser sans les peser. À propos de moeurs, il y en a parfois de singulières. Ainsi, sur la côte du Zanguebar, en Afrique, le mari est tenu, le jour de ses noces, de se mettre un emplâtre de farine sur l’oeil gauche. Cela est bien inutile, puisque, lorsqu’on épouse, on est généralement aveugle. Mais pourquoi cet emplâtre sur l’oeil gauche plutôt que sur l’oeil droit, et pourquoi de la farine plutôt que de la sciure de bois ou du papier mâché ? Ô mystères profonds du coeur humain ! Soyez donc philosophe pour rester coi devant un emplâtre !...
Dans la Kabylie, toujours en Afrique, pays bien éloigné de nous heureusement, la jeune fille ne quitte le voile épais qui couvre son visage qu’après que les noces sont consommées. Le marié peut crier au voleur tant qu’il lui plaît, il est trop tard. Trop tard ! c’est le mot que Ledru-Rollin fit entendre d’une voix de stentor, à la tribune française, après la déchéance de Louis-Philippe, et lorsqu’il s’agissait de placer sur le trône son petit-fils, le comte de Paris. Vous saisissez l’analogie ?...
Du reste, dans les pays civilisés, dont le Canada constitue une infime molécule, si les jeunes filles ne gardent pas un voile sempiternel, elles ont en revanche de faux chignons, de fausses dents, de faux... Je ne m’arrêterais plus ; tout est fausseté, tout est mensonge, excepté les discours d’un conseiller législatif.
* * *
Chroniques 1
Humeurs et caprices
1906-08-30
09:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
02/09/2012
Le puits des Anges (Slimane SAADOUN) 3
…
Derrière nous, la lumière s'éteint. Les vieux se sont mis au lit. Mohd de la main nous demande de baisser la voix.
- Tu connais Ibn Toumert … intervient Ali.
On ne sait s'il pose une question ou s'il fait une constatation. Il pose sa guitare à côté de lui contre le mur de la maison.
- Tu es professeur d'histoire, poursuit- il, en s'adressant à Yug. Comme moi...
Il a un ton calme, comme d'habitude. Parfois une intonation brise le tempo monocorde de la voix, mais il se ressaisit et il reprend le contrôle. À l'entendre parler, on est fasciné parfois plus par le ton de sa voix que par ce qu'il dit. Comme Mohd, il semble porter le deuil d'un malheur. Comme Mohd, et comme des milliers de jeunes hommes et d'adolescents de la région, il avait été emmené dans une brigade en ce mois de mai 1980. En vérité, cette épreuve était comme un rite initiatique pour leur génération : quiconque a vécu cette période, même de loin, semble diffuser une espèce de nimbe romantique, de rayonnement fascinant, un attrait mystérieux. Des milliers et des milliers de lycéens et d'étudiants avaient jeté leur insouciance juvénile par dessus l'épaule, emprunté un air soucieux et déterminé et franchi tous ensemble, d'un bond, le passage à l'âge adulte. Ils avaient défilé durant des jours et des jours, scandé des cris de colère et de révolte, hurlé leur désir de vivre librement leur identité. La nuit, pendant que les sentinelles faisaient le guet pour prévenir l'irruption des gendarmes et de leurs chiens, on discutait, autour de feux de bois allumés dans des fûts, on faisait l'apprentissage de la parole, de l'échange ; on se réappropriait les gestes et les attitudes de la djema. C'était fini ; il n'était plus question que de vieux maquisards incultes et mégalomanes continuent à gérer le pays comme une épicerie familiale. C'était fini, on ne pouvait plus reculer ; il y a eu trop de morts, trop d'humiliations ! On avait perdu la liberté depuis des décennies ; depuis des lustres s'effilochait inexorablement leur âme avec leur culture. Qu'avait-on à perdre désormais ? «Vous pouvez tirer, criaient-ils aux gendarmes ; nous sommes déjà morts!». Et les balles fusaient.
À sa sortie, Ali avait refusé de raconter ce qu'il avait enduré. Sauf à Mohd et à moi. Par besoin de se confier, d'alléger le poids de sa détresse. Mais, contrairement à Mohd, il avait su reprendre le cours normal de la vie, du moins en apparence, peut-être grâce a ses études. Une fois celles-ci terminées, il avait commencé à enseigner l'histoire et la géographie dans un lycée de la région et il ne subsistait qu'une ride profonde à son front qui pouvait encore témoigner qu'il avait traversé une épreuve terrible. Les choses avaient commencé à mal tourner pour lui lorsque, petit à petit, son intérêt pour la forteresse en ruines s'était étendu par la force des choses, à d'autres sujets qui s'étaient avérés plus enrichissants. Ali s'était mis à vérifier la réalité des quarante Saints de Hizer, de ce légendaire Hizer qui avait dompté une ogresse et en avait fait son épouse et la mère de sa descendance. Puis, il avait entrepris de recueillir les poésies, les contes et les légendes du terroir. D'où sa faculté à parler un berbère châtié, que beaucoup d'entre nous, qui chevauchons sur deux langues à la fois, parfois trois, lui envions. Il lui avait fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'on lui reprochait de trop chercher à remuer le passé. L'histoire commence à la date fixée par les autorités. Au-delà, c'est de la subversion, pas de l'histoire. Les autorités n'aiment pas l'archéologie.
- Tu sais combien ces gens sont rusés et fourbes, continue-t-il. Ibn Toumert était un homme pieux, honnête, totalement détaché des choses de ce monde. Mais il n'a pas hésité à faire tuer sept mille de ses meilleurs soldats par un stratagème abominable.
Le jeune homme ne prend pas souvent la parole, mais quand cela lui arrive, il ne manque jamais de nous étonner.
- L’Histoire nous le présente comme un saint homme, ce qu’il est sans doute, continue Ali. Mais n'a-t-il pas abusé de l'ignorance et de la crédulité des gens ?
- Mon pauvre ami, fait Yug, qui commence à bredouiller légèrement. Quel homme d'État, quel personnage historique n'a pas trompé son peuple ?
- Nous sommes à l'époque des droits de l'homme, réplique Ali. Les chefs sont jugés à leur aune. Il a réussi avec la complicité de l'un de ses hommes de main, El Wancharissi, à éliminer ses ennemis, du moins ceux qu'il considérait comme tels, en les jetant dans un précipice.
À un moment donné, légèrement grisé, je suis sur le point de m'esclaffer : la situation est surréaliste ! Ali, le timide Ali nous fait un cours d'histoire au milieu d'une nuit froide de janvier, illuminée par des millions de lucioles de neige.
- Grâce à des anges placés au fond d'un puits, Ibn Toumert obtient confirmation qu'El Wancharissi a obtenu de Dieu le don de distinguer les Réprouvés des Justes. L'homme de main fait ainsi le tri. Les mauvais sont jetés dans un précipice.
Yug hausse dédaigneusement les épaules.
- Et alors ? dit-il.
- Alors, dis-je, c'est que tous les moyens sont bons pour ces gens-là. Seule la fin compte. Ils sont même capables de faire apparaître le nom de Dieu dans le ciel d'Alger et de faire croire à la foule crédule qu'il s'agit d'un miracle.
Slimane SAADOUN
Le puits des Anges
Éditions L’Harmattan 2003
Collection Écritures berbères
09:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook