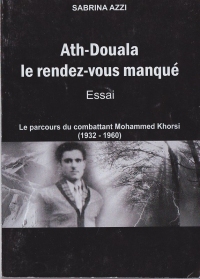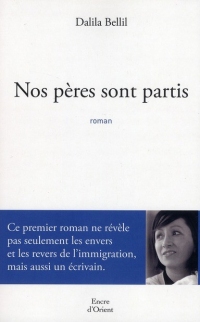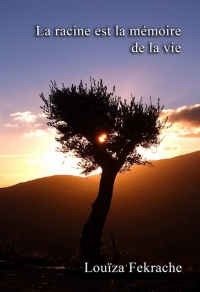17/11/2012
Même pour ne pas vaincre (Stéphane CHAUMET) 1
...
Et quelle dose de phantasme ou d'exotisme l'un envers l'autre, l'uniforme du militaire, sa jeunesse virile et douce, la Kabyle aux yeux verts cernés de noir, ses tresses, ses bracelets aux chevilles, ses bijoux d'argent avec des émaux, ses tuniques à fleurs...
« Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Elle a peur, elle sait ce que cela signifie pour elle, ici le déshonneur se lave dans le sang. Elle connaît l'histoire de cette fille d'un autre village, les rumeurs circulent aussi vite que le vent, enceinte d'un officier français elle s'était réfugiée dans la SAS qu'il dirigeait. Le clan rival de sa famille se réjouissait de ce déshonneur qui les éclaboussait tous, qu'elle mette au monde un bâtard. Mais le médecin de la SAS l'a avortée. C'est le clan rival, frustré de sa joie, qui a tué l'officier et le médecin s'en est sorti avec une balle dans l'épaule. Quant à la fille, ses propres frères s'en étaient chargés. Ma mère au lieu de fuir a dissimulé d'abord sa grossesse, elle ne voulait pas avorter. Son mari est venu en permission de sa harka pour deux jours, elle a fait croire par la suite qu'elle était enceinte de lui. Son mari n'a eu aucun doute, mais avant qu'elle n'accouche il est tombé aux mains des combattants algériens, avec d'autres harkis, tous torturés, tous exécutés.
« Un jour un gamin a accouru à l'infirmerie en criant Sania, vite, vite ! Il s'est précipité et devant la porte de la maison il a entendu des hurlements saccadés, aigus, des râles. Instinctivement il a sorti son arme, on était en train de la torturer. Et c'était moi ! Ma mère, suspendue à une poutre, maintenue sous les aisselles par un harnais de chiffons noués ensemble, toute pâle, dégoulinante, frissonnante, la tête projetée en arrière à chaque contraction violente, ses jupes relevées au-dessus de la taille. Entre ses cuisses mouillées de sueur, le pied d'un bébé. Le mien ! La sage-femme du village semblait ne plus savoir quoi faire. La soeur de ma mère lui épongeait parfois le visage, ma grand-mère était concentrée sur son rituel d'accouchement. Il est allé lui-même chercher le médecin. Il fallait l'hospitaliser d'urgence, si on forçait je risquais de m'étrangler avec le cordon. Dans cette position, impossible de la faire entrer dans la voiture, c'est sur la plate-forme d'un camion qu'on l'a installée, le médecin avec elle, et son militaire a pris le volant jusqu'à l'hôpital de Tizi-Ouzou. Je ne sais pas si ce sont les cahots de la route qui m'ont remise dans le bon sens ou poussée dehors, mais je suis sortie avant d'atteindre l'hôpital ! En tout cas je commençais ma vie à l'image de ce qu'elle allait être, bien secouée.
« La France à ce moment-là avait déjà pris la décision de quitter l'Algérie. Ceux de la SAS, un peu désorganisée depuis la mort du lieutenant, se préparaient à partir. L'amant de ma mère savait qu'ils avaient l'ordre de récupérer avant le départ les armes de tous les moghaznis. Leur rapatriement n'avait pas été prévu. Le nouvel officier affecté à la SAS et chargé du repli n'avait pas d'état d'âme, les ordres sont les ordres. Il n'a pas hésité un instant à employer la ruse pour désarmer les supplétifs, en leur faisant croire qu'il s'agissait seulement de remplacer leurs armes. Tout le village a vu comment, à l'arrivée des camions pour les militaires et le matériel, on a empêché les moghaznis d'y monter, tout le village a vu et ressenti la panique, la rage impuissante et le désespoir dans les yeux de ces hommes à l'instant où ils ont compris à quoi la France qu'ils avaient servie les destinait. Les villageois ont été épargnés, mais les supplétifs qui n'ont pas pu fuir ont été massacrés parle FLN. Certains jetés vivants dans l'eau bouillante, certains abandonnés au soleil, en pleine montagne, après leur avoir brisé les bras et les jambes.
Même pour ne pas vaincre
Éditions du Seuil
Paris. 2011
06:22 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
12/11/2012
Mohammed KHORSI, Moudjahid (Sabrina AZZI)
Mohammed n'eut jamais l'opportunité d'avoir un fusil ou savoir comment l'utiliser ; de surcroît, il ne passa pas son service militaire vu que son père n'était pas au pays ; donc il était le soutien de famille .Les moudjahiddines, pour mieux s'assurer de son courage et à quel point il tenait à rejoindre le maquis, exigèrent de lui faire descendre El Moukhtar qui se trouvait à Tizi Hibel ; ce dernier était l'écrivain public de la région.
Il passa toute la veille en ruminant comment procéder pour accomplir cette mission ?
…
Il se leva très tôt, s'apprêta à mettre en train sa tâche, et d'un air angoissé, il dit à sa femme :
- Où tu as mis le châle que je t'ai offert récemment ? S'il te plait tu me le donnes.
Chabha sans lui demander son besoin pour ce châle se précipita et le lui donna. Il ne lui a rien dit de crainte de la tourmenter. Il la connaissait très bien, elle essaierait de l'empêcher d'y aller. Il préféra avoir la bouche cousue que de perdre du temps ; tôt ou tard, elle le saurait. Il prit le châle, le mit dans sa poche et déguerpit.
À Tizi Hibel, il ne rencontra aucune difficulté pour trouver le bureau de travail d'El Moukhtar : c'était un homme que tout le monde connaissait ; il aidait les Français comme il aidait les Algériens. Il était bien connu par tous les villageois. Il frappa à la porte,
- Entrez ! cria El Moukhtar
- Bonjour, je suis bien au bureau de monsieur El Moukhtar ? dit Mohammed
- Oui, de quoi pourrai-je vous servir ? : rétorqua-t-il sans même lever la tête.
Dans la salle où fut El Moukhtar, se trouvait sa petite fille qui, à l'entrée de Mohammed, prit la porte.
- Vous m'écrivez une lettre à mon chef de travail ? S'il vous plait !
- Votre carte d'identité monsieur ?
- La voici !
El Moukhtar était un homme qui avait une très grande expérience en ce qui concernait les guerres. Il était dans les rangs français durant la deuxième guerre mondiale ; il pouvait sentir le danger de loin. Quoiqu'il fût du côté des Français, il ne s'était jamais montré hostile ni méprisant envers les Algériens. Il remarqua un certain embarras sur le visage de Mohammed ; il remarqua aussi un changement dans son comportement. Il saisit une feuille vierge, et dès qu'il s'était mis à écrire, il aperçut Mohammed en train de chercher quelque chose qui était coincé dans sa ceinture. Mohammed prit le pistolet que les moudjahiddines lui avaient donné pour cette mission, et tira sur lui. El Moukhtar était malin et vigilant : avant que la balle ne sortit du fusil, il bouscula vers lui le bureau pour l’entraver et la balle fut tirée dans le vide...
Dès que Mohammed appuya sur la détente du fusil, il décampa laissant sur le bureau sa carte d'identité et se dirigea directement vers Takrart. À sa grande surprise, il aperçut de loin qu'il était encerclé ; une fourmilière de soldats entourait le village. Il changea vite de destination. Arrivé à Tizi Msbaa Iberdan, un carrefour où sept chemins s'entrecroisent, il trouva les Français et, sans perdre aucune seconde, prit la fuite. Les Français le poursuivirent et tirèrent sur lui sans l'atteindre. Animé de sa foi et de son courage, il ripostait en se dirigeant vers Thala Khellil où se trouvait le chef de front.
Exsangue de fatigue, il parlait avec peine « je veux rejoindre le maquis ! »
Le chef de front étonné de sa décision (il était jeune pour supporter les affres de la guerre) lui dit :
- Est ce que tes parents savent ce que tu comptes faire ?
- Mon père est en France, et ma mère sait bien qu'il viendra le jour où je sortirai au maquis, mais pour l'instant elle n'en sait rien. Et après tout, je n'ai pas besoin de leur approbation pour que je fasse ce que je veux, pour que je défende mon pays, non... ! Je suis assez responsable, me parait-il !
El Moukhtar déposa plainte, et sa petite fille affirma que, s'ils l'attrapaient, elle le reconnaîtrait indubitablement. Mohammed bien qu'il avait le châle, vu l'anxiété qui s'était accaparée de lui, avait omis de recourir à son utilisation pour dissimuler son visage.
Désormais, Mohammed était recherché par les Français. Sa mère s'affola quand elle fut mise au courant. … Sa femme Chabha, devenue pâle sous le choc, n'avait jamais pensé qu'il allait le faire ; elle ne prenait pas ses propos au sérieux. C'est vrai qu'il avait l'habitude de parler de la révolution et de son envie de devenir un maquisard ; mais pas si vite !
…
Mohammed concrétisa son rêve en 1955. Il endossa enfin l'uniforme des moudjahiddines …
Ath-Douala, le rendez-vous manqué
Chapitre 3 (Extraits)
ISBN : 978-9947-0-2194-1
2008
06:58 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook
Facebook
07/11/2012
Nos pères sont partis (Dalila BELLIL) 2
Letrre de Boufarik (Suite)
…
Quelques années auparavant, ami Ahmed était parti « travailler à gagner de l'argent » en France. Il n'était rentré au pays que lorsque Jidah lui avait annoncé avoir trouvé une épouse pour lui. Son retour signifiait le départ de mon père, son frère cadet. Pour éviter la dispersion des hommes du village, un relais avait été instauré au sein des familles. Ami Nourredine, le plus jeune de mes oncles, qui avait trouvé une bonne situation dans l'administration d'une ville voisine, fut épargné par cette fatalité qui expédiait nos hommes au loin. Leur immigration était très organisée: une fois en France, les nouveaux arrivants étaient accueillis par leurs cousins du village et partageaient le même foyer, le même hôtel. Personne n'était laissé seul. L'exil était trop douloureux pour s'ajouter à la solitude.
Certains immigrés avaient construit des villas de plusieurs étages qui renvoyaient à la préhistoire nos modestes habitations traditionnelles. On murmurait dans les rues du village que ces ambitieuses demeures n'avaient pu voir le jour que parce que Madame travaillait. Ces rumeurs faisaient s'esclaffer nos gens qui trouvaient l'idée aussi extravagante qu'insensée. C'était pourtant un fait avéré. Certaines immigrées gardaient les enfants des roumis ou faisaient le ménage chez les roumis. À Céf, quand elles arrivaient, vêtues de pantalons, les cheveux colorés non plus au henné mais à la teinture chimique, nous nous frottions les yeux, tentant de discerner sous leur allure occidentale les héritières de notre reine Dihya. Qu'elles étaient loin, les pauvres fatmas effrayées qui avaient quitté le bled, les yeux pleins de larmes et le coeur déchiré ! Elles affichaient désormais des airs victorieux, des dents en or et riaient fort, ne se gênant nullement de la compagnie des hommes. Quand elles nous hélaient, nous demandant un service ou nous offrant des friandises, nous rougissions très fort, intimidées de parler à ces belles étrangères. En revanche, je ne me souviens pas avoir ressenti le moindre embarras avec ta mère.
Nous passions nos soirées près du qanoun (foyer), écoutant dans un silence impressionné les histoires que jidah Tassadit savait si bien raconter. Parfois, les femmes de la maison se réunissaient et confectionnaient des couvertures, des châles et des chaussettes épaisses pour supporter les rigueurs de choi. Tout en travaillant, elles chantaient des airs anciens qui me bouleversaient. À la belle saison, nous profitions de la douceur des nuits, nous réunissant dans oufrag installées sur des tapis, nous contemplions le ciel et les étoiles, cherchant du regard les anges et les dieux qui peuplaient les récits de jidah Tassadit.

Quand mon père introduisit le poste de télévision qu'il avait acheté en France, se rendit-il compte qu'il allait initier une mutation irréversible dans notre mode de vie ? Tel un mauvais sort, il envoûta les esprits et séduisit les cœurs. Personne n'écoutait plus les histoires de jidah Tassadit. La télévision en proposait chaque jour de nouvelles, autrement plus belles et surprenantes ! Nous fûmes parmi les premières familles du village à être équipées d'un poste, de dimension modeste et en noir et blanc. Ma mère n'était pas peu fière d'accueillir les voisins curieux de découvrir cette invention moderne dont tout le monde disait tant de bien. Combien de fois ai-je retenu mon bras qui n'aspirait qu'à culbuter l'appareil et lui faire rendre l'âme ? Ma lâcheté ne changea rien au changement amorcé. La télévision avait gagné.
Adieu nos belles histoires et nos veillées, adieu nos soirées sous la lune, nos moments de joie entre femmes, adieu nos jeux d'enfants, la télévision nous éloigna, nous laissant seuls, face à elle.
Qu'Allah te guide et te préserve, Dahbia.
…
Dalila BELLIL
Nos pères sont partis
Pages 58 à 62
Éditions Encre d’Orient
2011
09:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
02/11/2012
Nos pères sont partis (Dalila BELLIL) 1
Lettre de Boufarik
Boufarik, le 8 février
Chère Soltana,
Kaïna, dont la famille est originaire de nos contrées, m'a demandé de lui parler de notre village. Elle semble avoir pris goût à nos échanges. La pauvre, elle est née à Alger et n'a jamais mis les pieds en Kabylie. Quel malheur !
Te souviens-tu ? Accroché sur une crête à une trentaine de kilomètres de Bougâa, notre village dominait un large panorama dont nous jouissions comme des propriétaires. Des montagnes bienveillantes aux pentes douces nous encerclaient et offraient à notre bled un écrin imprenable. Le temps semblait n'avoir de prise ni sur elles ni sur nous. Nous défions le temps, fiers de notre caractère farouche et de notre passé d'invaincus. Notre âme est faite pour résister. Nous comptions demeurer là aussi longtemps qu'Allah le permettrait.
Une unique piste rocailleuse conduisait avec mauvaise grâce les rares véhicules qui se lançaient vers notre nid d'aigle. Nous observions la montée, curieux de savoir vers quelle maison la voiture se dirigeait, enviant ceux que l'étranger de passage honorerait de sa visite. À part Céf, où la saison des mariages apportait un sursaut de vie, nous avions peu d'occasions de divertissement. Les jours s'écoulaient dans une tranquille langueur, troublée seulement par le bruit des animaux, les ahans des paysans aux prises avec le dur labeur dans les champs, la marche joyeuse des enfants vers l'école. Nous accueillions avec exubérance le passage de l'aâttar (le marchand ambulant), qui nous apportait, à dos d'âne, des babioles venues d'Alger ou de Tizi-Ouzou. Les femmes envoyaient leurs enfants lui acheter du khôl, des robes, de la bijouterie de pacotille, des onguents, des cassettes de musique. Quand le commerçant avait disparu, le village retombait dans sa torpeur et s'assoupissait jusqu'à la prochaine visite.
Notre demeure surplombait une colline aux pentes sèches et rocailleuses. Maison traditionnelle au toit de tuiles rouges bâtie à l'ombre d'immenses figuiers de Barbarie, elle comportait plusieurs bâtiments. De grosses pierres nous protégeaient des fortes chaleurs. L’ensemble suintait la fatigue ; le soleil avait blanchi les murs crépis ; les fortes pluies des mois de choi (l’hiver) avaient abîmé le toit en de nombreux endroits, si bien qu'il arrivait souvent que l'eau s'invite parmi nous. Plusieurs tentatives de réparation de mes oncles se révélèrent de véritables désastres qui ne firent qu'aggraver les dégâts. Oufrag (la cour intérieure) accueillait nos jeux bruyants. Depuis toujours, ma mère souffrait de migraines intenses qui lui rendaient insupportables nos cris. Nous avions donc pris l'habitude de jouer en silence retenant avec peine nos éclats de rire. Malheur à celui qui aurait oublié cette règle ! Une savate atterrissait violemment sur sa tête pour lui rafraîchir la mémoire.
La maison appartenait à mes grands-parents paternels. Nous partagions l'espace avec eux, les deux frères de mon père, ami Ahmed et ami Nourredine, leurs femmes et leurs enfants.
Nous fûmes si nombreux dans cette maison avec le temps et les naissances qu'il semblait que les murs allaient s'effondrer !
...
Nos pères sont partis
Pages 58 à 62
Éditions Encre d’Orient
2011
09:00 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook
Facebook
28/10/2012
La racine est la mémoire de la vie (Louïza FEKRACHE)
Mon frère A. avait la grosse tête, des idées absurdes et voulait tout avoir sans rien faire, avoir le « pouvoir » tout simplement.
Ma mère voulait qu'il ait plus de responsabilités dans les magasins de mon père, mais celui-ci refusait tout ce qu'elle demandait en lui précisant que tout allait rester tel quel.
En septembre 1965, mon père fut obligé de partir en France pendant trois mois pour se faire soigner. Mon frère R. le remplaçait, mais ne faisait pas preuve de beaucoup d'autorité envers les autres du fait de l'absence de mon père. Personnellement, je n'ai pas de rancune envers mon frère R. qui m'accueillait au retour de l'école. Toujours triste, il travaillait de plus en plus et ne comptait que sur lui-même.
Les ouvriers l'aidaient dans son travail et ses amis le soutenaient moralement.
Lorsque j'éprouvais le besoin de parler, il venait dans la cuisine avec moi et répondait à mes questions :
« As-tu des nouvelles de papa ? »
Il me répondait :
« Tu dois être très forte, tu es une grande fille. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je ferai tout ce que je peux pour te le donner... Ne pleure pas, petite soeur, papa va bien... »
Mon frère R. me rassurait, mais a été « détruit » par un mensonge ou peut-être parce qu'il connaissait la vérité...
Au bout de quelques mois, mon père est revenu à la maison. J'en étais très heureuse, non seulement pour notre famille, mais aussi parce que mon frère A. ne pouvait plus me donner des ordres et me frapper comme il l'avait fait en l'absence de mon père.
Absence au cours de laquelle j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, mais ma mère m'avait interdit d'en parler à mon père !
Un moment donné, ma mère m'avait d'ailleurs suppliée de ne rien dire et de me taire, sous le prétexte que je devais laisser mon père se reposer quelque temps. J'ai toujours respecté ma mère, mais ce jour-là...
Mon père avait bien compris que cela n'allait pas du tout, il voulait tout savoir et savait que j'allais tout lui raconter. Ma grande sœur Z. tenait beaucoup à fêter le retour de notre père et à remercier Dieu de nous l'avoir ramené vivant. Mon frère R., sa femme, ma sœur Z. et son mari D.M. préparaient le dîner pour toute la famille et d'autres invités.
Pendant ce temps-là, ma mère parlait avec son fils préféré A. Elle lui faisait croire qu'il n'était pas considéré à sa juste valeur, mais bien comme un bon à rien ! Il croyait tout ce que ma mère disait et fit sa mauvaise tête. Bien que ce n'était ni le jour, ni le moment, il se plaignit auprès de notre père. Il lui expliquait qu'on s'occupait moins de lui, qu'il n'était pas content de travailler sous les ordres de son grand frère R., qu'il se sentait inférieur à lui et même aux ouvriers qui travaillaient pour lui. La réalité était pourtant tout autre.
Toujours bien habillé, à 18 ans, il avait déjà son permis de conduire et prenait la voiture quand il le voulait, tout en puisant de l'argent dans la caisse sans demander la permission à personne ! Il faut dire que mon père ne l'avait jamais véritablement empêché de faire cela.
Il s'est fiancé à 21 ans avec une fille du village voisin. Mon père organisa une grande fête pour célébrer le mariage en septembre 1967.
Quelques mois plus tard, en février 1968, il est parti en France pour rendre visite à son frère M. . Il y est resté deux mois et lors de son retour, mon père m'a immédiatement prévenue :
« Fais attention à toi, ma fille, il a le ventre plein... »
…
Mon frère A. aurait dû épargner un peu lorsqu'il travaillait encore chez notre père et que les affaires étaient encore florissantes.
…
Malheureusement, mon frère A. n'avait pas compris à quel point le grand frère M. pouvait être dangereux, jusqu'au jour où il découvrit que tout l'argent qu'il avait durement gagné avait disparu !
Il n'avait plus d'argent, ni chez lui, ni à la banque. Tout était parti en fumée.
La racine est la mémoire de la vie
Pages 74 à 80
Auto-Édition
Lille 2011
07:28 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook