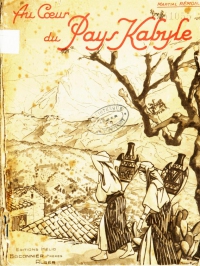30/12/2014
Quand un Nation s’éveille (Sadek HADJERES) Extrait 2
Logique cartésienne et dialectique marxiste
… À l’âge adulte, la logique cartésienne puis la dialectique marxiste étaient venues enrichir ma pensée. Elles n’ont pas soulevé en moi la révolte contre cet attachement qu’avaient les générations instruites en français qui avaient précédé la nôtre, pour les vestiges d’une culture qu’ils ne connaissaient plus que dans ses formes les plus anachroniques. Celles-ci m’amusaient parfois ; on en parlait en les raillant entre amis. Mais je crois qu’une pensée davantage libérée et mieux armée m’a aidé à mieux en comprendre la signification historique et humaine, au-delà des manifestations dérisoires dont certains de nos compatriotes parmi les « évolués » faisaient des gorges chaudes en les accablant de mépris. Sans doute est-ce aussi ce qui m’a mieux fait comprendre tout récemment comment de simples gens se cuirassent dans des réactions de défense passéistes, que les politiciens démagogues parviennent à convertir en fanatisme, faute pour les démocrates intègres d’avoir mieux perçu leur message de détresse ou de désarroi.
J’ai mieux compris pourquoi ma mère avait accordé tant de valeur à la planchette de son père qu’elle m’avait transmise, avec quelques vieux ouvrages en langue arabe jaunis par le temps. C’était tout ce qu’elle avait pu sauver de sa part d’héritage. À la mort de son frère, elle et ses autres sœurs s’étaient vues privées de par la rigueur du code coutumier kabyle et les inévitables chicanes paysannes, de tout droit sur les terres paternelles, accaparées par des collatéraux. Elle ne pleurait pas les maigres récoltes d’olives et de figues des quelques arpents de terre montagneuse. Sa révolte disait une injustice d’autant plus ressentie qu’elle n’ignorait pas l’existence d’autres normes. « Il faut qu’on revienne au chra’ [le droit] de Sidna Khlil, que les Kabyles ont abandonné, sinon nous ne serions pas de vrais musulmans », m’a-t-elle répété souvent, sans que je discerne à cette époque le sens précis de cette allusion. Les décennies de séparation ne m’ont pas permis plus tard de lui demander comment elle percevait au juste cette chari’a qu’elle appelait de ses vœux, en rapport avec son vécu. Mais je me souviens de la passion avec laquelle elle avait revendiqué sa part de patrimoine spirituel, bien décidée à défendre contre tout accaparement ces livres et manuscrits sans grande valeur marchande dont toute une petite armoire était pleine dans sa bicoque natale de Tikidount, alors qu’elle même était à peine alphabétisée en arabe. Après l’attachement à la terre, l’attachement à la culture traditionnelle était sans doute l’un des ressorts les plus profonds de notre société déstructurée.
Elle allait plus loin que la simple ferveur religieuse, cette préoccupation des vieilles gens de chez nous, que je voyais pendant mon enfance éviter de jamais laisser tomber à terre, à plus forte raison de jeter aux poubelles, le moindre petit papier portant des caractères arabes. (On protégeait de la même façon le moindre petit morceau de pain ou de galette trouvé par terre, qu’on plaçait à l’abri sur un rebord de fenêtre ou tout autre endroit propre). Quand il nous arrivait de transporter chez nous nos planchettes décorées à l’occasion de la clôture d’un hizb [chapitre] du Coran, nous les glissions sous les pans de nos vestes ou de nos qachabiyya [manteaux avec capuchons] pour les cacher aux regards indiscrets des nçara [européens]. Sous la cendre froide et désuète de ces gestes couvait une braise minuscule, humble fille des hautes flammes de la science qui éclairait le monde musulman aux temps plus obscurs du Moyen-âge européen. Après les siècles de décadence, la braise a rougeoyé de plus en plus faiblement au fond des ténèbres coloniales. À partir des années vingt, durant le XIVe siècle du calendrier hégirien, donné par les dits populaires comme celui des calamités, après les grands bouleversements qui ont affecté notre société et l’épreuve de l’immersion dans un monde tout autre, de petites flammes claires ont commencé à s’élever, que plusieurs retombées de la colonisation, en particulier le souffle de l’école française n’ont pas peu contribué à attiser.
À l’école primaire française, notre dépaysement était profond. Dans la même journée, nous exprimions des formes de respect différentes envers le lieu de nos deux scolarités successives. Pour entrer dans la salle de classe française, nous gardions nos souliers, en nous décoiffant. À l’école coranique, nous faisions exactement l’inverse : garder notre couvre-chef en nous déchaussant. Nous nous adaptions assez rapidement à ces différences pratiques, quitte à régler nos comptes avec ceux des élèves européens qui s’étaient permis des railleries sur nos comportements, en les rattrapant dehors quand le flux sortant des « classes indigènes » venait rétablir à quatre heures l’équilibre numérique.
Plus difficiles à rééquilibrer étaient les bouleversements provoqués dans nos cervelles. Nous étions certes conquis par l’atmosphère d’ordre, de discipline, la recherche de l’efficacité, le caractère vivant de l’enseignement et la richesse de ses horizons. Nous goûtions avec plaisir l’alternance des séances livresques et celles de travaux manuels, de dessin, de chant, de gymnastique, de promenades. Notre avidité d’apprendre était à la fois celle de l’enfance et de toute notre société. Quand les acquisitions de caractère scientifique étaient par trop en contradiction avec les légendes dont nous étions nourris, ces dernières cédaient le pas aux vérités d’expérience mais restaient en même temps dans nos esprits comme ces ornements qui donnent à une pièce son cachet, sa personnalité. Émerveillés par la rotondité de la terre et son mouvement autour du soleil qui expliquaient tant de choses, nous jetions quand même l’inquiétude chez nos condisciples européens quand nous leur expliquions avec la plus grande assurance que les tremblements de terre survenaient quand le bœuf qui supportait le monde donnait des signes de fatigue. Les deux communautés étant assez superstitieuses, chacun tâchait de valoriser les légendes de son bord, comme celle du père Noël à laquelle les écoliers chrétiens croyaient dur comme fer. Ces rivalités étaient sans conséquences fâcheuses, elles avaient même l’avantage d’élargir nos horizons, de nous questionner.
Il en allait autrement dès que nous abordions le terrain de la vie sociale et culturelle. Si l’enseignement des classes qui préparaient au « certificat d’études indigène » faisait un réel effort d’adaptation, qui se traduisait par un lourd paternalisme tendant à modeler une personnalité de deuxième zone sous l’aile protectrice de la France, dans les classes de l’enseignement européen, notre personnalité était brutalement prise d’assaut. La différence entre les deux enseignements s’estompait d’ailleurs dans les classes supérieures, avec l’introduction croissante de l’histoire et de l’instruction civique. La fusion des deux enseignements, prétendant exprimer un souci d’égalité, une vingtaine d’années plus tard, accentuera cette agressivité assimilationniste. Avec quels résultats ?
Quand une Nation s’éveille.
Tome 1 : 1928-1949
Éditions INAS 2014
Extrait Pages 57 et suiv.
08:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
27/11/2014
Quand une Nation s’éveille (Sadek HADJERES) Extrait 1
« Thamourth, al-blad », mon Pays, des racines séculaires aux mutations contemporaines.
… Face à des problèmes auxquels notre société n’était pas préparée, la lutte entre l’ancien et le nouveau traçait son chemin, le plus souvent à travers toutes sortes de compromis sans cesse remodelés. L’imagination des uns et des autres s’évertuait à dessiner les contours de cohabitations qui cherchaient à éviter autant que possible les explosions, les ruptures dramatiques. Ainsi était-on habitué à voir coexister à Taddert des comportements contradictoires, évitant certes de se situer aux extrêmes, sans que l’un cherchât à s’imposer à l’autre, dans les limites d’une acceptation au moins formelle des règles ancestrales auxquelles veillaient les vieux de la jem‘a.
Se situant délibérément hors de toute modernité, mais c’était peut-être aussi une question de tempérament, Zzi Muhend-Ouhemich était pratiquement invisible. Aux champs avant l’aube et de retour après le coucher du soleil, vêtu comme l’étaient déjà les paysans kabyles au siècle dernier, je ne saurais même décrire ses traits, ne l’ayant aperçu que dans la pénombre en train de décharger et desseller son mulet. Il était décédé depuis longtemps quand j’ai visité il y a quelques années son habitation restée en l’état, tout près de la bâtisse lézardée de la chambrette où je suis né, alors que, tout autour, les voisins avaient rivalisé d’innovations. Je dois dire que la conception de cette maison de type ancien où je n’avais jamais pénétré auparavant, m’avait impressionné malgré son délabrement. C’était à souhaiter que le village prenne en main sa restauration tellement l’intérieur avait gardé son caractère typique dans le meilleur sens du terme. On imagine mal évidemment un récepteur radio dans ce type de maison. Pourtant cette innovation avait d’emblée fait fureur à Taddert où de nombreux foyers s’en étaient rapidement équipés à partir de la fin des années trente. Il faut dire que ce site rural a été un des premiers électrifiés de Kabylie (avant même l’adduction d’eau) et que nombre d’appareils prévus pour 110 Volts furent mis hors d’usage dès le départ, le secteur fournissant du 220.
L’ordonnateur de ces nouveaux acquis était un de mes grands oncles, Zzi Tahar que j’ai évoqué plus haut et qui faisait figure de notable. En lui se côtoyaient la poussée de la modernité et un conservatisme avéré, par exemple envers les traditions vestimentaires : il nous réprimandait sévèrement pour tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un béret, une casquette, un chapeau ou... une tête nue. Son souci d’efficacité et d’ouverture au progrès technique était en même temps, comme chez un autre parent, accompagné d’une certaine admiration pour les performances de la « civilisation » et de l’organisation françaises, ce qui n’était pas toujours bien apprécié chez nous, parce que confondu mécaniquement avec une francophilie, une sympathie politique pour le colonisateur mécréant.
Finalement mon grand oncle Tahar reflétait les composantes et courants contradictoires de notre société. Tout en vivant sur leur ancrage traditionnel, des secteurs entiers de cette société éprouvaient un besoin avide de sortir de leur isolement par rapport au monde. J’étais étonné de constater que cette ouverture d’esprit ne se limitait pas à ceux qui avaient un degré d’instruction assez élevé. C’était ainsi le cas de Vava Saïd. Au côté de ses deux frères (Si Mohand-Saïd mon grand-père, un des premiers instituteurs algériens que nous appelions aussi Vava Hammou, et Si Tahar le notable interviewé par Albert Camus), il y avait Vava Saïd, le troisième fils moins lettré de mon arrière-grand-père Si Lvachir qui lui, s’était refusé au départ à envoyer ses enfants à l’école.
Enfants, nous adorions Vava Saïd, certes pour les bonbons-berlingots, cacahuètes et autres biscuits qu’il nous ramenait de son magasin, mais aussi parce que la douceur de son sourire et ses yeux pétillants dans un visage austère, nous faisaient accepter ses consignes, recommandations ou réprimandes les plus sévères. Paysan resté proche de ses champs, mais aussi petit commerçant dans la rue principale de l’ex-Fort National (tout près de la pharmacie Illoul et en face du commerce des Djebbar), il montait au Fort par tous les temps malgré sa santé fragile pour ouvrir son petit magasin et en revenir le soir à Taddert. L’affabilité qui le faisait aimer de ses concitoyens était en fait l’expression d’un caractère fort et intègre. Dès les débuts de l’insurrection de novembre, il était parmi les activistes discrets, efficaces et respectés. Mais lorsqu’il fut témoin d’actes et comportements contraires à l’éthique révolutionnaire telle que la confirmera la plate-forme de La Soummam, Vava Saïd n’hésita pas à faire connaître ouvertement sa désapprobation en disant aux responsables locaux : ouaggi del vattel ! (c’est de l’injustice, une atteinte envers les gens). Il le répéta à un comité de responsables qui le connaissaient mieux, venus le juger pour « indiscipline ». Sa fermeté et l’intégrité de son engagement firent que ses juges lui décernèrent seulement un « avertissement ».
À Taddert comme dans tout le pays, c’est ce sens de la justice et de la responsabilité au profond du peuple qui a permis d’atteindre l’objectif premier de l’insurrection, la défaite des colonialistes, malgré les tourments endurés.
Quand une Nation s’éveille.
Tome 1 : 1928-1949
Éditions INAS 2014
Extrait Pages 41 et suiv.
08:16 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
09/10/2014
LE COLPORTEUR GAOUAOUA (Martial RÉMOND)
Nous voici dans la région la plus peuplée de toute l'Algérie; la densité de peuplement de ses douars est telle qu'en certains points on compte jusqu'à 450 habitants au kilomètre carré (Bouakkache : 463, Ouassif : 326.)
Avant 1857, les habitants de la montagne étaient trois fois moins nombreux que maintenant ; d'épaisses broussailles couvraient de grandes étendues. Tant bien que mal, le Kabyle arrivait à tirer de son sol la maigre subsistance dont il se contentait ; son alimentation se composait surtout de couscous d'orge et de glands mélangés, de quelques légumineuses, du laitage de ses troupeaux ; la viande était rare et les friandises inconnues.
Vint une période continue de paix et de sécurité. Plus de luttes intestines entre villages ; la population s'accrut. Mais, vue l'avarice du sol, le paysan kabyle fut contraint d'aller chercher ailleurs sa pâture ; il se fit colporteur.
Au début, ce métier était considéré comme une sorte de mendicité dont on avait honte ; peu à peu, cela devint un commerce ; le colporteur s'en allait, à pied, à travers les pays arabes, vendre sa pacotille, verroterie, bimbeloterie, bijouterie grossière, pièces, médicaments, tous ces mille riens dont les femmes indigènes auraient dû se passer s'il leur avait fallu compter sur le bon vouloir de leurs maris.
Commerce de troc surtout : en échange d'une poignée de laine ou d'un œuf, le colporteur donnait un bracelet en celluloïd, un collier de verroterie ou une pince à épiler.
Il est vrai que la poudre et les armes rapportaient bien davantage !
Le colportage fut en honneur surtout dans les tribus de la montagne, dans le pays Gaouaoua, limité au Nord par les At-Yenni et les At-Khelili.
Les habitants de la moyenne montagne continuèrent, un certain temps, à vivre de leur terre, et quand, enfin, ils durent, à leur tour, aller gagner leur vie au dehors, ce fut plus spécialement vers les pays de colonisation et les mines qu'ils se dirigèrent : les Hauts-Plateaux, Bône, Philippeville, la Tunisie.
Jusque vers 1890, le colporteur Gaouaoua fit ce que l'on peut appeler de bonnes affaires ; mais, à partir de cette époque, le développement des voies de communication, l'installation de commerçants israélites et mozabites dans les petits centres européens et la vente à crédit lui portèrent de rudes coups.
À son tour, il dut souvent louer ses bras ; cependant, son activité s'est toujours portée, de préférence, vers le commerce, soit qu'il devint colporteur ambulant, en France ou l'Etranger, soit qu'il allât fonder boutique en Oranie.
Mais, n'allez pas croire qu'il n'y ait plus de Kabyles portant la balle, en Algérie ; ceux de la page précédente, originaires de la commune mixte de Michelet, je les ai rencontrés près du marché des At-Douala.
Cet autre, âgé de plus de 60 ans, s'apprêtait partir pied pour l'Oranie, quand il a été photographié, aux portes de Fort-National, en 1932.
Survivance nécessaire tant que la femme indigène n'ira pas sur les marchés. Comment pourrait-elle se procurer colifichets ou remèdes, si des colporteurs avisés ne venaient pas jusqu'à elle ?
Martial REMOND
Éditeur : Baconnier-Hélio (Alger)
Année de publication : 1933
08:22 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook
Facebook
11/06/2014
Messaoud HÉOUAÏNE à Bou El Bellout (Victor RENOU)
Juillet 1960
Une section de Génie vient de consolider la piste routière et entreprend la construction de ponts pour franchir les oueds. Des civils sont recrutés à l'empierrement, ce qui exige — encore et toujours —protection. Afin d'éviter de vivre en permanence au régime de conserves, la nourriture du midi est acheminée par camions à tous les soldats. Deux ou trois hommes accompagnent le bahut er répartissent gamelles et pinard. Un midi, je participe à la tournée. Le soir même, j'apprends avec stupeur qu'une grosse mine antichar (S.V.P.), placée au passage des roues, a été découverte. Elle sera dégagée avec les plus grandes précautions. Par deux fois notre véhicule a circulé dessus, risquant d'être volatilisé. Cette « bonne » mine a eu, pour notre salut, l'heureuse fortune de ne pas exploser...
C'est le début d'une série d'explosifs déposés aux endroits les plus inattendus. S'en méfier devient une obsession. Cette hantise va désormais faire partie de notre vie. Par ce perfide moyen, un dangereux terroriste va s'acharner sans relâche à nous nuire. Or, nous le connaissons très bien : il s'appelle « Messaoud », l'évadé aux dents en or. « Mon » évadé...
Ce rusé plastiqueur devient notre bête noire. Son invisible présence est perçue comme celle d'un fantôme maudit. Impuissants à l'arrêter, nous l'exécrons. En retour, le galapiat récidive ses forfaits, comme par plaisir. D'ailleurs, il n'hésite pas à nous narguer : récemment, Tagamouza a reçu une lettre signée « Messaoud », nous prédisant des pépins et lui enjoignant de déserter avec des armes. Très affecté, le harki en a fait part au capitaine. En échange, celui-ci ne lui a donné ni garanties, ni compassion, ni même remerciements. Depuis, le morne silence du pauvre « Taga » en dit long sur son désappointement. (Pages 80-81)
Notre plastiqueur joue toujours à cache-cache avec nous. Il s'ingénie à prouver ses talents (!) dans tous les domaines. Deux fois en moins d'une semaine, c'est le captage d'eau qui subit son lâche procédé. La puissance des déflagrations témoigne de la qualité des explosifs en sa possession. Ceci se passe à la nuit tombante. Le bruit doit s'entendre loin à la ronde. Un grand silence y fait suite. Une haine intérieure se déclenche envers ce crétin. On réplique par des obus envoyés au hasard autour de la source car il est probable qu'une équipe d'embusqués nous y attend. Et le lendemain, tout en maudissant les vandales, il faut réparer. Ce n'est pas drôle ! (Page 82)
Décembre 1960
Renforcés des éléments d'une compagnie voisine, nous rentreprenons le nettoyage des pourtours de Rar El Hanèche. Selon certaines indications, des rebelles y transitent régulièrement. Au petit jour, la Zériba se trouve ceinte d'un immense filet constitué d'hommes en armes. La topologie du terrain est parfaitement connue. Chaque passage de repli est colmaté. Le capitaine coordonne les mouvements par radio et fait procéder à une fouille minutieuse. Bien vite des cabanes, récemment occupées, sont découvertes. Mais leurs occupants ont disparu. Ne demeurent que leurs marques sous forme de feux mal éteints. Messaoud — c'est lui qui était visé — nous a encore filé entre les doigts ! Sans doute décidé à faire chèrement payer sa peau, le goupil doit jubiler... (Page 129)
Février 1961
La piste est auscultée par les spécialistes qui sondent toutes les parties suspectes au détecteur de mines. Ceci est indispensable car Messaoud peut toujours nous avoir mijoté une vacherie ( ... ) Du reste, il vient encore de signaler sa présence. Les jours derniers, un des nôtres a failli sauter en s'asseyant près d'un arbre où un petit explosif était dissimulé. Comment ne pas jeter l'anathème envers ce trublion dont les oreilles ont dû siffler. (Page 146)
En plein après-midi, deux groupes partent en mission, dite de diversion, qui consiste à protéger un héliportage de légionnaires. Tout se déroule bruyamment, dans un ballet compliqué de... bananes vides. Car cette manœuvre est factice. En réalité, les bérets verts venus de nuit à pied sont dispersés beaucoup plus au Sud. Je crois que ce stratagème vise à capturer Messaoud ; mais le « renard » court toujours et nous redoutons de plus en plus ses entourloupettes... (Page 151)
Mars 1961
Lors du retour, il est convenu que cinq voltigeurs vont se planquer en guet-apens dans une mechta en partie démolie. Comme radio, je dois accompagner cette patrouille placée sous la conduite du solide Gerlin. A l'endroit convenu, la section poursuit en silence son chemin et semble nous abandonner. Nous voilà seuls dans cette bruine poisseuse. Tous les bruits sont éteints comme si la nature s'attendait à un drame. Serions-nous restés en sacrifice, présumant de nos forces ? Conscients de ne pouvoir être secourus et mesurant la faiblesse du groupe, nous faisons face. « Ce piège à rats me donne les chocottes », se tracasse Gerlin, d'habitude inébranlable. Quelle torchée si la bande à Messaoud prenait notre petite équipe à son propre jeu ? A l'inverse, quelle jubilation si l'astuce fonctionnait contre notre roublard honni ? Il n'en sera rien. (Page 162)
Avril 1961
Le célèbre lieutenant Simar arrive un soir à Bou El Bellout. …
Sa présence ici a certainement un objectif : Messaoud Héouaïne... Professionnels du cache-cache, ces deux « Seigneurs du djebel » amorcent une joute secrète ; l'un comme dominant, l'autre, comme insoumis. Mais ce duo de protagonistes — qui se joue des vies et de la vie — ne s'embarrasse pas de considérations métaphysiques : grandeur et stupidité de la condition humaine ! A notre insu, le groupe Simar a quitté le poste pendant la nuit. Au petit matin, nos trois sections vont boucler la Zériba Taougenet. J'ai deviné que le braconnier du fell s'est introduit avec ses séides au centre du dispositif. Aucun contact radio ne le confirme. Une chaleur orageuse électrise l'attente.
Soudain, nous décelons plusieurs coups de feu étouffés. Trépignant de curiosité, le capitaine ne peut s'empêcher de quêter des explications par radio. A la deuxième tentative, Simar en personne daigne répondre. Dans son style acerbe, il proclame à l'attention de ceux qui l'écoutent : « Je viens de plomber deux rombières. Mais un mec s'est barré. Gare à vos puces. Terminé ! »... Tout est dit ! (Pages 168-169)
Mai 1961
Ceci n'empêche pas le satané Messaoud de signaler sa présence et ses... sentiments : transportant le sable nécessaire aux travaux, un camion saute sur une mine. Son train avant est hors d'usage. Muets d'indignation, nos râleurs abasourdis doivent en vider le contenu à la pelle. Un bulldozer ramène au bercail l'engin déglingué. Brulard est tout retourné par cette avarie qui n'empêche pas les terrassements de se poursuivre. (Pages 181-182)
Juin 1961
La journée n'en finit pas car les rabatteurs ne donnent aucun signe de vie. Pareils à des furets, ils opèrent en tapinois. On pourrait les croire empêtrés dans le maquis dominant. Le résultat me semble déjà acquis. Quelle barbe cette attente pour des prunes (!). L'envie me prend de me dégourdir les jambes dans le verger. Mon regard se trouve machinalement attiré par un inconnu qui avance le pas tranquille dans ma direction. Ce quidam est vêtu d'un ensemble de toile bleu lavé identique à plusieurs hommes du camp. Dans mon esprit, celui-ci doit bénéficier d'une dérogation car les sorties du regroupement sont interdites aujourd'hui. Soudain, l'homme m'aperçoit. D'un bond il fait demi-tour et se carapate à toutes jambes en zigzagant. A coup sûr, ce vagabond est en défaut. Ne pouvant « l'allumer » avec mon méchant révolver, je crie à pleins poumons pour alerter mes amis. Ceux-ci aperçoivent le dos du fuyard mais n'ont pas le temps d'épauler. Dans sa course éperdue, celui-ci frôle Taboula de retour d'une corvée d'eau. Le harki ne peut faire un geste que déjà l'autre a disparu. « A coup sûr, nous venons encore de faire une bourde », s'indigne Balino avant de savoir. Mais je reste baba lorsque j'entends Taboula certifier avoir reconnu le fugitif : il s'agit de Messaoud. La facilité, avec laquelle le filou s'est débiné, nous laisse confondus : on l'attendait au Nord, il arrivait du Sud ; on le disait aux abois, il cheminait détendu ; on le croyait protégé, il voyageait solitaire. Vraiment, ce « possédé nous possède » !
Un autre élément me déconcerte : par nature physionomiste, j'étais certains d'avoir bien enregistré dans ma mémoire la frêle silhouette, la démarche typique et le visage émacié de notre « Arsène Lupin local ». Or, celui-ci, déambulant sans artifices à ma barbe, je ne l'ai pas reconnu : c'est le bouquet !
Le cas échéant, en m'élançant à son encontre je pouvais me trouver en position de le cravater. Évadé dans mon dos voici un an, nous avons failli marquer cet anniversaire en se fixant les yeux dans les yeux. Son repli m'a épargné ces critiques retrouvailles. Il lui a surtout évité de subir l'hyper-rossée tant de fois promise dans nos rangs. Faut-il chercher dans ma défaillance visuelle une forme de clin-d'oeil narquois d'un Djinn (1) maléfique bénissant la cavale de ce qu'il faut bien appeler notre « ennemi numéro un » ? (Pages 188-189)
Octobre 1961
Les rebelles viennent encore de marquer leur passage. Plus exactement, c'est Messaoud qui a transmis sa carte de visite (... ) : une charge de dynamite a encore pulvérisé les installations de captage d'eau. Cette explosion pose une énigme, car elle s'est produite le seul soir où aucune patrouille n'était sortie. Ce détail n'échappe pas au lieutenant. Furieux de se sentir entuber, il jure ses grands dieux qu'il ne va pas jouer longtemps les pantins. « On va voir ce qu'on va voir, funérailles ! », répète-t-il avec fureur. J'imagine ce qui va suivre... (Page 221)
En Algérie, c'était comme ça …
ou les 24 mois d'un Appelé sur un piton.
Auto édition. Dinan (France)
Année de publication : 1988
12:10 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
29/05/2014
L’école de Bou El Bellout (Victor RENOU)
Avril 1960
Parmi la bande (de moutards), l'un d'eux a les cheveux roux et la frimousse criblée de « tâches de son ». Nous l'avons affublé du sobriquet compromettant de « légionnaire ». Depuis, ses camarades le considèrent comme un bâtard. Il traînera sans doute cet handicap toute sa vie. Pauvre mouflet !
…
Afin d'apporter des notions de langue française à tous ces marmots, une école est mise en place. Je suis désigné pour assurer les fonctions d'instituteur. Comme matériel à disposition, nous avons une tente rapiécée et un tableau noir. Les cours se limitent à la lecture de chansons françaises écrites au tableau ainsi qu'à la découverte des chiffres. La difficulté est grande pour les élèves, mais les progrès sont fulgurants. Recevant un jour un visiteur de marque, le capitaine le fait pénétrer pendant un « cours » dans la pseudoclasse. Comme il se doit, les enfants — assis par terre — se lèvent à son entrée. Une petite démonstration de nos exercices se révèle très concluante. Le visiteur se dit impressionné par ces résultats obtenus en si peu de temps. Mais, sous ces cieux, la mixité reste un problème : une affaire de mœurs se pose entre une grande élève et un harki. Les parents crient au scandale et le capitaine décide sans préavis de fermer la classe. Je n'entendrai plus ces mioches m'appeler « Jacques » d'un air candide. Ils me garderont longtemps une forme de cabotinage qu'il est peut-être possible de nommer reconnaissance ...
Pour des raisons évidentes, chaque personne vivant au camp doit être munie d'une carte d'identité. Or, certains n'en ont jamais possédée. Il faut donc leur en établir. Ayant délaissé l'école, on me demande de venir en aide au fonctionnaire un peu borné responsable de ce travail. Compte tenu de la difficulté d'obtenir des demandeurs un minimum de précisions relatives au lieu de naissance, à l'âge et la parenté, établir un dossier serait impossible sans la présence d'un interprète d'origine locale. Celui-ci se décarcasse pour fournir, tous les renseignements nécessaires à l'obtention des cartes pour chacun. (On pourra, plus tard, se poser des questions sur la validité des renseignements obtenus lorsque le préposé sera arrêté pour collusion...) (Pages 55-56)
Mai 1961
Dans la nuit suivante, la S.A.S. est harcelée de coups de feu. Dans les trente secondes, le sergent de quart balance des obus éclairants. La fusillade cesse aussitôt. Il s'agit sans doute d'un règlement de compte dont nous n'aurons jamais le fin mot et cet incident met tout le village en ébullition. L'ambiance entre communautés se détériore. Je crois d'ailleurs que des choses se trament à nos dépends. Même des garnements prennent l'habitude de nous provoquer. Allusions obscènes et bras d'honneur leur valent de copieuses trempes qu'ils vont ensuite rapporter au chef de la S.A.S. Pour tenter d'occuper tous ces polissons désœuvrés, la réouverture d'une école a été décidée et Tadeu s'en voit confier la responsabilité. Possédant plusieurs licences, cet anticonformiste gouailleur représente le type même de la recrue insupportable : tignasse négligée, bouc hirsute et habits toujours crados dénotent son esprit (pseudo) antimilitariste. Les futurs écoliers seront édifiés par la culture française par ce zazou bourré de diplômes et de mauvaise foi...
En préalable, Tadeu a réclamé et obtenu d'utiliser un local en préfabriqué servant au stockage de ravitaillement. Il a ensuite fait scandale à la S.A.S. en exigeant de la semoule pour distribuer lui-même aux élèves assidus. Alléchés par les promesses, ils sont près d'une centaine à se presser dans la classe. C'est un succès... Afin de conditionner ses mioches, le malotru commence par les faire chanter des refrains gaulois à la moralité douteuse. Ceci lui vaut d'épiques démêlés avec des parents comprenant notre langue et outrés d'une telle pédagogie. La controverse prend des dimensions rocambolesques.
Elle s'arrête avec l'intervention du capitaine qui interdit ces chansons perverses...
L'affaire est pourtant sur le point de capoter lorsque Tuborde rencontre un soir « son » instituteur complètement paf et qui déblatère des outrances infâmantes contre l'armée et ses chefs. Le capitaine s'en tient à des menaces sans suite. En raison du succès de l'école, il lui est difficile de briser l'expérience Tadeu ; d'autant que le coco se crée une notoriété à l'intérieur du regroupement. En effet, améliorant ses connaissances de la langue arabe, « li professeur » s'incruste parmi les villageois. Pour y parvenir, il reconduit les jeunes élèves au gourbi familial et s'arrange pour se faire inviter à siroter le kavoua. Restant ensuite des heures en palabres, on peut imaginer que, par esprit de sédition, l'intrigant cautionne la cause adverse... (Malheur aux pauvres bernés !) ... (Pages 180-181)
Septembre 1961
Suivant mes pronostics, l'école vient d'être fermée. Tadeu se retrouve sans affectation. Ayant, soi-disant, changé d'opinion vis-à-vis des civils, il ne tarit pas de critiques à leur encontre. De moins en moins blairé dans nos rangs et fayotant sans vergogne pour obtenir les faveurs du capitaine, le forban ne cesse de le mettre en garde sur ce qui se passe au camp de regroupement. À l'entendre « tout est pourri » ( ... ) Ses dires font recette ! (Page 212)
En Algérie, c'était comme ça …
ou les 24 mois d'un Appelé sur un piton.
Auto édition. Dinan (France)
Année de publication : 1988
09:57 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook