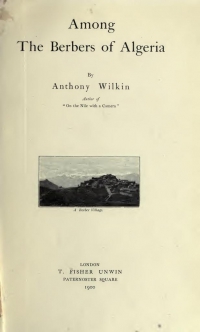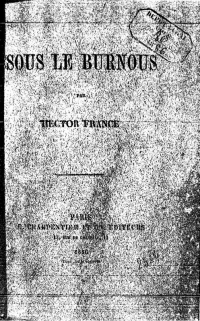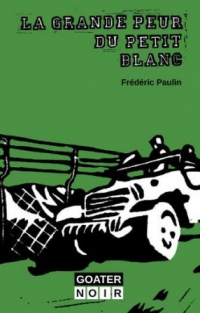05/06/2015
Les Kabyles en France (Commission) 1914
Fait remarquable : au moment où se produisait, en 1911, le gros de l’immigration des Kabyles en France, d’un autre point de la colonie, de Tlemcen, partaient d’autres émigrants pour un pays étranger, la Syrie. Emportés par le fanatisme et la crainte de servir dans nos régiments, ils abandonnaient la terre de leurs ancêtres pour courir des aventures d’où ils nous sont revenus presque tous meurtris et assagis par la plus douloureuse des expériences,
Au contraire, les Kabyles spontanément sont venus à nous, chez nous, et l’accueil que la Métropole leur a réservé a eu des échos retentissants dans les montagnes du Djurdjura.
Nous dirons les avantages politiques, sociaux et économiques qui doivent naturellement s’en suivre.
Retenons pour l’instant que le Kabyle en s’expatriant, donne à nos jeunes compatriotes de France une rude leçon d’énergie. Il veut connaître notre pays et nous ne connaissons pas assez l’Algérie. Le déplacement qui gêne, qui effraie parfois nos compatriotes, est pour lui une bagatelle. Il ne mesure pas le temps. Il a confiance en nous, il nous livre sa personne étrangère par tant de côtés à la nôtre. Et quand, repris par la nostalgie, il retourne là-bas, près des siens, c’est, avec du mieux être, un peu
d’air de France qu’il leur rapporte et qui les invite à connaître et à aimer leur grande patrie.
Origines de l’immigration des Kabyles en France,
Jusqu’à ces dernières années le nombre des Indigènes algériens qui venaient en France était demeuré très restreint,
C’étaient des conducteurs de bestiaux, qui restaient à Marseille après y avoir laissé les animaux qu’ils étaient chargés de conduire, ou quelques colporteurs, attirés par nos grandes expositions internationales, qui parcouraient ensuite la Métropole, principalement les villes d’eau, pour écouler une pacotille plus ou moins importante.
Des essais isolés, tentés par des particuliers pour faire venir d’Algérie des serviteurs à gages, ou même des ouvriers, n’avaient abouti à aucun résultat appréciable.
Mais le besoin croissant de main-d’œuvre, qui a provoqué depuis plusieurs années une formidable immigration d’ouvriers étrangers dans notre pays, surtout dans l’Est, devait aussi amener les Algériens, particulièrement les Kabyles, à venir travailler dans la Métropole.
Dans une brochure publiée en 1899, M. Aït Mehdi, délégué financier, signalait déjà les services que pourraient rendre à l’industrie métropolitaine, ces montagnards laborieux et intelligents qui ne craignent pas de s’expatrier pour rapporter un peu d’aisance dans leur famille.
Les expériences faites depuis trois ou quatre ans par quelques industriels de la Métropole, à Marseille et à Clermont-Ferrand notamment, justifièrent en effet ces prévisions, et dans son rapport sur le fonctionnement de l’Office de l’Algérie à Paris en 1911, le Directeur de ce Service envisageait l’éventualité de prendre des mesures pour canaliser l’immigration croissante de nos Indigènes en France.
L’enquête de 1912.
Afin de préciser l’importance de ce mouvement, le Gouvernement général fit alors procéder à une enquête dans toutes les Préfectures de France. Cette enquête révéla la présence, en 1912, de 4 à 5 000 Indigènes algériens, résidant principalement à Marseille, à Paris et dans le bassin houiller du Pas de Calais ; elle démontra que, au lieu de se cantonner comme autrefois dans le métier de colporteur, ils étaient pour la plupart employés dans des établissements industriels ou miniers.
…
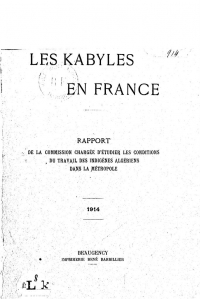 Titre : Les Kabyles en France.
Titre : Les Kabyles en France.
Auteurs : Organisme (Rapport de la commission...)
Editeur : Beaugency (France) : Impr. de R. Barrillier
Année de publication : 1914
Pages 7 à 9
07:52 | Lien permanent | Commentaires (10) | ![]() Facebook
Facebook
17/05/2015
Les maisons de Taguemount-Azouz (Anthony WILKIN)
(De Fort-National) le trajet en équitation sur des mules d’une durée de six heures, assez facile, y compris les arrêts pour l'alimentation et les photographies, nous a amenés à Taguemount-Azouz. Les chemins étaient très difficiles, mais le paysage magnifique, le Djurdjura, apparaissant toujours plus proche et plus audacieux. La neige, sur lui, brillait comme du cristal dans la lumière d’un soleil sans nuages.
…
Dans la plupart des maisons, l'agencement est très simple : une pièce unique, qui peut être de trente pieds de long et quinze de large, divisée en deux parties par un muret de pierre bas, la moitié de la surface étant à un niveau beaucoup plus bas que l'autre. Sur ce mur sont installés les greniers -deux ou plusieurs en nombre- en stuc et décorés de ronds curieux et de losanges, avec même des représentations, depuis longtemps en usage, de mains humaines. L'apparence de ces énormes bacs carrés est mexicaine et ils sont vraiment différents de tous ceux de ce pays.
Dans la partie basse ainsi formée derrière le muret et sous les greniers, on trouve généralement une mule, une chèvre et même un mouton familier. L'autre moitié de la pièce principale est consacrée à la préparation du couscous et aux repas, à la fabrication et au séchage des poteries, et aux nattes qui servent de lits.
Le toit en tuiles est réalisé sur des poteaux robustes dont les extrémités ont une fourche naturelle ou sont découpées en forme de demi-lune pour recevoir les gros chevrons. Il n’y a pas de maîtresse-poutre et, l'inclinaison du toit étant plate, les parois latérales sont seulement retenues de bomber vers l'extérieur par la solidité de la maçonnerie et l'ajout de renforts (ou moises) qui tiennent une partie du poids de la structure ci-dessus.
Les portes sont simples pour la plupart, pas sculptées comme celles de Gelaâ et il n’y a pas de fenêtres de tuiles ornementales comme à Tazaïrt. Des cadenas grossiers mais efficaces en fer ou en laiton, fermés par des clés en spirale comme d’énormes vis, rendent la maison inviolable contre des voleurs ordinaires. Mais il y a des Kabyles qui savent comment saper le mur d'une maison en une seule nuit et extraire les biens des résidents endormis sans les perturber plus qu’un enfant éveillé ou une chèvre agitée.
Dans quelques-unes des meilleures maisons, l'écurie est ventilée dans la pièce par des arches dans le mur mitoyen et les avant-toits sont réalisés pour former des porches agréables sur la porte d’entrée. En aucun cas, nous n'avons vu aucune disposition pour le nettoyage de la cave-étable, ou pour l'admission de ses occupants, une autre voie que celle de la porte d'entrée.
De nombreuses maisons se font face à l'intérieur d’une cour plus ou moins grande, l’ensemble ayant une entrée commune de la rue et un mur d'enceinte. Dans ces petites communautés habitent les familles élargies, grands-parents, pères, mères, cousins, jusqu’à la troisième et quatrième génération, ou jusqu'à ce que les limites d’hébergement ne puissent plus être dépassées.
Le Caïd avait une propriété voisine de celle de son frère. Sa cour contenait un puits avec un trou ordinaire et un seau, un bon siège de pierre sous un figuier productif et une petite parcelle de maïs pour ses mules, autour de laquelle était plantée une frontière d'oignons, laitues et chardons (artichauts ou cardons), à partir de laquelle une excellente salade était toujours à sa disposition.
Il y a bien sûr, des variations infinies sur le plan habituel, mais la description ci-dessus des maisons est assez vraie pour celles que nous avons vues. Outre les greniers, il y a souvent des amphores de deux à trois pieds de haut, qui, placées dans des assises de glaise séchée ou des boiseries ornementales (comme celle de l'illustration), servent à contenir la récolte d'huile d'olive de la saison à partir de laquelle la cuisine peut être préparée et les lampes réapprovisionnées.
Ces lampes sont des produits de la poterie d'un village voisin, et certaines d'entre elles ressemblent au fameux chandelier à sept branches représenté sur l'Arc de Titus, volé au temple de Jérusalem. D'autres sont plus simples, mais en général, leurs formes sont conformes au goût kabyle, de doubler, tripler et même quadrupler l’ouvrage, les parties étant reliées entre elles par des becs et poignées pittoresques et des ponts de renforcement, alors que, dans le cas de pots à eau, il y a communication libre entre les corps de tous les composants.
Les bacs de maïs tressé de Gelaâ ne semblent pas exister à Taguemount-Azouz, mais il y a les greniers de stuc et même des ensembles de greniers accessibles par une échelle extérieure et une trappe, pleins de grain et de figues.
Bien que les habitants soient tous Mahométans et ne doivent pas, en théorie, représenter en dessin ou en sculpture toute chose ayant la vie, nous avons trouvé un mur décoré, au-dessus d’une frise de losanges typiques et de traits, avec des figures en rouge d'un lion, d’un chameau et même d'un homme, sans parler d'un arbre qui, comme ils l’ont affirmé, était censé être un cèdre. La potière, aussi, permet souvent à son sens de l'art de dépasser ses professions religieuses et peint des images de tortues et de chameaux. La méchanceté n'excédant pas son don, son exécution est, du point de vue orthodoxe, le seul point qui pourrait être plaidé pour sa défense.
Nous étions venus dans ce village pour voir les poteries, et nous les avons vues. …
Parmi les Berbères d'Algérie
Anthony WILKIN
(Extrait traduit avec l’aide de Max DRIDER)
Texte original :
Six hours’ easy riding, including stoppages for food and photographs, brought us to Tagamount Azouz. The roads were very fair and the scenery magnificent, the Djurdjura getting ever nearer and bolder. The snow upon them sparkled like crystal in the unclouded sunlight.
…
In most of the houses the arrangement is very simple. A single room, that may be thirty feet in length and fifteen broad, is divided into two compartments by a low stone wall, the one half being at a much lower level than the other. On this wall are the granaries — two or more in number — made of stucco and ornamented with curious rings and diamonds, even with representations, long since conventionalised, of human hands. The appearance of these huge square bins is almost Mexican, and they are quite unlike anything else in the country. In the cellar thus formed behind the low wall and beneath the granaries are generally to be found a mule, goat, or even a pet sheep. The other half of the room is devoted to the preparation of couscous and to eating it, to the making and drying of pottery, and to the mats which serve for beds. The tile roof is carried on sturdy poles whose ends have a natural fork or are cut into a crescentic shape to receive the super incumbent rafters. There are no tie-beams, and, the pitch of the roof being flat, the side walls are only kept from bulging outwards by the solidity of the masonry and the addition of queen-posts, which take up some of the weight of the structure above. The doors are plain for the most part, not carved like those of Gelaa, nor -are there ornamental tile windows as at Tazairt. Clumsy but efficient padlocks of iron or brass, worked by spiral keys like enormous screws, render the house proof against ordinary robbers, but there are Kabyles who know how to undermine the wall of a house in a single night and abstract the property of the sleeping inmates without so much as disturbing a wakeful child or a fretful goat. In a few of the better dwellings the stable is ventilated into the living room by arches in the party wall, and the eaves are carried down to form pleasant porches over the main door-way. In no case did we see any provision for cleaning the cellar-stable, or for admitting its inmates by any other way than that of the front door.
Many of the houses face inward to a greater or lesser courtyard, the whole compound having a common entrance from the street, and an encircling wall. In such little communities dwell separate families, grandparents, fathers, mothers, cousins — all to the third and fourth generation, or until the limits of their scant accommodation can be no longer exceeded.
The kaïd had a property adjoining that of his brother. His courtyard contained a well with an ordinary wind-lass and bucket, a good stone seat beneath a spreading fig-tree, and a little patch of corn for the benefit of his mules, round which was a border of onions, lettuces, and thistles, from which an excellent salad was always at his disposal. There are, of course, endless variations on the usual plan, but the above description of the houses is fairly true for those we saw. In addition to the granaries, there are often amphorae from two to three feet high, which, placed in stands of mud or ornamental woodwork (like that in the illustration) serve to contain a season’s supply of olive oil, from which the kitchen may be supplied and the lamps replenished. These lamps are made of the pottery of a neighbouring village and some of them closely resemble the famous seven-branched candlestick depicted on the Arch of Titus, plundered from the temple at Jerusalem. Others are simpler, but in general their shapes conform to the Kabyle taste for doubling, trebling, and even quadrupling their handiwork, the parts being connected together by quaint spouts and handles, and strengthening bridges, while, in the case of water-pots, there is free communication between the bodies of all the component parts. The plaited corn bins of Gelaa do not seem to be found in Tagamount Azouz, but instead there are the stucco granaries, and even whole rooms reached by an external ladder and a trap-door, full of grain and dried figs.
Though the inhabitants are all Mohammedans and must not, in theory, represent either in drawing or sculpture any kind of thing which has life, we found a wall decorated, above a dado of the typical diamonds and cross-hatchings, with figures in red of a lion, a camel, and even of a man, to say nothing of a tree which, as they affirmed, was intended to be a cedar. The potter, too, often allows his sense of art to outrun his religious professions, and makes images of tortoises and camels, the exceeding badness of whose execution is, from the orthodox point of view, the one point that could be pleaded in his defence.
We had come to this village to see the pottery made, and we saw it. ...
Anthony WILKIN
London - 1900
08:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
26/03/2015
Sous le burnous (France HECTOR) extrait
LA NOCE DE LA PETITE ZAIRAH
Depuis six mois, chaque vendredi, je la voyais arriver, trottinant derrière la mule de son père, parfois seule, mais le plus souvent une vieille à ses côtés. Elle était tous petite -douze ans à peine- mais si frêle et si mignonne qu’elle en paraissait deux de moins.
Enfant de la vieillesse de Baba Aaroun, sa mère à quatorze ans était morte en couches ; aussi le vieillard la chérissait bien qu’elle ne fût qu’une fille, et lorsqu’elle sentait plier ses jambes ou que ses pieds se meurtrissaient aux pierres du chemin, il la prenait devant lui sur le barda de sa mule, comme il eut fait d’un fils. Mais il la déposait doucement à terre avant d’entrer à Djigelly.
C’est alors que nous la voyions passer, insoucieuse et gaie fillette, devant le bordj des Spahis.
Mais bientôt, comme les sœurs dont parle le Lévitique, elle grandit tout à coup. Sa taille se forma ; ses flancs se dessinèrent ; d’harmonieux et doux globes soulevèrent sa gandoura de coton ; le bouton se faisait fleur. Et timide et rougissante devint la fillette, et en même temps si jolie que, pendant des semaines, Arabes et Berbères venaient s’asseoir, devant la porte au coin du bastion, à l’heure où le marché s’ouvre pour voir passer cette merveille des Ouled-Aïdoun.
Et ils allaient rôder autour de l’étalage de Baba Aaroun, lui achetant des pastèques et des figues pour admirer de près la blonde Kabyle qui reflétait dans ses grands yeux étonnés toutes les nuances de la mer et du ciel.
Il savait bien ce qu’il faisait, le vieux Aaroun ; il savait qu’accompagné de sa fille, la double charge des fruits de son jardin disparaissait comme si un djin bienveillant l’eut touché de son pouce mettant à leur place des poignées de sordis, car il avait pour clients tous les Saphis, tous les Turkos et les Mokalis et tous les jeunes Maures de la ville.
Ses voisins riaient de lui, mais que lui importait. Il savait aussi que, sous son œil, la pucelle resterait intacte bien plus sûrement que s’il la laissait au gourbi, confiée à la surveillance distraite de ses belles-mères ou de ses grandes sœurs.
Autant que les vieillards des villes sont avides du fruit vert, les jouvenceaux de la montagne sont habiles à saisir la proie guettée.
Et tous la convoitaient, tandis qu’elle, embarrassée et honteuse, et comprenant déjà, se sentant brûlée par ces flammes ardées sur elle, cachait en rougissant son visage derrière un coin de son haïk.
Entre tous ces admirateurs, se rencontrait le Chaouch Ali-ben-Saïd.
Malgré quarante ans sonnés au cadran de sa vie, il passait pour un des beaux cavaliers de la ville et un des plus rudes champions près des femmes, ce qui, joint à une conformité toute spéciale l’avait fait surnommer Bou-Zeb , nom difficile à traduire en français.
Bref, il possédait les qualités qu’au temps du prophète Ezéchiel, Oolla et Oolibella, soeurs bibliques et vierges folles, exigeaient de leurs amants.
Coquet et beau parleur, il se distinguait par le luxe de son turban brodé de soie jaune, son gilet chamarré d’or et l’éclatante blancheur de son burnous ; aussi Mauresques et Kabyles lui clignaient de l’œil, et les femmes des Mercantis même, avouaient que pour un Indigène, il n’était pas trop mal tourné, c’est-à-dire qu’elles le trouvaient charmant.
Il parlait, du reste, le français avec facilité, buvait de l’absinthe et du vin, et généralement tout ce qu'on voulait bien lui offrir, portait des chaussettes, se mouchait dans un foulard, fuyait la vermine et s'abstenait du Ramadhan.
Il avait quelque argent et aurait pu vivre sans rien faire en ce pays où un douro quotidien constitue un large patrimoine mais désireux de briller en ce monde et sachant que les femmes n'aiment rien tant que les glorieux, il s'était mis au service du Bureau arabe et portait avec orgueil, aux jours de solennité, le burnous bleu de Chaouch.
…
France HECTOR
Éditions G. Charpentier
Paris 1886
Pages 151 à 155
06:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
19/03/2015
La grande peur du petit Blanc (Frédéric PAULIN) extrait2
À Paris, les Mekchiche durent à nouveau se presser dans les rues grises. Une pluie fine mouillait la capitale de la France et les Parisiens faisaient d'épouvantables grimaces. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'immense hall de la gare Montparnasse, ils virent le mot « OAS » peinturluré sur un mur.
Malgré les patrouilles de soldats et de policiers qu'ils croisèrent à plusieurs reprises, on ne les inquiéta jamais.
- Ils sont là pour l'OAS, précisa son père comme sa mère s'inquiétait de voir des hommes en armes si loin de l'Algérie.
- Et ils n'ont pas peur du FLN ?
Le père haussa les épaules:
- Il paraît que le Général de Gaulle et Belkacem Krim ont engagé des négociations.
- Des négociations pour quoi faire? demanda sa mère qui semblait découvrir qu'on lui avait menti.
- Pour l'Indépendance, répondit le père en haussant à nouveau les épaules mais, cette fois, de l’air de celui qui en sait plus que les autres. Ne fais pas l'étonnée, tu savais bien que le FLN allait gagner,
La mère se tut, ses yeux étaient vides. Puis elle hocha la tête :
- Oui, oui, je savais bien...
Ils s'installèrent alors dans leur wagon pour la dernière partie du voyage. Sur le quai, ils virent passer les autres familles harkis. De part et d'’autre de la fenêtre, les émigrés se sourirent, un peu plus sereins de se sentir un peu plus nombreux.
Emigré. Ce fut son père qui employa le premier ce mot.
- On sera toujours des étrangers, maintenant, avait murmuré sa mère, alors que tout le monde dormait sur le bateau.
Son père sourit de ce petit sourire triste qui ne le quittait plus :
- Pas des étrangers, Fouzia. Des émigrés. Comme beaucoup d'Algériens, de Marocains ou même de Portugais en France. Ce n'est pas anormal des émigrés en France.
Par ce long voyage, les Mekchiche étaient donc devenu des émigrés. Mais Rochdi ne crut pas son père: il sentait bien que, désormais, il était aussi un étranger. En France, bien sûr, mais également en Algérie.
Émigrés ou étrangers, il se trouvait qu'en France les Algériens n'étaient pas les bienvenus. Lorsque le train s'arrêta en gare de Redon, une compagnie de gardes mobiles, fusils au poing, encerclait la gare. À Philippeville, les Mekchiche ii avaient vu des gendarmes et des militaires, eux aussi la mitraillette en bandoulière, ce n'était pas là le problème. D'ailleurs, en Algérie, les avions et les véhicules blindés faisaient également partie du quotidien ; ici il n'y en avait pas. Mais dans la gare de cette petite ville de Bretagne, Rochdi et les siens réalisèrent vite que c'était pour les Harkis que les Forces de l'ordre avaient sorti leurs armes. Pas pour le F.L.N.
Quelques gradés et deux civils se tenaient en avant de la troupe.
On interdit d'abord aux Algériens de descendre du train. Les autres passagers, les Français, furent priés de se dépêcher de quitter les lieux après que leurs papiers eurent été vérifiés. Son père déclara qu'il n'y avait rien à craindre, que le lieutenant Gascogne avait tout prévu, que ce n'était qu'une opération de routine et qu'il ne fallait pas s'affoler.
Un long moment avait passé.
Puis, un capitaine et trois gendarmes montèrent dans le train. L'officier demanda aux hommes de descendre.
La discussion entre Français et émigrés fut brève. Les émigrés baissaient la tête et les Français secouaient la leur, comme le faisait l'instituteur lorsque Rochdi n'avait pas appris sa leçon.
Tous les Harkis furent ensuite regroupés dans un seul wagon. Quatre policiers en civils montèrent à leur tour dans le train : leur mission était de s'assurer que les Algériens retournent en Algérie.
– Vous savez parfaitement qu'en tant qu'ex-soldats français, votre venue en France est illégale, expliqua d'un ton paternaliste le capitaine avant da quitter le wagon.
Pendant une heure encore, le train resta immobile. Personne ne dit un mot ; les vieilles femmes pleuraient doucement.
Dehors, la ville ne ressemblait en rien à ce qu'avait imaginé Rochdi : pas de mer bleue et pas de petites maisons blanches et propres. C'est pourquoi le retour en Algérie lui sembla finalement une alternative tout à fait acceptable, à lui. …
 La grande peur du petit Blanc
La grande peur du petit Blanc
Frédéric PAULIN
Éditions Goater "Noir"
2013
08:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
14/03/2015
La grande peur du petit Blanc (Frédéric PAULIN) extrait1
Algérie, France, Algérie, août 1961
…
Le grand départ eut lieu au mois d'août 1961. Philippeville était baignée par le soleil.
Son père avait entraîné Rochdi dans le salon. Il caressa ses cheveux quelques minutes tendrement. C'était la première fois qu'une telle intimité physique les unissait, l'enfant était un peu inquiet.
– Nous allons quitter Philippeville.
– On déménage ?
Le père haussa les épaules :
– Oui, on déménage très loin : on va en France.
Du haut de ses dix ans, la nouvelle troublait Rochdi :
…
Une heure après avoir débarqué à la gare d'Alger, la famille Mekchiche au complet s'installait sur une banquette du pont intérieur. Les places alentours étaient occupées par d'autres familles algériennes dont les pères connaissaient celui de Kader. L'un d'eux le salua même à la militaire en disant « bonjour caporal ».
Son père avait eu un sourire triste:
– C'est fini tout ça. Plus de caporal, plus de harkis, plus d'Algérie.
La traversée de la Méditerranée avait été un moment de tranquillité comme les Mekchiche n'en avait plus connu depuis longtemps. À bord de El Djezaïr, il semblait que les esprits s'étaient refroidis, son père paraissait triste mais aussi plus détendu que lorsqu'ils étaient encore sur le sol algérien. Les femmes s'étaient toutes changées: elles avaient quitté leur djellaba et retiré leur haïk et s'étaient vêtues à l'européenne. Sa mère avait revêtu une jupe qui arrivait juste au-dessous de ses genoux et un imperméable beige, elle avait noué ses cheveux en un petit chignon. Elle était très belle.
Ensuite, les harkis avaient peu parlé. Les pères avaient discuté un petit moment à voix basse, un peu plus loin sur le pont. Et au bout de quelques heures, tous s'étaient endormis comme m'ils n'avaient plus dormi depuis des jours. Sa grand-mère parlait en dormant, ça avait fait rire les enfants, et aussi, parfois, leurs parents. Rochdi, lui aussi, souriait: la France était peut-être un pays où tout le monde souriait.
Mais en France, plus on avançait, plus le ciel devenait gris. C'était pourtant l'été. Quant aux Français, ils ne souriaient pas. À Marseille, ils regardaient même le groupe d'Algériens avec de la haine. Cette haine les harkis la connaissaient pour l'avoir vue chez certains Européens à Philippeville.
– C'est l'invasion des felloches, dit même un vieux monsieur qui fumait une pipe.
– Ils mettent pas assez le bazar chez eux, ils ont besoin de venir chez nous, ben c'est du propre confirma un peu plus tard un jeune cycliste.
Son père expliqua alors aux autres hommes harkis qu'il valait mieux que les familles voyagent séparément, afin d'éviter d'attirer l'attention. On se donna donc rendez-vous, peut-être à Paris, à la gare Montparnasse, et plus certainement à Rennes ou à Redon. Pour Rochdi, Rennes et Redon étaient des noms d'un exotisme incroyable: malgré ce qu'il avait vu de la France, sa grisaille et sa tristesse, il s'imaginait des villages au bord d'une mer bleue et de petites maisons blanches et propres. Une manière d'Algérie parfaite, sans la guerre et la méfiance entre les Algériens et les Français.
Dans le wagon, les Mekchiche se retrouvèrent pour la première fois seuls au milieu des Français. L’inquiétude reprit possession de la famille. Rochdi, lui, s'efforçait de s'absorber dans la contemplation du paysage. Mais le beau temps n'était toujours pas de la partie: au bout de deux heures, le ciel nuageux déversa même des trombes d'eau.
– J'ai froid, maman, murmurait de temps en temps Souhila.
Sa mère la serrait contre elle et la fillette se rendormait.
Par la fenêtre, on voyait beaucoup d'églises au centre des villages qui apparaissaient au loin. Rochdi s'étonna de l'absence de minarets. Il s'étonna aussi de la pâleur des gens : en Algérie, même les Français n'avaient pas la peau blanche. Dans le compartiment, le couple et son petit garçon qui faisaient face aux Mekchiche avaient la peau presque aussi blanche qu'un cachet d'aspirine. Et puis, le mari et la femme n'en finissaient plus de hausser les sourcils lorsque leurs regards s'arrêtaient sur la famille algérienne. Rochdi pensa que c’étaient les ronflements de sa grand-mère qui les ennuyaient.
Frédéric PAULIN
Éditions Goater "Noir"
2013
08:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook