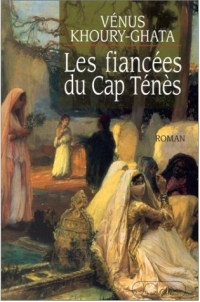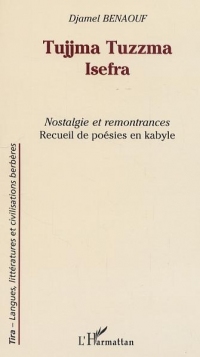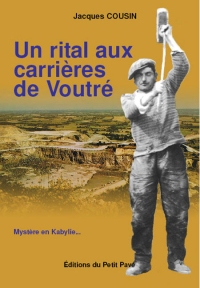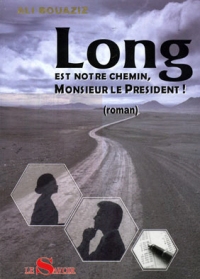21/10/2008
Livret de Colonisation (Joseph CHAILLEY-BERT)
26 Kabyles et Arabes. (Élève, p. 16)
Sommaire. 1 - La population indigène de l’Algérie n’est pas homogène. - 2- Une race autochtone et plusieurs races conquérantes. - 3 - Arabes et Kabyles.
Développement.
1 – Celui qui parcourt l’Algérie s'aperçoit bientôt que les habitants indigènes qu’ il rencontre n'ont tous pas tous les mêmes habitudes, ne mènent pas tous la même vie. Dans une même province, dans la province de Constantine, par exemple, s'il arrive par mer, il voit d'abord des villages nombreux bâtis au flanc des monts, et une population laborieuse et dense; puis, à mesure qu'il s'éloigne de la mer, il rencontre, dans la plaine, une population plus clairsemée et des villages plus rares. Les habitants eux-mêmes diffèrent entre eux autant que les régions: les premiers sont des Berbères ou Kabyles, les seconds des Arabes.
2 – Beaucoup de races ont traversé l’Algérie et y ont laissé des traces. Il y a eu d’abord les premiers habitants, qu'on appelait les Berbères. Puis sont venus les conquérants romains; puis, à la chute de l’empire romain, les conquérants barbares : Lombards et Wisigoths; puis enfin, sous la conduite des héritiers de Mahomet, les Arabes.
3 – Les premiers habitants, les Berbères effrayés par tant d'invasions, ont fui par se réfugier dans les montagnes de la Kabylie où les Arabes ne les ont pas poursuivis. Pendant des siècles, la montagne a été aux Berbères ou comme on les appelle, aux Kabyles, et la plaine aux Arabes. Il y a bien quelques Arabes dans la montagne et quelques Berbères dans la plaine; mais c'est l'exception. Le Kabyle a un champ à lui, sa maison à lui et vit dans sa famille. L'Arabe vit dans la tribu; sa maison n’est souvent n'est qu'une tente, et les champs qu'il cultive sont ceux de la tribu.
Les mêmes règles de gouvernement et d'administration ne sauraient convenir aux Kabyles et aux Arabes.
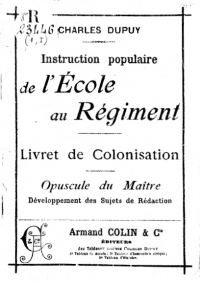 Livret de Colonisation
Livret de Colonisation
Par M Joseph CHAILLEY-BERT
Sous la direction de Charles DUPUY
Opuscule du Maître
Développement des sujets de rédaction
Armand COLIN et Cie
Paris , 1896
Pages 26-27
13:51 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
09/10/2008
Les fiancées du cap Ténès (Vénus KHOURY-GHATA)
Blanche, qui vient de remettre pied sur terre, s'inquiète du sort de l'équipage.
- Que sont devenus les marins ?
- Tués par les Bani Haoua, l'informe la religieuse. Quelques-uns ont réussi à fuir.
- Et les femmes ?
- Réparties entre les hommes comme un vulgaire butin de guerre.
- La marquise aussi ?
Mère Jeanne hoche la tête en serrant ses paupières pour retenir ses larmes.
Un nuage noir traverse le regard de la rescapée. Sa phrase tombe aussi raide qu'un couperet:
- Je les vengerai jusqu'au dernier. Les Bani Haoua mourront de mes mains... De plaisir, ajoute-t-elle le regard au loin.
Mère Jeanne baisse les yeux, gênée.
- Parce que vous ne me croyez pas ? insiste le curieux personnage.
Blanche n'aime pas l'air méfiant de la religieuse, ni celui suspicieux du chevrier. D'un geste preste de la main, elle dégrafe sa veste. Deux seins ronds sursautent comme deux pigeons effrayés.
- Vous voulez voir le reste ?
Mouloud fait oui de la tête. Mère Jeanne la supplie de ne rien faire. Elle la croit sur parole. Mais Blanche a déjà tiré sur le cordon de son froc.
- Arrête, hurle la religieuse.
- Vous n'avez pas tout vu, proteste le faux mousse. Le plus important est en bas.
La dague qui a ouvert la chair sur le haut de sa cuisse a pénétré jusqu'aux os. Le sable a joué le rôle de cicatrisant mais d'infectant aussi. La jambe, d'une couleur violacée, a doublé de volume.
- Pouvez-vous me soigner, dit-elle d'une voix suppliante. Ma mère vous en serait si reconnaissante.
- Qu'attendez-vous pour aller me chercher de quoi panser cette plaie, lance Mère Jeanne à Mouloud d'une voix affolée.
Le chevrier arrache un morceau à son burnous et le lui tend.
- Je veux des plantes, malheureux, avec quoi vous autres Kabyles désinfectez-vous les blessures ?
- Avec de la joubarbe. Je sais où en trouver.
Il se précipite vers l'oued. Le bien et le mal se croisent autour des points d'eau, lieux de prédilection des âmes végétatives. Leur souffle fait pousser les plantes destinées à guérir les vivants. Il faut savoir distinguer les bénéfiques des maléfiques, cueillir les premières en balbutiant une prière, et cracher dans le sens du vent en passant devant les autres.
Mouloud repère très vite la touffe de joubarbe. Les feuilles sont tendres en cette saison. il les cueille en invoquant le nom d'Allah. Il est convaincu qu'une deuxième vie attend le garçon devenu fille grâce à lui. Sinon comment expliquer qu'il soit le seul survivant du massacre. Benjamin, répète-t-il sans grande conviction. Il cherche un autre nom qui irait mieux avec la blondeur de la rescapée. Un nom aussi blanc, aussi rond que les seins qui ont fusé de la veste déboutonnée.
- Laouza, balbutie-t-il entre ses lèvres. Laouza, lance-t-il d'une voix tonitruante, et il se met à courir vers sa masure.
- Tu t'appelles désormais Laouza, c'est-à-dire Amande, annonce-t-il à la jeune fille. Un fruit doux frais qui étanche la soif mais vous laisse en même temps sur votre faim.
Laouza-Amande accepte avec grâce ce troisième nom. Le chevrier, elle en est certaine, sera son meilleur allié.
Deux semaines après, Laouza, qui a appris quelques rudiments de la langue arabe et dont la blessure a cicatrisé, entreprend d'une voix mielleuse l'interrogatoire de Mouloud:
- Qui a tué mes camarades?
- Les gens de la montagne. Les Cabaïles. Ceux de Mokrane ont aidé.
- Y a-t-il d'autres rescapés que Mère Jeanne et moi ?
- Il y a la marquise. Marie est partie chez un cultivateur du Rif. La petite fille va épouser le fils de l'émir du ksar.
- Et les hommes ? Ils sont tous morts ?
- La moitié seulement. L'autre moitié s'est enfuie vers l'est. Vers Oran.
- La France n'est pas intervenue? Personne n’a demandé de nos nouvelles ?
- Pas encore.
- Pourquoi Mère Jeanne évite-t-elle de parler ce sujet? « Prie », me dit-elle chaque fois que je pose une question.
- Parce qu'il ne sert à rien de se noircir le sang. Allah, qui creuse les brèches, saura les colmater, dit le proverbe. Les morts seront vengés. Tu témoigneras pour eux. Tu es leur messager. Laouza réprime un frisson. Tant de sagesse dans la bouche d'un chevrier la trouble profondément.
- Oui ! Je défendrai leur cause répète-t-elle après lui.
Les fiancées du cap Ténès
Éditions Jean-Claude Lattès
1995
Pages 54 à 57
09:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
28/09/2008
Nostalgie et remontrances (Djamel BENAOUF)
L'épouvantail
Un jour, à son apogée,
M'est venue à l'esprit,
Une histoire en poème.
C'est l'histoire, écoutez:
Si cela en vaut la peine,
Sinon elle passera comme le vent.
Dans un verger se trouve un épouvantail
De grande taille, éblouissant de beauté,
Se tenant bien droit,
Habillé d'un pantalon,
Portant un fusil de férule.
De lui, tous les animaux avaient peur;
Quand de sa nature les lapins s'aperçurent
Il ne parle ni n'appelle!
Ils cassèrent l'obstacle de la peur,
Mangèrent les gousses,
Ils broyèrent même les pousses ;
Le verger devint un tas d'immondices.
Le propriétaire bouleversé,
En colère et tourmenté,
Tapant dans ses mains et soufflant,
S'en alla se plaindre,
Allant voir les sages,
Pour résoudre le problème.
Ils se réunirent sur la question.
Vu l'absence d'appuis,
L'épouvantail n'est pas à incriminer
Le pauvre est un impotent,
Sans force ni mouvements.
C'est toi l'homme aux ruses,
Qui en fit un instrument,
Sans coeur et sans raison.
Désorienté, le propriétaire du verger
Terrassa l'épouvantail,
Qui devint cendre au foyer.
Dans chaque idée qui naît,
La fin montre
Où est l'intelligence et où est l'illusion.
Tujjma Tuzma (Isefra)
Nostalgie et remontrances
Éd. L’Harmattan 2005
Pages 65 et 67
12:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
21/09/2008
Un Rital aux carrières de Voutré (Jacques COUSIN)
Voutré c’est en Mayenne, à l’ouest de la France…
Et pourtant le sous-titre du livre est : Mystère en Kabylie
Quel rapport ? La Kabylie, ici c’est le nom de cette carrière qui existe depuis 1858 !

…
Le train de 18 h 50, en provenance de Paris, s'arrêta en gare de Voutré dans un crissement de freins prolongé. Un long panache de vapeur blanche sortit en chuintant de la cheminée, puis enveloppa entièrement la locomotive, avant de se déliter au-dessus du bâtiment bas occupé par la gare.
Le soleil était encore haut dans un ciel sans nuages. Dans les champs situés de l'autre côté de la voie, les foins entassés en meules apportaient jusqu'à la gare l'odeur caractéristique de l'herbe fraîchement coupée.
Sur le quai, stationnaient quelques personnes venues attendre l'arrivée d'un parent. Elles habitaient vraisemblablement la localité même ou ses environs immédiats puisqu'elles avaient gardé leurs habits de travail.
Cinq ou six voyageurs descendirent, de lourdes valises à la main. Deux ou trois autres montèrent péniblement, tout aussi chargés. Les transferts se firent sans bousculade, ni précipitation. Des embrassades discrètes, quelques cris de joie, des éclats de rire, l'appel d'une maman en direction de ses enfants, des débuts de discussion vite avortés. Le petit rassemblement traversa la salle d'attente, descendit la place mal empierrée, avant de remonter la rue à pied en direction du bourg.
«En voiture les voyageurs ! Fermez les portières, s'il vous plaît !» aboya le chef de gare, un petit bonhomme rondouillard, engoncé dans un uniforme un peu râpé, devenu, avec les ans, trop étroit pour lui. Il s'essuya brièvement le visage avec un mouchoir à carreaux sorti de sa poche, agita plusieurs fois son drapeau. Un coup de sifflet strident fendit l'air surchauffé. Aux fenêtres des wagons, quelques voyageurs avaient baissé les vitres et regardaient en attendant le départ. La locomotive s'ébranla dans un nouveau rideau de vapeur blanche, prit de la vitesse, arriva à la première courbe. L'arrière du dernier wagon disparut en direction d'Évron.
…
Un Rital aux carrières de Voutré :
mystère en Kabylie
Ed. du Petit pavé, Brissac, France
11:06 | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook
Facebook
14/09/2008
Long est notre chemin (Ali BOUAZIZ)
Ô ! Quand on a grandi dans une spacieuse maison, en face d’une montagne adoucissant matinalement l’aube, on s’habitue vite à appréhender le monde ! L’énormité des roches, leur froideur, leurs regards fixes, inspirent tant de peur, d’étonnement et l’on se dit : « Où se cache ce soleil ? D’où jaillit-il ? » Ainsi, les montagnards apprenaient tout petits à décoder le discours creux et alléchant des politiques. Cette fusion entre l’esprit montagnard et l’âme de la nature assagit précocement. En tout cas, rien n’était plus horrible que cette chambre aux murs sales, qui sentait la misère. Il y avait place pour plusieurs lits, mais il n’y avait qu’un sommier, ce qui me faisait comprendre que l’ancien locataire était seul. Une table, une chaise, et dans l’angle étaient déposées des étagères pleines de livres et d’anciennes revues. À l’entrée, il y avait les toilettes d’un angle et le lavabo, séparés par une longue petite porte et l’autre angle servait de cuisine. Durant plus de deux années, exceptée la peinture que j’avais refaite et le changement du sommier par un lit en bois et un nouveau matelas, rien n’était changé, aucun meuble n’avait été acheté. Quelquefois, j’empruntais des mots de quelques amis poètes pour me faire écouter et entendre ma misère et ma vie retirée dans ma solitude sans tristesse ni joie, en songeant à ce que devait être ou devenir le pays. En tous cas cette chambre qui m’offrait l’image de ma misère, s’entendait bien avec cette vie sans désir.
Pris par le rythme que je ne maîtrisais pas encore de la rédaction et cette envie de réussir ma chance, je me contentais de hâtifs et récurrents coups de balai qui ne changeaient pas beaucoup l’aspect misérable de cette chambre. Je me souvins bien qu’à ma première nuit je sentais la poussière m’agripper et, sous l’effet de la chaleur, dans mes agitations, le sommier craquait, les couvertures et le linge me collaient sur tout le corps, tel le sourire momentané de Mériem qui m’embrassait de la tête aux pieds. Mais j’avais installé aussi un pendoir dans le mur et deux grandes fresques où l’on pouvait admirer une montagne et des chutes d’eaux qui arrosaient les bords de rivières qui m’avaient bercé en Kabylie. Ces deux tableaux étaient distanciés par un portrait d’un grand journaliste et écrivain algérien du nom de Tahar Djaout. Cela me garantissait un rappel et l’espoir d’exceller dans mon travail. Je me doublais d’énergie, d’ardeur et de froideur. J’étais tout le temps comme réveillé et j’avais l’impression de jouir d’une grande lucidité d’esprit, mais une lucidité fébrile, mêlée d’agitation. Tahar, simplement était mon aiguillon, il me prenait la main à chaque fois que j’abordais ces rues qui me restaient toujours inconnues, là où j’étais continuellement ému. Car, en me jetant au grand jour, il me semblait partir vers une aventure. En effet, ces rues n’étaient pas très rassurantes pour moi. Pour un jeune journaliste surtout, ou pour une personne étrangère, les promenades à travers des descentes à pic, bordées de colonnettes, pouvaient réserver de mauvaises rencontres. Dans ce danger, de l’inconnu, n’importe qui pouvait braquer son arme.
Je ne touchais pas encore aux bouquins trouvés là, superposés l’un sur l’autre, sentant le remugle. J’étais occupé comme tout le monde à repousser ma mort le plus loin possible, et apprendre un lexique affûté mais qui ne me nuirait pas de suite en le tissant. Dans un petit bout de papier en guise de liseuse que je repris entre les mains un jour, je notai : « Généralement les écrivains écrivent pour exposer des problèmes et c’est aux autres de les régler ». Je revins à la ligne et je continuai : « Contrairement à Racine, qui s’était engouffré dans son théâtre élevé, Marivaux, en revanche, s’était abaissé vers le peuple, pour écrire et provoquer un débat sur la situation des « esclaves modernes » en leur offrant un hymne par sa pièce L’Île des esclaves ; celui-ci simplement prêchait le pardon en donnant l’occasion aux esclaves d’avoir le pouvoir, et d’avoir la chance de le rendre à leurs maîtres.»
« Mais pourquoi cela ne se voit pas au bled ? » me disais-je. Depuis je ne savais pas exactement comment me répondre…
Ali BOUAZIZ
Long est notre chemin, Monsieur le Président
Éditions Le Savoir
Tizi-Ouzou 2007
06:29 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook
Facebook