15/07/2008
Promenades en temps de guerre chez les Kabyles (Félix HUN)
Je laisse à droite, à distance, l’emplacement couvert de ruines, de la ville romaine, supposée être ou plutôt avoir été Rusucurum. Il se termine en promontoire dans la mer ; à la pointe est une petite île. Il parait qu’une petite jetée la reliait à la ville et formait ainsi le port. Si ce point, qui, je crois, a été découvert par M. J. Barbier, est, comme il le prétend, à l'abri des vents, je suis étonné qu'on n’en ait pas fait un petit port de commerce pour les villages populeux des environs et de relâche pour le cabotage pendant les gros temps, Dellys étant dans ces circonstances, inabordable. Je crois qu'il n'en coûterait pas grand'chose. Rien n'échappait aux Romains.
Après environ trois heures de traversée de cap en cap, en ligne directe, droite, comme la corde d'un arc tendu, je double, c'est-à-dire mon bateau double une montagne qui s'avance dans la mer, et vient aborder au fond d'une petite crique; c'est celle de mon marabout.
Tout près de l'endroit où je débarque, sur le haut du rivage escarpé, voici le marabout de sidi Khaled. C'est une petite maison, de forme carrée, un peu plus longue que large, sans étage, couverte d'un toit, à deux pentes, en tuiles, semblables aux nôtres. Sa porte n'est pas fermée à clé; chacun peut entrer la nuit, le jour, et s'y reposer. On y trouve une cruche, pour boire, quelques ustensiles en terre cuite et des tapis de sparterie, le tout au service de tous. À l'extérieur contre le mur, du côté de la terre, est un arbre, aussi marabout, chargé de chiffons d'étoffe accrochés à ses branches en ex-voto et offrandes. Ce marabout a une spécialité, au dire de M. J. Barbier, qui le tiendrait des Kabyles, a une spécialité fort utile et curieuse, surtout pour un criminologue, et que lui envierait même le plus fin juge d'instruction. Les Maures de Dellys viennent en bateau apporter du sel, pour approvisionner les populations voisines. Ils déposent dans le marabout une mesure remplie et une mesure vide et s’en vont à la pêche ou partent pour Dellys. Les Kabyles descendent de leurs villages, voient la marchandise, et, si le taux leur convient, prennent le sel, mais laissent à sa place l’équivalent en blé ou en orge, équivalent indiqué par la mesure vide. Or, la plus grande bonne foi, la plus grande loyauté président à ces marchés muets. C'est qu'aussi sidi Khaled, quoique mort depuis un temps immémorial, ou plutôt son esprit, veille sans cesse à ce qu'il en soit ainsi, punit même très sévèrement le vol, la fraude ou la mauvaise foi.
Ainsi, un jour, certain Kabyle, sans foi ni loi, incrédule en son marabout, ou espérant qu’il n’en serait pas vu s'en vint, par un épais brouillard, prendre furtivement et frauduleusement une grosse pierre de sel, puis s'en fut la cachant sous son burnous et la pressant contre son sein, afin que personne ne s'aperçut de rien. Mais ne voilà-t-il pas qu'en toute hâte chez lui arrivé et rentré, voulant se décharger et mettre chose en sûreté, le sel diabolique dans les côtes lui était entré, et si bien, si bien entré, que le malheureux le lendemain fut trouvé, au sel passé et trépassé, sans avoir pu, malgré cela, se conserver.
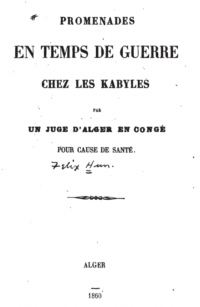 Un juge d’Alger
Un juge d’Alger
(Félix HUN)
Promenades en temps de guerre chez les Kabyles
Alger 1860
Les livres attribués à Félix HUN furent publiés avec la mention :
UN JUGE D'ALGER EN CONGE
POUR CAUSE DE SANTE
07:13 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
07/07/2008
Le voyage de Mohand (Ali MEBTOUCHE)
Dès qu'il eut l'âge de comprendre, Mohand fut obsédé par l'idée de quitter un jour son village natal pour émigrer dans le pays de ses rêves : la France. Après avoir assisté, du début jusqu'à la fin, à la guerre d'indépendance de l'Algérie, Mohand avait atteint l'âge de s'exiler, comme tant de jeunes de son âge, et de partir à la recherche du paradis que les anciens émigrés, après des années passées en France, leur faisaient miroiter.
Pour se rendre en France, Mohand avait dû supplier son père pendant plus d'une année…
Enfin, tous ses papiers étaient prêts: carte d'identité, autorisation de sortie du territoire, certificat d'hébergement, que son oncle Da Lounès, le frère de son père, lui avait envoyé de France, où lui-même travaillait dans la ville de Bitche, en Moselle… Avec tous ces papiers, Mohand acheta son billet, par bateau, aller et retour payé.
Enfin, il allait sortir de ce village où il était enfermé depuis sa venue au monde. Il était impatient d'aller voir ce monde extérieur dont il avait souvent entendu parler par les émigrés, lorsqu'ils revenaient au pays, après avoir séjourné et travaillé comme marchands de tapis dans différentes villes françaises, dont les noms enchantaient ses oreilles : Paris, Marseille, mais surtout des villes situées en Alsace-Lorraine, où la majorité de gens de son village, dont son père et son oncle Da Lounès, avaient séjourné durant les années cinquante et soixante.
Pour voyager en France, Mohand devait partir avec son oncle, le frère de sa mère. Ce dernier avait promis à ses parents de s'occuper de lui et de lui trouver un travail à la gare de tri S.N.C.F. de Lyon-Perrache, là où lui-même travaillait comme conducteur d'un chariot-élévateur.
Patiemment, dès le lendemain de l'indépendance de l'Algérie, en l'année mille neuf cent soixante-deux, alors que son village commençait à se vider de tous les enfants de son âge, Mohand avait attendu ce jour du vingt-sept septembre mille neuf cent soixante-quatre.
Ce matin-là, sa mère s'arrachait les cheveux en lui disant:
" Mohand, tu n'as pas fait changer les deux cents francs que tu dois emporter avec toi ! "
Pour passer la douane algérienne et la douane française, un émigré comme Mohand, qui n'avait jamais travaillé en France, devait faire semblant de venir en touriste. Une fois en France, on pouvait s'installer et travailler, mais c'était à ses risques et périls, car beaucoup d'émigrés étaient refoulés à la frontière, certains à Alger même, d'autres par les autorités françaises, à la descente de l'avion ou du bateau.
Cependant, certains avaient la chance de traverser la frontière et pouvaient chercher du travail en France. Pour cela, il fallait payer son billet de bateau ou d'avion en aller-retour et emporter avec soi la somme de deux cents francs français qui prouvait aux autorités françaises que l'on avait de quoi se nourrir pendant son séjour en France. Dans la précipitation, mais surtout par ignorance, Mohand n'avait pas fait changer les deux cents dinars contre les deux cents francs français.
Il fallait impérativement que la mention " deux cents francs français " apparaisse sur son billet de bateau, avec une signature et un tampon : " Banque Centrale d'Algérie ", banque où il devait se présenter en personne pour faire l'échange. La Banque Centrale d'Algérie ouvrait ses portes à huit heures trente… Il ne restait plus à Mohand qu'une petite matinée pour changer son argent.
Le lendemain, un samedi matin, Mohand se leva à cinq heures. Il n'avait plus que quelques heures de chance devant lui pour se rendre en ville à bord d'un véhicule. Pour aller à Tizi-Ouzou, ville située à douze kilomètres de là, il attendit avec beaucoup de persévérance, sur la route qui passait au-dessus de son village, qu'arrive " un fraudeur ". Un " fraudeur " est un travailleur émigré qui a eu l'opportunité de ramener une voiture de France et qui, sans autorisation légale, transporte des personnes pour la somme de dix dinars aller-retour. " Les fraudeurs " étaient très rares dans le village de Mohand, comme dans la plupart des villages kabyles. À sept heures, Mohand entendit le moteur du seul camion de son village se mettre en route. Quand le camion arriva près de lui, Mohand lui fit signe de s'arrêter, puis il monta et s'installa à côté du chauffeur.
Comme il n'y avait pas d'autre moyen de transport, le propriétaire du camion convoyait aussi bien de la marchandise que des personnes. Des bancs étaient installés à l'arrière pour permettre de s'asseoir ...
Mohand, avait hâte d'arriver à Tizi-Ouzou, … mais le camion s'arrêtait dans tous les villages pour ramasser des gens qui se rendaient au souk de Tizi-Ouzou.
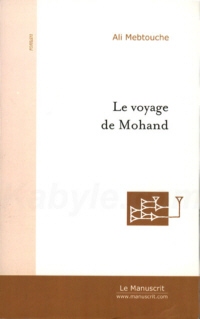 Ali MEBTOUCHE
Ali MEBTOUCHE
Le voyage de Mohand
Autobiographie
Éditions Le Manuscrit,
Paris, 2004
07:13 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook
Facebook
30/06/2008
Yeux de feu ( Mohamed BOUKACI )
À Tighilt, le crieur public avait appelé à un rassemblement des villageois. Des hommes de tous âges s'étaient déversés vers la djemâa et prirent place sur les sièges faits de dalles de schistes. Cette place publique formait un quadrilatère et face à l'entrée principale se trouvaient des sièges pour les cinq notables et le cheikh de la localité. Ce dernier préluda à la profession de fois rituelle que chacun écouta dans une attitude hiératique les mains jointes puis l'Amin, premier responsable, prit la parole :
- Hommes du village nous avons décidé de vous réunir ce soir parce qu'en paysans, notre existence est liée à notre cheptel et à nos terres. Cependant un fléau menace nos bêtes domestiques et peut-être même nos vies. Les habitants de Lazib nous ont fait part de lions les ayant attaqués jusque dans leurs domiciles. Leurs animaux ont été éparpillés durant la nuit et un homme a failli trouver la mort, attaqué par un de ces félins. Nous savons tous qu'une brebis a été ravie à Da Mohand par une lionne. Et si c'était lui qui marchait en tête du troupeau? ... Cette bête féroce aurait mis un terme à son existence. Non contente de son forfait, elle est revenue trois jours après avec d'autres congénères tuer le bœuf blanc d'Ahmed. Nous ne devons pas rester inactifs.
- Ces derniers temps, ces lions sont devenus plus féroces que de coutume. Jadis, ils se contentaient d'égorger les sangliers dans les ravins ; mais de nos jours, ils ont une prédilection pour nos animaux constituant pour eux des proies faciles. Je n' aurais jamais imaginé qu'ils viendraient en plein jour dévorer mon bœuf dit Ahmed.
- De mémoire d'homme, dit Da Mohand, les lions avaient constitué un fléau pour les villageois. Jadis, nos ancêtres ne possédaient pas de fusils et étaient obligés de se défendre contre ces bêtes à l'aide de haches ou de couteaux. Entre notre race et la leur, la guerre avait toujours fait rage car à chacun de leur repas, ils doivent sacrifier une victime et si nous ne les tuons pas, ce seront eux qui le feront. À mon humble avis, il n'y a aucun pêché à les abattre. N'est-ce pas, Si Tahar?
- Il n'est point péché de tuer l'animal qui commet un quelconque gâchis, dit le cheikh ayant senti que ce vieillard, superstitieux comme la plupart des gens d'âge avancé de son époque, voulait d'abord purifier sa conscience. Tous les prédateurs doivent être tués sans merci de même que les sangliers qui détruisent les récoltes.
- Ne brusquons pas les choses reprit Da Mohand. La bête qui s'acharne ainsi sur nous est La Sournoise, très circonspecte et rusée comme le diable en personne. Elle est capable de se fondre dans les arbres, les buissons et les rochers ou se cacher dans les excavations et les anfractuosités. Cette lionne est une incarnation des divinités malfaisantes de la forêt.
Ces paroles furent aussitôt suivies de murmures de vieillards récitant la profession de foi. À cette époque, les superstitions étaient encore très vivaces, résidus de toute une gangue de croyances primitives. Aussi, ces villageois prêtaient une âme et des pouvoirs surnaturels à de nombreux objets inanimés. Pour eux, les champs, les cours d'eau, les ravins et les forêts étaient habités par des génies manichéistes, pouvant prodiguer leurs bienfaits ou leurs nuisances aux êtres humains.
- Puisque le cheikh affirme qu'il n'y a aucun péché à exterminer ces fauves, nous devons décider de l'attitude à adopter face à eux, reprit le chef du village.
Un homme avoisinant la trentaine prit la parole quoiqu'en ces temps, il soit malséant pour un homme de cet âge de s'exprimer dans un rassemblement du village. C'était aux plus aînés de sa famille de le représenter. Il préluda en ces termes :
- Je tiens à demander pardon à l'assistance car mes paroles ne valent rien devant celles des têtes blanches ici présentes. Mais je propose que des hommes valides organisent des embuscades pour abattre le plus grand nombre de lions possibles. Ainsi, nous débarrasserons la forêt de ces brigands.- Amar ! dit le chef du village, je pense que la proposition est bonne, mais nous devons écouter les avis de tous les gens ici présents.
- Da Makhlouf ! dit un vieux chiqueur invétéré s'adressant au chef du village, nous exposerons nos jeunes à un danger certain. Nous savons tous que ces fauves ne meurent qu'une fois touchés d'une balle entre les yeux ou au coeur. Avec des fusils à silex, de nombreux chasseurs n'avaient fait que blesser ces bêtes, ce qui les avait rendues plus féroces. Il faut trouver autre chose.
Un murmure de mécontentement parcourut la masse de jeunes qui s'était tassée à l'entrée de la place publique faute de sièges, frustrés de ces parties de chasse qui leur filaient entre les doigts.
- Au lieu de pourchasser tous les fauves de cette forêt aussi vaste que la mer, nous ferons mieux de cibler cette maudite Sournoise dit Da Mohand. C'est elle... Et elle seule qui connaît le moindre recoin de la région et entraîne son vieux mâle et ses autres congénères de leur bande à des razzias contre nos animaux. Lorsqu'elle m'a raflé ma meilleure brebis, elle s'est dirigée du côté de Tighzert, direction qu'elle a également prise en emportant un quartier de viande du bœuf d'Ahmed. Pas de doute ! ... Elle a une progéniture dans les parages. Nous devrons la tuer et exterminer ses petits qui risquent de devenir de terribles égorgeurs, à l'instar de leur mère.
- Mais ! ... reprit le vieux chiqueur, pourrons-nous massacrer ces petits sans encourir une malédiction. Ils n'ont encore jamais tué une proie et les divinités de la forêt les protègent...
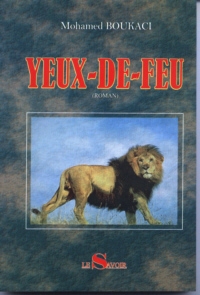 Mohamed BOUKACI
Mohamed BOUKACI
Yeux de feu
pages 36-39
Éditions Le Savoir
Tizi-Ouzou, 2007
07:12 | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook
Facebook
21/06/2008
Nuit d’angoisse à Iferhounène (Abdenour Si Hadj Mohand)
Kabylie, Décembre 1958
Les hommes et les enfants qui étaient à Michelet, ne sont toujours pas de retour. Un contrôle spécial allait les retenir jusqu’à une heure avancée de la nuit. Plus tard je saurai que les raisons de ce retard étaient dues à l’assassinat d‘un haut gradé français dans la journée du souk, un certain lundi de septembre 1958, que les envahisseurs tenaient à venger.
Nos soukards, les clients du souk, du marché si vous voulez, seraient-ils soumis à un contrôle sévère ou tout simplement avait-on pour seul dessein de punir la population pour cet acte «terroriste» ? , ou encore s’agirait-il d’une ruse d’un quelconque stratège militaire assoiffé de sang qui voulait voir le sang des indigènes kabyles couler.
20 heures : nos hommes ne sont toujours pas de retour. Ils sont toujours retenus à Michelet par les militaires de cette localité. Au village, les enfants attendaient leur retour pour se mettre quelque chose sous la dent. Des centaines de bouches d’enfants, ce jour historique, un lundi d’hiver 1958, sécrétaient, comme le chien de Pavlov, la salive sans rien digérer. La peur de mourir, n’avait même pas inhibé leur métabolisme, car ils sont enfants et certains même bébés inconscients. Leur maman n’a rien à offrir à ces bébés, ce jour. Cette maman adulte, elle comprend les dangers qui guettent son mari, ou son enfant de 10 ou 12 ans qui ont disparu comme par enchantement.
…
21 heures, rien !
Ce n’est qu’aux environs de 23 heures que notre troupe de soukards, parmi des enfants a été relâché.
Minuit passé : rien n’indiquait un signe de leur retour. Minuit 30 : pendant que toute la population attendait chez elle, le retour, qui de son père, qui de son fils, qui de son frère ou cousin, une longue rafale partit du camp, déchirant le silence lugubre d’une nuit glaciale d’un hiver montagneux. Puis ce sont toutes les armes du monde qui se sont mises à cracher le feu dans la direction du village. Chose certaine, indiscutable, c’est que les sources des feux se localisaient au niveau du camp. La direction que prenaient ces projectiles : le village. Une précision de taille nous indiquait qu’il ne s’agissait pas d’une attaque opérée par les «fellaghas» pour utiliser l’expression cher au lieutenant PELARDI.
Nous, enfants de 8 ans, nous savions que lorsque les troupes de Amirouche harcelaient les chasseurs alpins campés à Iferhounène, cela commençait généralement par une sorte de provocation, par un coup de fusil de chasse ou de PA. Puis les armes de tous calibres se sont mises subitement à envoyer leurs salves des quatre côtés du camp.
La riposte se fait évidemment aussi violente qu’imprécises Les sentinelles, souvent des jeunes de 20 ans, qui accomplissant le service militaire, et n’avaient généralement jamais croisé cet ennemi invisible, apeurés, tétanisés se mettent à tirer dans tous les sens. Au Blockhaus, où se trouve le fusil mitrailleur, on se contentait d’appuyer sur la gâchette sans avoir au préalable fixé sa cible. Une réaction en chaîne de panique des soldats du camp, nous donnait l’impression, nous jeunes enfants sans armes ni protection, que la guerre d’Algérie était entre les mains de gamins qui n’attendaient que l’arrêt des crépitements des armes pour rentrer chez eux. Ils ne se doutaient pas qu’une balle perdue, ou bien ajustée pouvait emporter une âme d’un vieux, d’une femme ou d’un enfant, dans ces circonstances mais jamais celle d’un fellagha.
C’est ce qui allait se produire ce jour de début d’hiver 1958 à Iferhounène.
Nos soukards ont eu le temps de franchir par son flanc nord, le camp, en passant sur le sentier tracé , à l’Ubac, face au village Aït Hamou distant d’eux de 200 m à vol d’oiseau.
La première sentinelle franchie, il n’y’avait eu aucun incident. Ils étaient nombreux ce jour là, des vieux, des moins vieux, et des enfants de 10 à 12 ans
Mon père était parmi eux, mon frère Mohamed et aussi mon neveu Mohand El Hacène. Mon père avait 48 ans. En traversant une portion de terrain très escarpée, appelée Amalou qui surplombe le camp, et accompagné de leurs ânes chargés de provisions effectuées à Michelet, l’ensemble des passagers avait maintenant remonté la pente pour se positionner en sandwich entre le camp et le village à un niveau d'altitude égale. Ils avaient maintenant la deuxième sentinelle derrière eux. C’est ce moment qu’a choisi la sentinelle pour ouvrir le feu de son fusil mitrailleur sur les passants qui pourtant avaient le dos tourné à celle-ci, dans leur progression vers les premières maisons du village, qui se situent à ce moment à moins de 100 mètres du camp
Malgré le signal donné par mon père dont l’appel de détresse avait retenti, couvrant les décibels des détonations des armes lourdes qui se sont mises de la partie, son cri de SOS lancé en direction de la sentinelle n’avait pas empêché les tireurs de continuer à cibler cette fois nos hommes et nos enfants qui les accompagnaient. L’appel de détresse lancé par mon père, « ATTENTION S’IL VOUS PLAIT MICHELET », était entendu jusqu’aux fins fonds du village, pourtant très effilé et escarpé à ses extrémités. Le village entier avait entendu cet appel adressé aux tireurs. Mon grand père avait eu cette remarque en entendant cette voix qui lui était familière. Il savait que cet appel ne pouvait venir que d’un Algérien malgré son expression en langue française. Mais il s’était abstenu de supposer quoi que ce soit de peur d’effrayer les enfants qui tous attendaient leur dîner qui n’arrivait pas. La faute n’est désormais pas à la maman, tous étaient convaincus comme des grands, mais au Roumi qui les a privés de leur ration de survie. C’était comme cela qu’il voulait leur expliquer, au cas où il devait s’agir d’une erreur, qu’ils étaient des passants civils de retour du marché de Michelet. Rien n’y fait. Toutes armes ont continué à tirer dans le sens du village en direction de passants qui s’approchaient de plus en plus des maisons. Les passants s’étaient mis à courir dans tous les sens pour échapper aux balles assassines. Et c’était à qui rejoindrait le premier, à vitesse effrénée la première maison qui se présentait à lui. Mon frère trébucha juste à ce moment à hauteur de la fontaine du village bien exposée au tir de la sentinelle. Cet incident le sauva d’une mort certaine car l’impact des balles sur le mur blanc de la fontaine témoigneront pendant longtemps de ce crime qui ne dit pas son nom. Mon père avait alors foncé droit devant lui pour se fondre chez les Aït Bouahtmane-Hattab qui l’accueillirent avec tous les soins dont on entoure de coutume les invités de marque chez les Kabyles.
Au bout de quelques minutes un silence de mort s’était installé et les armes se sont tues. Pas une balle de plus, pas un cri même d’animal ; les habitants du village n’étaient jusqu’à cette minute précise informés de quoi que ce soit et ne savaient donc rien de ce qui s était passé à l’exception des familles qui avaient reçu la visite impromptue des revenants de Michelet. Car personne ne pouvait sortir à cette heure et surtout après ce genre d’événements, qui s’apparente à une attaque du camp par les fellaghas. Mon grand père Saïd, lui comme tout le monde d'ailleurs, avait pensé qu’il s agissait d’une attaque, comme on en avait l’habitude de vivre presque toutes les nuits et parfois même de jour. Les troupes, ou les arrières du maquisard insaisissable Amirouche ne cessaient de harceler le camp.
…
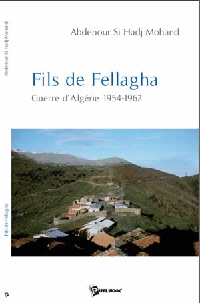
Abdenour Si Hadj Mohand
Fils de Fellagha
Éditions PubliBook
19:22 | Lien permanent | Commentaires (19) | ![]() Facebook
Facebook
13/06/2008
Commando sur Tunis (Gérard de Villiers)
Dans la pénombre, Malko distingua un uniforme verdâtre et un visage féminin, avec des cheveux bouclés très noirs. L'apparition tenait dans la main droite un revolver de gros calibre. Sans un mot, elle fléchit les genoux, saisit son poignet droit dans sa main gauche et tira dans sa direction. Il venait de faire connaissance de Tourya.
…
Ian Parker, la chemise soudée aux omoplates par la sueur, renonçant à trouver une place sous les platanes de l'avenue Habib Bourguiba, se gara en double file en face de l'International Tunisia Palace. Aussitôt repéré par le regard nettement réprobateur d'une «souris grise», contractuelle de la police tunisienne, qui écumait les alentours, un walkie-talkie accroché à l'épaule. Les Tunisiens avaient trouvé un moyen très simple de décourager les trop nombreux touristes algériens qui venaient remplir leurs coffres de provisions introuvables chez eux, mettant systématiquement des sabots de Denver aux véhicules immatriculés en Algérie à partir de la trentième seconde de dépassement... Conduisant une voiture de location, Ian Parker ne craignait pas ce genre de mésaventure. Abandonnant sa Fiat 127, il pénétra dans le hall de l'International Tunisia Palace, grande tour de béton assez tristounette.
Les rares employés en service, écroulés derrière leur desk, s'éventaient avec des journaux. Deux jours plus tôt, la climatisation de l'hôtel avait expiré dans un grand dégagement de vapeur. Alors que Tunis connaissait une des pires vagues de chaleur de son histoire ! Le thermomètre affichait joyeusement 60° au soleil et 45° dans les rares coins d'ombre... Comble de bonheur, on était en plein Ramadan, et les malheureux Tunisiens, interdits de nourriture et de boisson de l'aube à sept heures quarante-cinq du soir, se traînaient comme les naufragés de la Méduse.
Ian Parker parcourut le hall des yeux, déçu. Tourya n'était pas là. Il alla inspecter la cafétéria au fond du lobby. Pas une femme, mais un spectacle surréaliste. Toutes les tables étaient occupées par des hommes. Sans la moindre consommation devant eux. Ramadan oblige. On aurait dit des acteurs attendant le départ d'une scène. L'Américain retraversa le hall-sauna sous le regard indifférent des employés, agacé et en même temps résigné. Ce qui lui était survenu la veille était trop beau ! Arrivé sur son voilier le matin même à Sidi-Bou-Saïd, le port de plaisance de Tunis, il s'était rendu à l'International pour y prendre un verre et acheter des journaux. Au moment où il allait en repartir, un équipage des Libyan Airlines arrivait. Ian Parker avait tout de suite repéré un visage ravissant sous un des calots couleur sable. Des traits à la fois enfantins et durs, avec d'étonnants yeux gris qui trahissaient une ascendance kabyle, un nez mutin et une bouche de star. Curieusement, il avait l'impression de connaître cette fille ! Probablement intriguée par l'insistance avec laquelle il la dévisageait, l'hôtesse lui avait adressé un vague sourire. Ian Parker s'était aussitôt rué dans la brèche.
- J'ai l'impression de vous connaître, avait-il dit un peu platement. J'ai vécu longtemps à Tripoli, j'en arrive d'ailleurs...
L'hôtesse, restée à la traîne de ses camarades, lui avait jeté un regard neutre.
- Ah bon, c'est possible.
- Peut-être dans une réception, avait insisté Ian Parker. J'ai travaillé à l'ambassade américaine, je suis diplomate... Je m'appelle Ian Parker. Je suis en vacances ici pour le moment...
Une lueur d'intérêt avait traversé les yeux gris.

Gérard de Villiers
Commando sur Tunis
Genre : Policiers
Editeur : Plon, Paris, France
Sorti en 1982
08:01 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook
Facebook






