17/11/2007
Bleu permanent (Brahim ZEROUKI)
Je sais presque parler la langue du pays et je n'ai toujours pas découvert la ville, Tagdemt la mère des Djazaïr d'Occident, celle qui empêche le Khalife de dormir, celle qui protège tous les réfugiés de Bagdad, du Royaume Franc et d'ailleurs, celle dont on dit que tout voyageur qui la voit s'y installe.
- C'est la vérité.
- À ce jour, je n'ai pu voir que quelques maisons, des moulins, le réservoir d'eau... Quand on me dit "la porte des moulins", je m'attends à voir porte et murs, mais rien de tout cela. Je n'ai aucune idée de Tagdemt. Au cours de mon voyage, à partir de Chelif, nous sommes passés dans la vallée de la tribu des Miknassa.
- Ce sont les meilleurs des gens!
- Il y avait dans la vallée des Miknassa des villages portant les noms de toutes les tribus sauf celui des Miknassa.
- C'est souvent comme ça.
- On s'est arrêté dans un village soi-disant des Sanhadja.
- Ce sont les meilleurs des gens.
- Mais c'étaient plutôt des Zenata qui vivaient là avec d'autres.
- Oui, je connais bien. Ce sont les meilleurs des gens.
- Mais personne ne portait le nom de Zenata et les gens venaient d’un peu partout.
- Oui, il doit en être ainsi.
- Il y a partout des noms de tribus. Mais il n'y a de tribu nulle part.
- C'est ça les tribus. Elles sont insaisissables.
- Tagdemt, ça veut dire quoi ?
- La plus ancienne.
- L'imam m'a dit : « la plus récente ».
- Oui, Tagdemt, c'est les deux à la fois.
- Tous les mots que j'apprends en ce moment veulent dire quelque chose et son contraire.
- C'est bien.
- Tagdemt est la capitale de l'Occident et son contraire!
- Face à Rome, Byzance et Bagdad, elle représente tous les Amazigh d'Occident, face aux Djazaïr, elle n'est qu'une Djazira parmi d’autres.
- Où se trouve-t-elle?
- Le Prophète a dit : « les hommes du Maghreb n'ont pas de ville où habiter, pas de citadelle où se retrancher, pas de marché où commercer. Ils sont les meilleurs des hommes. »
- Dans le Regnum Francorum, ceux qui vivent ainsi sont réduits au servage et leurs enfants doivent mourir sur des champs de bataille vils et déshonorants.
- Ici c'est le contraire. Personne ne fléchit les genoux.
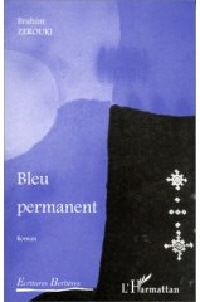
Brahim ZEROUKI
Bleu permanent
Roman
L'Harmattan (Ecritures berbères)
16:05 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
29/10/2007
LE LION, LE CHACAL, LE MULET ET L'ASSEMBLEE DES ANIMAUX (Moulièras)
Un jour, tous les animaux se réunirent dans un endroit. Ils se dirent entre eux : Faisons une ruse contre le mulet pour le manger. Questionnons-nous mutuellement sur notre père : celui qu'on interrogera devra dire qui est son père. Le mulet ne le dira pas, car il a pour père un âne, il en aura honte ; il ne dira pas: l'âne est mon père; nous dirons alors entre nous : celui qui ne nommera pas son père, nous le mangerons.
Ils se mirent à s'interroger mutuellement et commencèrent par le lion :
- Oncle Abou'l H'arith, qui est ton père?
- Le lion.
Ils continuèrent par le chacal :
- Moh'and, qui est ton père?
- Le chacal.
Ils passèrent à l'âne :
- Qui est ton père ?
- L'âne.
Puis au bœuf :
- Qui est ton père?
- Le boeuf.
Puis au cheval :
- Qui est ton père ?
- Le cheval.
Ils arrivèrent au mulet :
- Qui est ton père?
- Le cheval est mon oncle maternel.
Ils se mirent à rire, le laissèrent et passèrent aux autres. Ils firent la même question au hérisson, à la tortue, à la hyène, à la fouine, au renard, au lévrier, au sanglier et au chien qui tous firent une réponse semblable. Quand ils eurent fini, ils revinrent au mulet et lui dirent :
- Allons, mulet, dis-nous qui est ton père ?
- Je vous dirai seulement que le cheval est mon oncle maternel.
- Nous te demandons après ton père, non après ton oncle.
- Eh bien, voyez : mon père a mis de l'écriture à mon pied; regardez cette écriture, vous trouverez mon nom. Le chacal alla l'examiner de loin. Il dit au lion:
- Oncle Abou’l H'arith, c'est à toi qui as de bons yeux de déchiffrer les lettres qui sont là, parce que cette écriture-là est griffonnée, de plus, j'ai mal aux yeux, ils n'y voient pas. Allons, regarde, toi, tu as de bons yeux; c'est toi qui déchiffreras ces lettres.
Le lion s'avança pour examiner de loin.
Le mulet lui dit :
- Avance, toi, pour bien voir.
Il s'approcha; le mulet le laissa faire. Quand il fut près d'arriver à son pied, l'autre se dressa sur ses pieds de devant et le frappa avec ceux de derrière; il l'atteignit au front et le renversa en arrière. En le voyant tomber et se débattre, le chacal se précipita sur lui et le saisit par la queue pour le dévorer.
Le lion lui dit :
- Moh'and, est-ce là ce dont nous sommes convenus?
- Pour moi, répondit le chacal, c'est celui qui tombe que je prends pour ma nourriture. Si c'était le mulet qui fût tombé, c'est sur lui que je me serais jeté. Comme c'est toi, laisse-moi me rassasier de ta chair; c'est là ma chance.

Moulièras
Légendes et contes merveilleux de la Grande Kabylie, Paris
E. LEROUX, 1894
CONTES POPULAIRES D'AFRIQUE GRANDE KABYLIE
07:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
19/10/2007
JOURS KABYLES (Georges M. MATTÉÏ)
13 juillet 1956
Quelques baraques, une murette de pierre, cinq ou six oliviers faméliques, une sorte de falaise derrière laquelle se trouvait un petit village appelé T... En face de nous la piste serpentant vers I..., notre P.C., d'où gouvernait notre distingué commandant P.... Au bord de la piste, la surplombant, deux villages, A..., M..., bien visibles, avec leurs toits rouges. Plus loin, à droite, sur un piton boisé, un village que nos compagnons surnommaient « le petit Paris », à cause de sa propreté... I... B....
C'était le soir du 13 juillet, une dizaine de types contrôlaient les Kabyles qui circulaient sur la piste venant d'A... (Notre poste était situé à la rencontre de trois pistes.) Les hommes et les jeunes gens des douars voisins ont l'habitude de descendre de leur village, sur leur bourricot, chapeaux de paille enfoncés sur les oreilles ou battant leur dos. Je pensais aux films mexicains, aux peones silencieux. Ce jour-là, j'avais été d'escorte. Fatigué, j'essayais de lire un peu pour échapper à l'abrutissement de cette vie. Levé cinq heures. Escorte sur la piste, ocre de poussière, sueur, peur, la montagne hostile, au retour, charrier des pierres, un casque d'eau pour la journée... Un copain me montra le soleil et me dit « qu'il devait se coucher vers la gare de Tizi-Ouzou ».
- J'amène des clients ! Le caporal-chef A... entra dans le poste, poussant devant lui deux Kabyles, précédés de leur mule. Mouvements divers dans le poste. - Qu'est-ce que c'est ? Où les as-tu piqués ? Pourquoi ? Le caporal-chef, un grand blond, veule, nous montra un paquet de chaussettes kaki, en riant. (Depuis quelques mois le port du vêtement kaki est interdit en A.F.N.) Les deux Kabyles, sous la menacé d'un P.M., déchargèrent leur mule. Les hommes de garde éparpillèrent paquets de sucre, café, semoule, boules de gomme. Je regardais cette scène, de loin, je pensais que nous faisions un boulot de flic. Des éclats de voix me tirèrent de mes réflexions.. Des hommes se disputaient autour des deux prisonniers. Le caporal-chef aidé d'un deuxième classe, D..., une petite frappe qui bouffe du bougnoule (un an d'A.F.N.), le type du tueur. Ils empoignèrent un des deux hommes, le poussèrent vers le mirador et se mirent en demeure de le ligoter. C'était le plus jeune des prisonniers. Il tenta de s'expliquer. - C'est pas la justice, j'ai rien fait! L'autre lui cloua le bec d'une gille. Le Kabyle se tut, puis continua de se lamenter: « C'est pas juste... » Un cercle s'était formé. Pas un responsable ne se montra. C'était l'heure de l'apéritif au mess. Chacun donnait son avis : - C'est dégueulasse. - Ça se voit que vous débarquez, vous ne les connaissez pas. - Nous ne sommes pas des flics. - Tous des salauds. - Enfin, devant les deux prisonniers qui avaient compris que la compagnie s'engueulait à cause d'eux, ce fut le début d'une altercation. Les prisonniers furent malmenés, quelques coups de poing furent échangés entre les militaires de différents avis. L'affaire se termina par l'intervention de l'adjudant B..., qui élimina l'hystérique D..., par un K.O. spectaculaire. Comme punition, D... fut affecté à l'escorte personnelle du commandant P... Quelques jours plus tard, au cours d'une fouille, celui-ci abattait un homme caché dans un buisson. Ce dernier était sans arme et immobile. - Je ne crois pas qu'il y ait eu enquête à la suite de cette exécution sommaire. Le Kabyle abattu était du village d'I... (Tentative de fuite... c'était classique.) Quant aux deux suspects de cette soirée, ils furent libérés, le lendemain matin, après un contact avec la gendarmerie. Le plus vieux m'a serré la main: - Mon fils va être content, me dit-il simplement.
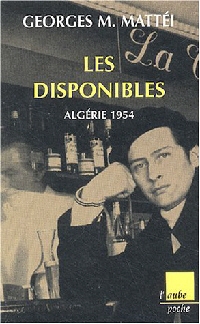
Georges M. MATTÉÏ
JOURS KABYLES
(Notes d'un rappelé.)
LES TEMPS MODERNES
N° 137-138 JUILLET AOUT 1957
(numéro saisi)
Autre titre de Georges M. Mattéï
07:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
09/10/2007
LA REKBA DU SERGENT (BOU-YABÈS)
Après avoir tiré ses guêtres sur quatre des parties du monde, le vieux sergent de tirailleurs Kassi était revenu dans sa tribu des Ouadia, la poitrine garnie de médailles. Il avait en poche un bon pécule provenant de ses rengagements, un bon titre de pension et se regardait comme le plus heureux des Kabyles de sa tribu. Il lui manquait bien le bras gauche, emporté par un boulet à Puebla, un morceau de la cuisse du même côté, laissé dans les blés de Palestro, un lobe d'oreille, il ne savait trop où, mais on peut vivre très aise, sans être absolument complet. Un peu partout, son corps était balafré de longues estafilades, ponctué de petites taches brunes, coups de sabres ou passage de balles : cela ne l'empêchait point d'être content de lui et de son sort, d'être considéré du bureau de Fort-Napoléon où il était, comme un futur président.
Entre-temps, durant un congé de semestre qu'il avait obtenu au commencement de la campagne de Crimée, pour se remettre du choléra, il avait acheté, en justes noces, une blanche Kabyle des Ait Ouacif, puis l'avait plantée là pour reprendre le beurda, son congé expiré. Sa femme de quelques mois avait vécu depuis ce temps chez son père, élevant son fils, et attendant impatiemment son mari à l'aide de quelques amourettes avec les gars du voisinage.
Le vieux tirailleur n'en avait cure il ne l'avait jamais revue, n'ayant point eu le temps de revenir au pays. Il avait rencontré du reste des femmes de toutes les couleurs sur sa longue route, a travers les mondes et, à Paris, où il était avant de partir pour le Mexique ; les nounous le prisaient fort à cause de ses longues moustaches blondes, son entrain endiablé et sa belle ferblanterie.
Il s'installa tranquillement sur les biens de ses pères, gérés en son absence par son cousin germain, fumant de longues pipes en bambou, rapportées de l'Extrême-Orient, racontant à ses compatriotes ses exploits militaires et ses prouesses amoureuses, réelles ou imaginaires. Joyeux compère, il était de toutes les diffas, de tous les mariages ; ses histoires passionnaient son rude auditoire et plus d'un jeune Kabyle avait signé son engagement pour pouvoir voyager en les pays bleus et roses que dépeignait le sergent. Il s'était donné lui-même le nom de Kassi Guiril, Kassi au bras, pour plaisanter sa glorieuse infirmité, et ce nom devint célèbre comme celui d'un conteur de belles histoires, mérite très apprécié des Kabyles illettrés.
Un beau jour, il se lassa de sa vie de garçon, trouvant le coucouss que chacun lui offrait, tour à tour, trop fade ou trop pimenté et sa natte solitaire bien dure, sans une tamtout pour servir d'oreiller: les célibataires sont suspects en Kabylie, et plus d'un mari, craignant pour son front, lui avait offert sa fille. Kassi se souvint alors qu'il avait été marié et, se remémorant les douceurs de sa lune de miel, prit son bâton de fenouil et s'en fut aux Ait Ouacif chercher sa légitime.
Il oubliait que les années avaient marché depuis ses courtes épousailles et que la belle Smina d'antan devait avoir les yeux chassieux, la peau crevassée et peu remplie. Il se pourléchait donc en arrivant près du village, se rappelant le jour où il emmenait sa fiancée à califourchon devant lui, sur le même mulet, au son des tambours, à travers la fumée des coups de fusil il lui semblait sentir encore les rondeurs chaudes de ce corps, lorsque la vierge se serrait contre lui, effrayée par les soubresauts du mulet descendant les chemins en escalier.
Il était, ma foi, presque aussi ému qu'à sa première bataille quand il heurta la porte de son beau-père. Tout le monde était aux champs et ce fut une vieille, restée pour faire les galettes, qui vint lui ouvrir
- Eh ! la mère, fit le joyeux tirailleur, c'est bien ici la maison de Belkassem, le fabricant de beurdas ?
- Oui, répondit la gardienne du logis ; je suis sa fille, que lui veux-tu?
- Ah ! tu es sa fille, tu dois donc être ma belle-soeur, car je suis Kassi, l'époux de Smina.
- Tu es Kassi ! toi, dit la vieille souriante et frappant des mains de surprise, quelle joie ! moi je suis Smina, ta chère femme
- Hem !... fit le sergent, en faisant un bond en arrière, et il contempla sa moitié avec ébahissement, se gardant des bras ouverts et tendus vers lui.
Elle n'était pas belle sa Smina, elle n'était pas ronde, non plus, mais très anguleuse. Plus de grands yeux noirs cernés de kohl, plus de cheveux bronzés, réunis sous le foulard de soie jaune et rouge; plus de globes ronds sous les plis du haïk indiscret. Un amas de vieilles chairs pendantes de-ci, de-là, sous des haillons crasseux, une figure semblable à une gourde percée de cinq trous, plus ou moins larges, plus ou moins profonds, voilà ce qui restait de la plantureuse Smina, douce de peau et de parler, ardente aux baisers et au travail.
Kassi eut vite pris une décision : ses illusions s 'étaient envolées et la réalité lui paraissait peu propre à le consoler de sa vie de garçon.
- Ah ! tu es Smina, fit-il, avec la gravité qui convient à un vrai Kabyle, eh bien, je suis heureux de te revoir... et, pivotant militairement sur ses talons, il la laissa là, ébahie.
Il s'en fut s asseoir à la Djemâa pour chercher un hôte parmi les anciens qui, peut-être, ne l'avaient point oublié.
Il y resta longtemps, à peu près seul, songeur, assis près du passage couvert, épiant les arrivants pour y reconnaître les amis d'autrefois. Il vint enfin un vieux, très vieux, à la barbe blanche, cassé en deux, qui, soutenu par un solide garçon de quinze à seize ans, s'avançait en traînant la jambe. Kassi reconnut le vieux, tout d'un coup, à son oeil droit qui louchait en clignotant
- Eh ! eh ! Belkassem ! cria-t-il en faisant de grands gestes, le salut sur toi ; regarde-moi, je suis ton gendre, Kassi le sergent, je suis bien heureux de te retrouver, je n'avais pas encore vu un seul ami.
Le vieux s arrêta au milieu du passage regardant, d'un air hébété, ce manchot qui agitait vers le ciel son bras valide.
- Il est sourd, mon père, dit le jeune homme, mais ton fils Ah est devant toi et que le nom du Très-Haut soit cent fois béni, puisqu'il me permet enfin de baiser ta main.
Kassi tombait de stupéfaction en stupéfaction. Son fils, son fils à lui, ce beau gaillard déjà homme, aux grands yeux noirs fendus en amande, aux cheveux blonds, à la lèvre estompée d'un fin duvet !... Il n'en revenait pas ! Vaguement, il se souvint que Smina était grosse à son départ et qu'il était parfaitement possible qu'elle eût accouché depuis le temps qu'il ne l'avait vue. C'était bien là son fils, il ne pouvait en douter: il reconnaissait ses yeux noirs avec sa tête blonde de jadis, comme il s'était vu le jour où la femme du commandant, celle qui se peignait comme une Ouled Naïl, l'avait fait entrer dans sa chambre, garnie de grandes glaces où il s'admirait.
Pendant ces réflexions, le beau jeune homme courba la tête, et prenant l'unique main du sergent, la baisa et la plaça sur sa chéchia en signe de soumission. Kassi n'y tint plus bravement, à la française, comme il l'avait vu faire aux nounous du Jardin des Plantes, il saisit par l'épaule ce fils tombé du ciel et l'embrassa à pleine bouche sur les deux joues.
Le vieux Belkassem, n’y comprenant rien, regardait de plus en plus ahuri.
Le fils reconduisit alors son père à la maison de l'aïeul et toute la famille s'étant réunie, on tua, non pas le veau gras, mais un bouc d'un an qui, la nuit venue, couronna un coucouss monumental duquel il ne resta bientôt plus que le plat d'aulne rouge.
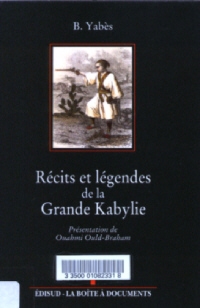
BOU-YABÈS
Pseudonyme de Henry DUBOULOZ (1857-1947)
LA REKBA DU SERGENT
Extrait de « Récits et légendes de la Grande-Kabylie »
ÉDISUD La boite à documents 1993
1ère publication ALGER 1894
07:30 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook
Facebook
29/09/2007
L’épouse du magicien (Brian MOORE)
Pages 174-177
Le lendemain, au point du jour, Emmeline et Lambert attendaient Deniau, en compagnie de Jules, dans la cour de la résidence. Ils prendraient la diligence et feraient route ensemble pour cette première étape du voyage qui devait les conduire en Kabylie. Mais, quand le véhicule franchit bruyamment les grilles, le colonel n'était pas au rendez-vous. Ce fut le jeune Arabe entrevu chez Deniau qui bondit du siège du cocher où il était perché pour leur annoncer, avec un accent très prononcé, que son maître avait été retardé par des "obligations d'ordre politique". Il les rejoindrait avec chevaux et chameaux pour la dernière étape du voyage.
- Au-delà d'Aïn Sefra, il n'y a plus de route, monsieur, expliqua le jeune homme. Il faudra continuer à cheval. Mon maître fera tout son possible pour vous y retrouver.
Il s'inclina ensuite devant Lambert auquel il ouvrit la portière. Ce dernier se tourna alors vers Emmeline pour la laisser passer, mais le garçon s'interposa en expliquant:
- Non, monsieur. Vous devez passer devant la femme. C'est vous le marabout.
Le jeune Arabe lui tendit la main pour l'aider à gravir le marchepied. Cependant, quand vint le tour d'Emmeline, il se contenta de la dévisager de son regard haineux, désormais familier, et lorsqu'il referma la portière derrière elle, elle entendit qu'il faisait mine de cracher.
Les bagages et accessoires de scène chargés et arrimés sur le toit, Jules prit place auprès du cocher, le jeune garçon s'inclina vers Lambert en signe d'adieu et les zouaves présentèrent les armes quand la diligence s'éloigna, dans un fracas d'essieux, en suivant la rue de la Marine. Quelques minutes plus tard, ils avaient quitté la ville et, lancés au grand trot sur une route large, traversaient des villages isolés dans un paysage aussi desséché que la mort.
Auprès d'un mari plongé dans la lecture, selon son habitude, Emmeline fixait la route d'un air absent. Levée avant l'aube pour laver ses cheveux et se coiffer, elle avait choisi de revêtir une robe de soie rose et des gants de dentelle, plus adaptés à un déjeuner mondain qu'à ce voyage. Elle avait également passé le bouchon de son parfum favori sur ses poignets, sa gorge et sa nuque, et fleurait une délicate odeur de muguet pour ce trajet qui devait l'amener à partager avec Deniau l'espace réduit de la voiture. Elle avait agi comme un automate car elle refusait d'envisager ce que lui réservait l'avenir. Mais, quand le jeune Arabe avait annoncé que le colonel ne serait pas du voyage, elle avait brusquement cédé à la colère. Cette déception la fit toutefois réfléchir. Si le colonel se décidait, peut-être céderait-elle enfin à ses avances.
Elle éprouvait un sentiment de manque et, dans l'incertitude où l'avait plongée cette défection, le voyage lui parut interminable. Le soir, la diligence faisait halte dans des hôtels tenus par des colons et Lambert se montra écoeuré par la cuisine quelconque, servie à la table commune où ils subirent la compagnie de voyageurs de commerce français. Tout comme Emmeline, il redoutait que les mystérieuses "obligations d'ordre politique" n'empêchent Deniau d'être au rendez-vous. Mais le matin du troisième jour, quand la diligence pénétra cahin-caha dans la cour du bâtiment abritant le Bureau arabe, à Aïn Sefra, ils virent Kaddour, l'esclave sénégalais de Deniau, s'incliner solennellement devant eux pour leur ouvrir la portière.
Emmeline accueillit le géant avec un sourire ravi lorsqu'il l'aida à descendre de voiture. Quelques instants plus tard, ils faisaient la connaissance du capitaine Hersant, chef du Bureau arabe d'Aïn Sefra. Deniau était en ville où il se procurait des chameaux, leur fit-il savoir, mais le colonel les rejoindrait pour le déjeuner.
Midi venait de sonner et les muezzins avaient lancé leur appel. Emmeline surveillait la cour et les dos arabes prostrés en prière sous ses yeux, lorsqu’elle vit, un peu plus loin, trois chameaux franchir la grille principale. Assis en tailleur sur le chameau de tête, elle aperçut Deniau, très à l'aise et vêtu d'un burnous brun sur son uniforme. Il retint la petite caravane jusqu'à la fin des dévotions. Puis il fit agenouiller son chameau, se laissa glisser à terre avec élégance et traversa la cour à grands pas en agitant sa cravache en signe de bienvenue.
- Henri, il est arrivé!
- Où cela?
Lambert s'approcha de la fenêtre pour jeter un coup d'oeil à l'extérieur. Mais Emmeline avait déjà couru vers son miroir, devant lequel elle rectifia fébrilement sa coiffure, en proie à une telle excitation qu'elle se précipita dans l'escalier. Au moment où Deniau pénétrait dans l'entrée, elle vint à sa rencontre et lança, aux anges:
- Ah, nous nous sommes fait un tel souci! Je me demandais... Mais vous êtes là!
Le message était clair, il avait compris. Il s'empara de sa main et s'inclina très bas pour la baiser, puis il se redressa et plongea son regard dans le sien.
- Chère Emmeline, fit-il doucement.
La jeune femme vécut l'heure suivante dans l'euphorie. Au déjeuner, elle ne prêta qu'une oreille distraite à la conversation. Puis elle entendit Deniau annoncer à son mari qu'ils devraient se mettre en route sans attendre et maintenir une allure soutenue s'ils tenaient à boucler leur périple avant les pluies d'automne. À cette époque, les routes devenaient en effet impraticables et souvent dangereuses.
- Pour quand l'arrivée des pluies est-elle prévue? s'enquit Lambert.
Page 180
Le lendemain, quand la caravane s'ébranla, ils virent le soleil se lever comme une menace, dans la pâleur de l'aube. La route dont avait parlé Deniau, pas même une piste, n'était en fait qu'un paysage désertique où l'on ne voyait âme qui vive. Sur le rouge de la terre, se détachaient les sourdes tonalités du désert: ocre des vêtements des domestiques, beige et roux du pelage des chameaux, noir et brun des robes des chevaux, dont la monotonie semblait ajouter encore à la chaleur qui s'intensifiait. Au bout de deux heures, le soleil devint une véritable torture.
La tête moite, Emmeline sentait la sueur ruisseler entre ses seins, mais elle talonnait son cheval pour devancer Deniau car elle ne voulait pas qu'il voie ses joues cramoisies et ses cheveux en désordre. Aux alentours de midi, les ondulations des dunes laissèrent place à une succession de ravins escarpés aux pentes quasi verticales, sur lesquelles sa monture glissait et trébuchait, risquant de la jeter à terre.
Peu après midi, Deniau décida de faire halte et les serviteurs montèrent prestement un abri en peau de chèvre, sous lequel ils disposèrent un repas frugal composé de dattes, de pain et de lait de brebis. Avant de s'asseoir sur le tapis où l'on prendrait cette collation, Emmeline se retira derrière la tente pour faire une rapide toilette dans une cuvette. Elle entendit Deniau informer son mari qu'ils logeraient, ce soir-là, sous le toit d'un cheikh du nom de Ben-Gannah, où leur serait servi un repas digne de ce nom.
- L'étape de demain sera plus facile, ajouta-t-il. Le plus dur est fait.
Dans l'après-midi, devant l'immensité du désert, aussi vaste qu'un océan, infini et redoutable, Emmeline, effondrée sur la selle d'une monture fourbue, se demanda comment elle avait bien pu rêver d'une idylle secrète dans un tel environnement.
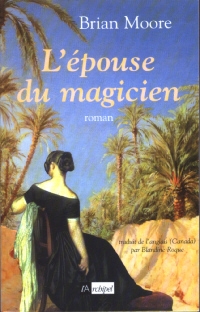 Brian MOORE
Brian MOORE
L’épouse du magicien
Extraits
Traducteur : Blandine Roque
Éditions L’Archipel
06:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook






