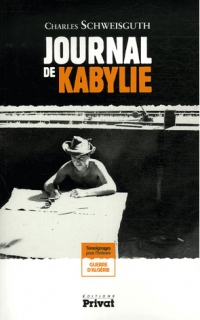21/11/2009
Frères kabyles ( VITO ) Extrait 1
Ils ( Les élèves ) sont fiers de devenir « dégourdis ». Le soir lorsqu'ils arrivent, c'est avec joie qu'ils mettent le village au courant de tout ce qu'ils ont appris. Beaucoup d'autres enfants désireraient les suivre à l'école, et leurs parents en seraient fiers, mais c'est toujours la méfiance vis-à-vis de l'Administration. Si elle intervenait ensuite...
Le lendemain, dans le froid matinal, David et Jean allumèrent le poêle. Les écoliers qui entraient en frissonnant, l'entourèrent avec curiosité. Qu'est-ce que c’est ? Qu'est-ce qui se passe ? Et lorsque le feu crépita, les enfants se regardèrent, ébahis d'entendre le ronflement de la tuyauterie En effet, dans les mechtas le feu ne se faisait que dans le canoun.
Ce moment de surprise passé, de nouveaux « jeux » commencèrent. Le sentiment de l'honneur animait leur esprit de compétition. C'était à celui qui le premier se rendrait au tableau Parfois, Raba gagnait les autres de vitesse, croyant participer à une course. Sa célérité s'arrêtait d'ailleurs là, les questions le laissant ensuite presque toujours pantois. Mohan se considérant suffisamment affranchi, s'éloigna de ses camarades afin de ne pas être copié.
À midi, ils regardèrent avec attention comment David s'y prenait pour faire réchauffer une boîte de conserve. Ils y goûtèrent : c'était bon !
Les garçons s'adaptaient bien à la vie scolaire. La salle était bien chauffée, ils n'en sortaient pas dans la journée, si ce n'est pour leurs besoins dans la nature... À la nuit tombante ils quittèrent l'école, tout heureux de revenir le surlendemain, après le jour de repos hebdomadaire.
Johan était monté avec Marc à Timeri Maasera pour revoir Tibouche. Ils voulaient lui proposer à nouveau de relever ses murs de terrasses. Un vent froid balayait les ruelles désertes. Tibouche, finalement découvert, sortit de la mechta pour causer. Pour l'instant il ne désirait pas entreprendre ce travail à cause du froid. Au printemps il serait toujours temps.
À Tigirt Amar, quelqu'un les arrêta sur le trajet du retour :
- Est-ce que je peux vous envoyer mon fils à l’école ?
Il ajoutait
- Ici nous sommes tous des bourricots avec un air de culpabilité.
- N'exagérons rien ! dit Marc. Tu n'es pas responsable de ton ignorance : tu n'as jamais eu les moyens de t’instruire. Moi aussi, je serais resté un bourricot si je n'avais pas pu aller à l'école.
L’homme ne savait comment exprimer sa gratitude.
…
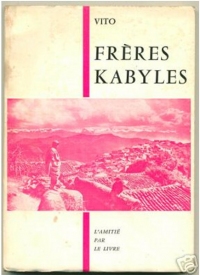 VITO (Pseudonyme de Guy DEJARDIN)
VITO (Pseudonyme de Guy DEJARDIN)
Frères kabyles
L’Amitié par le livre
1970
Extrait Pages 92 à 95
14:12 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook
Facebook
16/11/2009
La Kabylie des Chasseurs Alpins (Roger CONROUX)
« Plus de quarante ans après, lors d’une rencontre des anciens du 6°BCA, j’ai retrouvé Bernard qui se souvenait et m’a rafraîchi la mémoire. Il appartenait à la 4 ° compagnie cantonnée au sud de Michelet, notre PC . Ce jour là il avait été appelé en renforts avec ses camarades. De son côté et pour les mêmes raisons, notre compagnie, la 3°, avait été demandée d’urgence. Bernard se souvenait dans les moindres détails de l’embuscade qui venait de se produire et vers laquelle nos deux compagnies convergeaient rapidement. J’ai écouté avec beaucoup d’émotion son récit dont je vous livre les lignes qui suivent:
« Notre mission en plus des divers crapahuts, gardes et patrouilles, consistent à assurer au col de Tala Oumalou, près du village d’Azerole Kellat, la protection du passage de notre convoi.
Ce convoi relie une ou deux fois la semaine Michelet, Fort-National, Tizi-Ouzou, aller retour.
Ce samedi là, 19 octobre 1957, pas de protection prévue, mais une patrouille pour rechercher, en vue de leur conscription, de jeunes kabyles. Nous fouillons les villages de Ouahzen, Taourirt Menguelet, Tililit, Thamzout.
Il fait très chaud ; nous ne sommes pas loin de Michelet et cela s’annonce plutôt décontracté. Nous avons déjà recruté quelques jeunes villageois qui seront intégrés d’office dans l’armée pour y accomplir leur service militaire.
À onze heures du matin, nous sommes étonnés d’entendre et de voir rouler des camions en direction de Tizi-Ouzou.
Personne n’a apparemment assuré leur protection au sol. Quelques instants plus tard, au loin, en direction de Tala-Oumalou. Nous entendons des coups de feu. Les détonations deviennent de plus en plus violentes attestant du sérieux de l’accrochage. Par radio, le lieutenant Pillot demande des explications et propose le renfort de notre compagnie. Il y a un léger cafouillage car personne n’est très sûr de la nécessité d’une intervention. La radio du convoi pense que l’attaque n’est pas trop grave, mais il n y a pas de liaison avec les véhicules se trouvant à l’avant. Au bout d’un quart d’heure environ, nous recevons l’ordre de nous rendre rapidement sur les lieux de l’embuscade. Un petit groupe rejoint Michelet avec les circonscrits.
Les copains et moi, nous nous partageons en deux sections. Nous connaissons le terrain et, pendant que certains empruntent la ligne de crête, ma section évolue sur la route nationale. Au pas de course, mon fusil lance-grenades à la main avec l’équipe du porteur du fusil-mitrailleur, nous atteignons les lieux du combat.
Hélas, il est trop tard et malgré l’arrivée conjointe d’éléments de la troisième compagnie en provenance d’Ait Hichem nous constatons que leur embuscade réussie, les fells se sont évanouis dans la nature.
Le bilan de cette attaque est lourd.
Nous avons à déplorer sept morts et treize blessés plus ou moins graves. Nous apprenons aussi qu’un de nos véhicules a été pris d’assaut et que les occupants massacrés ont été dépouillés de leurs armes (deux fusils Garant, une carabine US, deux pistolets-mitrailleurs). Ce serait, paraît il, un commando de quatre vingt fellaghas qui a réussi cette embuscade. Notre convoi s’est trouvé pris sous un tir croisé. Les rebelles disposaient d’armement lourd (fusils-mitrailleurs et bazookas).
Nous recherchons et découvrons les emplacements de tir bien aménagés. Notre aviation de chasse vient d’arriver et cherche, dans un ballet bruyant, l’accrochage avec la bande qui s’est éparpillée sur le versant Est du col.
Des hélicoptères se posent et évacuent les blesses les plus graves. Nous ramassons nos morts qui sont entreposés dans un GMC bâché. Le convoi se reforme et, cette fois, les véhicules sous bonne escorte s’ébranlent en direction de Tizi-Ouzou. Un avion Piper sillonne le ciel.
Les jours qui suivent, ordre nous est donné de faire évacuer puis raser les villages d’Azrou Cellas (haut et bas).
Les mechtas sont détruites et incendiées, certaines maisons sont dynamitées. Le lieu est déclaré zone interdite. La population paie durement sa complicité plus ou moins volontaire avec les rebelles qui ont été hébergés plusieurs nuits durant.»
Grand merci à Bernard de m’avoir rappelé cette embuscade meurtrière. Le souvenir était toujours pénible à évoquer, mais nous le devions bien à la mémoire de ceux qui étaient tombés ce jour là. »
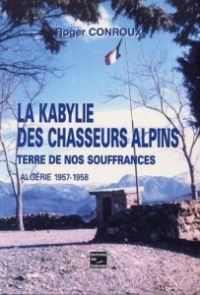 Roger CONROUX
Roger CONROUX
La Kabylie des Chasseurs Alpins,
Terre de nos souffrances
Éditions des Écrivains
Extrait p. 165-166
09:02 | Lien permanent | Commentaires (28) | ![]() Facebook
Facebook
11/11/2009
Les Baisers du Fantôme (Karim AKOUCHE)
À ma mère qui n’a jamais mangé à sa faim et qui, malgré la sécheresse dévorant son sein, ne m’a jamais sevré de son lait aux mille vertus…
Au barde kabyle que les mille balles de l’intolérance n’ont pas pu faire taire…
Au "Maquisard de la chanson" qui "aide le vent de l'Histoire à souffler dans le sens de la liberté de son peuple"...
Aux marcheurs du jour, aux errants de la nuit, aux vagabonds infatigables, aux poètes frustrés, aux êtres sensibles, aux amoureux contrariés, aux malades délaissés, aux enfants abandonnés ; bref, aux combattants de la paix et de l’amour qui avancent sur les sentiers de lumière…
À toutes les femmes frappées de mutisme, aux hommes muselés, aux identités et cultures confisquées…
Et à tous ceux qui n’ont pas voix au chapitre, je dédie modestement ce livre…
Karim Akouche
Début du roman " Les Baisers du Fantôme ":
Je me souviendrai le restant de ma vie de ces mots que tu as murmurés au creux de mon oreille, la veille de notre mariage, dans un sourire plus beau que la lune, tes yeux magnifiques, comme deux agates, éclairés par l’abat-jour : « Yaniv, j’espère que je ne te survivrai pas, que je ne boirai pas après toi, que je n’aurai pas à dormir seule, quand à ma gauche il y aura le gouffre de ton absence, quand me manquera ton corps chaud et protecteur…car je me ferai toute petite dans l’immensité du lit, à peine un bout de femme abandonnée, ne valant même pas le moindre sou ; ou telle une peluche que l’enfant aurait usée jusqu’à la trame et qu’il aurait jetée au fond d’un tiroir après l’avoir remplacée par un autre jouet neuf et plus mignon qu’elle…» Et pourtant ces paroles n’avaient rien d’une plaisanterie, c’était un message prémonitoire que je n’ai pas pu saisir, ni su déceler en elles la brèche d’un quelconque avertissement. Naïvement, je les ai prises pour une plaisanterie de bon goût; d’ailleurs, j’ai rigolé à m’en fendre la bouche jusqu’aux tempes; elles sont entrées par l’oreille droite et sitôt ressorties par celle de gauche. Toute la nuit, nous nous sommes livrés aux jeux innocents de l’amour. Je me suis donné à toi comme jamais auparavant. Je t’ai fait l’amour comme un obsédé, sans me soucier des lendemains qui ne chanteront plus…
 Karim AKOUCHE
Karim AKOUCHE
Les Baisers du Fantôme
Pax in Terris
2008
19:57 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
06/11/2009
JOURNAL DE KABYLIE ( CHARLES SCHWEISGUTH )
RÉSUMÉ DU LIVRE
Avril 1959. Un brillant jeune homme, fraîchement diplômé de l'école militaire de Saint-Maixent et appelé à devenir haut fonctionnaire, débarque en Algérie pour y achever son service militaire. Il écrit chaque jour à sa fiancée. Ces lettres, conservées par celle-ci, constituent un document sur la guerre d'Algérie.
MORCEAUX CHOISIS
La première phrase :
En avril 1959, après six mois passés à l'école militaire interarmes de Saint-Maixent, j'arrive en Algérie pour y accomplir la suite de mon service militaire.
LES EXTRAITS de "Journal de Kabylie"
Alger - Lundi 6 avril 1959
Mon corps roulé à droite, roulé à gauche... Le mouvement du bateau m'expulse du sommeil où je me réfugiais. Il fait noir ; sur une couchette voisine, un bienheureux camarade ronfle à pleins poumons. Mon estomac a refusé le dîner. Quelle heure peut-il bien être ? À quoi ressemble la vie de soldat quand les fusils ne sont pas chargés à blanc ?
Avant même qu'un adoucissement de l'ombre annonce le jour, des voix au loin, joyeuse, signalent les lumières d'Alger.
Peur de me faire voler ou angoisse devant ce qui va venir, je m'absorbe dans mes bagages au lieu de profiter du spectacle de l'entrée dans le port. Sitôt à quai, c'est l'abordage des porteurs arabes, qui en un instant sont maîtres du bateau. Sont-ils voleurs ? Rêvent-ils de nous trancher la gorge ? Sont-ils pour ou contre la France ? Solide, jovial, rapide, un homme s'est emparé de mon bagage ; il ne paraît pas se poser de questions aussi difficiles. Ballotté par le flux des voyageurs qui coursive en escalier me porte vers la passerelle, je crois moins retrouver la terre ferme qu'être embarqué malgré moi pour une incertaine et longue, très longue traversée sur quelque Atlantide à la dérive.
Chapitre : Le Choc de l'inhumain - Page : 23
Sombre fin de semaine ! ! Le fait du jour ne sera pas l'inauguration de la mairie, mais une tragédie. Après l'obus piégé découvert hier à Aguemoun, j'apprenais un vilaine affaire qui risque de coûter cher à l'ami Parot, la disparition ( enlèvement ou désertion ? ) de l'appelé musulman qui était devenu son homme de confiance... Et pour finir, cette embuscade !
Chapitre : Le printemps d'Aguemoun - Page : 268
JOURNAL DE KABYLIE
Éditeur : Privat - 2006
11:23 | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook
Facebook
03/11/2009
Pierre de Villerglé (Amédée ACHARD)
À quelque temps de là, un soir, à la Capucine, où elle s’était établie avec Roger, Louise reçut une lettre timbrée de Constantine.
« Une lettre de Pierre ! » dit-elle en battant des mains.
Elle l’ouvrit à la hâte, et voici ce qu’elle lut :
« Ma chère petite commère,
« Vous doutiez-vous que j’étais en Afrique, à six cents lieues de vous, dans un affreux coin de terre, chez les Kabyles ? C’est une idée qui m’a pris subitement un soir que j’étais au Buisson, quand j’ai poussé ce fameux cri qui vous a tant étonnée. L’idée venue, je suis parti sans vous dire adieu ; j’aurais craint de vous laisser voir tout mon chagrin... Vous étiez si heureuse !
« Qu’aurais-je fait au pays ? Votre présence aurait-elle comblé le vide immense où m’avait jeté votre perte ? Assurément non ! Vous m’aviez désaccoutumé de l’isolement. Fallait-il retourner dans cet hôtel de la rue Miromesnil, où l’ennui a failli m’étouffer ? Qu’avais-je fait pour mériter une si triste fin ? C’est alors que la lecture d’un journal m’a tout à coup rappelé l’Algérie et la vie d’autrefois. J’ai senti comme le souffle de la guerre passer sur mon visage, mon sang a coulé plus vite, et j’ai revu comme dans un rêve, passant avec la rapidité de la foudre, mes vieux chasseurs à cheval, les clairons, les drapeaux, les fanfares et tous ces régiments hâlés qui faisaient ma famille au temps jadis. L’odeur de la poudre venait de me monter à la tête ! Quelques heures après, j’étais au Havre, et le chemin de fer me ramenait à Paris. Le ministre, chez qui je suis tombé comme une bombe, a bien voulu me rendre mes épaulettes. On parlait d’une expédition, et j’ai laissé là mes amis pour courir à mes soldats.
« J’étais à peine débarqué, que l’expédition s’est mise en marche. J’ai senti l’odeur connue des lentisques, j’ai vu les spahis courant comme des chèvres sur les collines ; cette agitation, cette activité, ce premier tumulte du départ, me rappelaient mille souvenirs qui fouettaient mon sang... J’avais la poitrine gonflée. Ah ! quelle joie, chère commère ! Il faisait un temps superbe. Les baïonnettes étincelaient au soleil, et l’on entendait partout le long frémissement des bataillons qui marchent. Avec quels transports n’écoutais-je pas tous ces bruits ! Mon escadron était à l’avant-garde. Dès les premières montagnes, les balles nous ont salués. Mon cheval s’est mis à piaffer... Le clairon a sonné la charge, et nous sommes partis !... Ah ! je ne m’ennuyais plus ! je crois même que je vous ai un peu oubliée, commère.
« Le soir nous avons bivouaqué sur un plateau. Le temps s’est gâté ; et il s’est mis à pleuvoir. Je me suis endormi en regardant l’ombre des sentinelles qui se promenaient le long des feux. Quand je me suis réveillé, j’avais les pieds dans l’eau et la tête sur un caillou... Jamais je n’ai passé de meilleure nuit. Le front me cuisait un peu. Le yatagan d’un Arabe avait coupé le cuir de mon képi. À Paris, je croirais que je suis blessé ; ici, c’est une égratignure. Dominique est avec moi. Rien n’a pu le déterminer à me quitter. Dominique a eu le bras éraflé par une balle.
« Si vous me demandez quand nous nous retrouverons, je n’aurai rien à vous répondre. Que sais-je ? Qu’irais-je faire en Normandie ? Vous revoir ? Eh ! mon Dieu, votre souvenir est trop près de moi pour que j’y joigne encore votre présence ! Vous n’êtes pas malheureuse, n’est-ce pas ? Donc je reste au régiment. Et puis que vous dirai-je ? je me sens bon à quelque chose, utile à mon pays ; cela me relève à mes propres yeux et rachète l’oisiveté ridicule où j’ai vécu trop longtemps. Le marquis de Grisolle, mon oncle, peut me déshériter à présent... je n’ai plus besoin de sa fortune.
« Le soir, au coin du feu, quand vous serez seule, pensez à moi. On ne sait pas ce qui peut arriver. Votre pensée me rendra peut-être visite au moment où je dirai adieu à tout ce que j’aime ici-bas, et tout, c’est vous. Il me semble que je sentirai cette pensée s’arrêter sur moi, et mon dernier souffle vous en remerciera.
« N’allez pas croire au moins que je sois malade : c’est la mort d’un camarade qui vient de rendre l’âme qui m’a fait écrire ces quatre lignes. Le pauvre garçon arrivait de France ; une balle l’a jeté par terre ce matin. Quant à moi, commère, je me porte comme un chêne ; n’ayez donc pas peur.
« Adieu, chère Louise ; votre vieux compère vous embrasse et envoie une poignée de main à Roger. Je retiens votre premier enfant ; je veux être son parrain. Tâchez que ce soit un garçon, nous l’appellerons Pierre, et j’en ferai un capitaine. »
La lettre finie, Louise s’essuya les yeux et posa sa tête sur l’épaule de Roger. « Que Dieu le protège ! c’est lui qui nous a faits ce que nous sommes », dit-elle.
 Amédée Achard
Amédée Achard
Madame Rose
suivi de
Pierre de Villerglé
Nouvelles
Hachette et Cie, Paris, 1858.
Deuxième édition.
11:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook