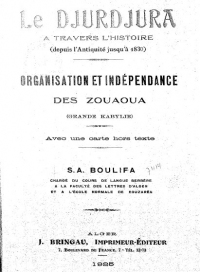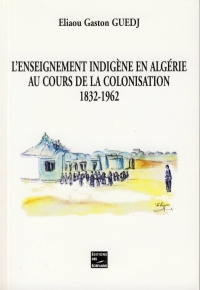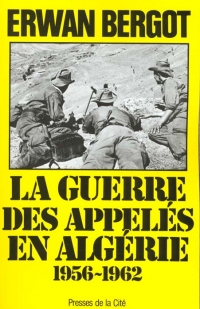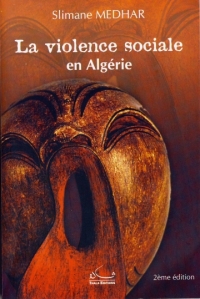04/05/2010
Pauvreté en Kabylie (Gustave GUILLAUMET)
Elle ( une potière de Taourirt ) reste avec l’aïeule en cheveux gris, qui frotte, à l’aide d’un silex arrondi, quelque potiche crue pour en aplanir les rugosités, et avec un nourrisson dormant dans les plis de son haïk. L’enfant ne laisse à l’air que sa petite bouche ouverte. Si peu qu’on en voie, il n’est pas douteux qu’il soit un garçon, la plaque en argent ouvragé de turquoises que la mère porte au front apprend à tous qu’elle a mis au monde un futur défenseur de la patrie.
En peignant son vase, elle fredonne un air mélancolique dans le goût des berceuses bretonnes. La vieille, cessant le travail, s’est levée et, courbée sur un creux du terrain où trois cailloux noircis font office de chenets, elle allume le feu du souper. Installant ensuite un chaudron plein d’eau, elle y plonge, à mesure qu’elle les coupe, des morceaux de courge et de piments, puis elle regagne sa place, perdue sous la fumée qui lèche les murs, s’amasse sous le toit et cherche la porte, n’ayant d’autre issue pour s’échapper.
Pas un lit, pas un escabeau, dans le pauvre réduit. Tous ces gens couchent par terre sur de mauvaises couvertures et respirent jour et nuit les fumiers de l’étable en contrebas où piétinent les bestiaux. Ceux-ci, séparés du logis par un cloisonnage en pierre, ont la faculté d’avancer familièrement leur tête à travers des soupiraux ménagés au ras du sol ; ils se rappellent ainsi d’eux-mêmes aux soins des ménagères, qui passent les aliments dans leur mangeoire par ces ouvertures.
À défaut de meubles, de froids divans en maçonnerie faisant corps avec la muraille sont occupés par les potiches, les unes entièrement peinturées, d’autres couvertes d’un premier enduit ; et de grandes jarres à ventre énorme montent au plafond, greniers aux provisions de farine, d’olives, de figues sèches, qui ne sont pas pleins tous les jours.
Les plus pauvres de nos paysans peuvent passer pour riches en comparaison de ces Kabyles. Mais la djemmâ prend soin des malheureux. Elle recueille des cotisations, des vivres, qu’elle leur partage de temps en temps. Je me heurte, chemin faisant, contre un boeuf égorgé. Deux hommes en découpent la chair et la distribuent à toute la marmaille du pays, filles et garçons de tous âges, touchante façon d’assister la mère par les mains de l’enfant. Il est difficile d’imaginer assemblage plus varié de haillons, jouant là toutes les gammes de la saleté pittoresque. Chacun attend une portion de viande fraîche, mais c’est à qui devancera son tour pour l’obtenir. Et les petits pieds nus se pressent dans un ruisseau de sang, tout autour de l’animal dont ils culbutent la tête détachée du corps et les entrailles encore tièdes, qui encombrent l’étroit sentier. Malgré le côté barbare de cette boucherie, comment ne pas s’égayer de l’imperturbable sérieux des marmots à peine sevrés, lorsqu’ils retournent chez les mamans en tenant devant eux, avec une extrême précaution, quelque bribe sanglante enfilée au bout d’un bâton.
Le lieu où se passe cette scène curieuse domine un massif de rochers sauvages à demi couvert par de sombres bouquets de verdure et dont les blocs s’échelonnent jusqu’au fond d’un ravin où noyers, frênes, figuiers, amandiers, oliviers, enlacés de vignes grimpantes, mêlent délicieusement leurs ombrages. Le bruit d’une source ne tarde pas à charmer l’oreille. Je m’enfonce dans ce paisible endroit, mais quel n’est pas mon étonnement quand, au lieu de la solitude que je croyais y rencontrer, je me trouve en face d’un spectacle fort animé qui m’arrête brusquement. Avancerai-je davantage ? La loi du pays me le défend presque. Une amende frappe le Kabyle qui paraît au lavoir des femmes.
Mais je suis étranger, …
Tableaux algériens
Plon ; Paris ; 1885
Extrait du chapitre :
TAOURIRT-EL-MOKRANE
09:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
30/04/2010
Le Djurdjura à travers l’histoire (BOULIFA Si Amar)
Le 8 octobre 1817, le dey contre lequel se tramait ce complot de haine et de vengeance se vit tout à coup cerné par ses ennemis et étranglé à son tour, dans son propre palais. Son protégé et ami Tchaker, le bey de Constantine, qui, souvent sans raison, avait fait couler aussi tant de sang, ne tarda pas, trois mois après, à subir le même sort. La nouvelle de sa mort, de la disparition d’un gouverneur aussi vulgaire que sanguinaire fut un soulagement pour toute la province de l’est. Ces deux exemples étaient un terrible avis pour les tyrans qui oubliaient que la Justice et le Droit étaient seuls durables.
Mais la suppression d’un tyran ne débarrassait pas le peuple opprimé d’un régime aussi exécrable, comme de même, l’ablation d’un membre ne guérissait un corps corrompu ; le peuple algérien ne pouvait espérer quelque amélioration à son état malheureux que par un changement radical dans la forme de son gouvernement. En attendant, les despotes qui payaient de leur tête les tyrannies qu’ils exerçaient sur le peuple, n’empêchaient pas les calamités de s’abattre sur les malheureuses populations, qui, réduites au désespoir, se livraient à toutes sortes d’excès. Ces crises de rage et de folie, la ruine et la désolation, ne faisaient qu’aggraver la situation générale de la Régence d’Alger. Le meurtre du dey Omar eut lieu à la suite d’une effervescence de la population algéroise effrayée par la réapparition de la peste. Le nommé Ali-Khoudja, principal instigateur du précédent complot à la suite duquel il s’empara du pouvoir, pensa, après ce coup de force, aux moyens de donner à sa personne toute la sécurité voulue. Comme il savait par expérience que la tête du dey était toujours l’enjeu des crises chroniques provoquées par les caprices des Janissaires et des Raïes, il chercha, dès lors en prenant les rênes du pouvoir, à se dégager de l’étreinte directe et brutale que la soldatesque exerçait sur la personne du Dey. Pour plus de sécurité et d’indépendance, il alla donc s’installer avec ses bureaux à la Kasba ; suivant l’exemple de certains deys, une garde d’honneur composée de 2 000 Zouaoua fut chargée de veiller aussi bien sur sa personne qu’à l’exécution stricte de ses décisions. Avec l’aide des Kabyles et des Kourour’lis, il fit annoncer aux Yoldachs son intention bien arrêtée de faire respecter la loi, de les soumettre, eux les premiers, à une obéissance absolue, au respect dû à la majesté du trône. Après cette proclamation faite par l’intermédiaire de ses chaouchs soutenus par les 2 000 Zouaoua, tous les partisans ou amateurs du désordre furent, sans tarder, éloignés ou exécutés ; pour assainir la situation morale du pays, il permit aux autres Turcs mécontents de sa sévérité de rentrer en Orient. Continuant son œuvre de purification et de moralisation, il fit chasser des casernes toutes les femmes non mariées ; les tavernes et autres lieux de mauvaises mœurs furent fermés sur son ordre. Mais si ces saines mesures furent joyeusement accueillies par toute la population honnête de la ville d’Alger, l’élément agitateur avec sa lie fut mécontent ; et les Zebentotes, soldats célibataires, habitués à la débauche et aux vices de la vie de garnison, furent les premiers à se révolter contre ces saines réformes.
Une tentative d’insurrection de la part des Yoldachs soutenus par le ramassis de la populace fut vigoureusement réprimée et dans cette juste répression les soldats kabyles chargés du coup de balai y donnèrent, de bon coeur. Chassés d’Alger, la plupart des perturbateurs expulsés ne trouvèrent rien de mieux que d’aller se joindre aux troupes envoyées en expédition dans l’intérieur pour les inciter à se soulever contre l’autorité du Dey.
Bientôt ces agitateurs entraînant, tous les mécontents et la colonne de l’est mutinée, se dirigèrent en force et menaçants contre la capitale. Le 29 novembre 1817, ils se présentèrent en ennemis sous les murs de la ville ; mais lorsqu’ils apprirent que la force de la garnison qui défendait celle-ci, était assez sérieuse, les chefs des mutinés, se montrant moins agressifs, essayèrent de parlementer pour se faire ouvrir les portes. Pour toute réponse, le Dey donna l’ordre aux forts d’ouvrir le feu, tandis que l’agha Yah’ia, commandant en chef de la garnison, effectuait une sortie furieuse contre les rebelles ; ceux-ci surpris et débordés furent presque tous massacrés : plus de 1 200 Yoldachs et 150 de leurs chefs restèrent sur le carreau ; là encore, les Zouaoua, chargés de repousser les assaillants, exécutèrent les ordres reçus non sans trop faire sentir la rudesse de leurs coups. Cette leçon fut certes des plus dures pour l’orgueil et l’arrogance des janissaires ; exécrés de tous, leurs adversaires n’eurent pour eux aucune pitié ; ceux qui, échappés du carnage de la bataille, essayèrent par la fuite de sauver leur vie lurent rattrapés, faits prisonniers ou tués.
Le succès de cette affaire qui fut célébré par trois jours de réjouissance permit au dey Ali-Khoudja d’asseoir son autorité en détruisant dans sa source cet élément de désordre et d’immoralité qu’ont toujours été les Yoldachs des côtes barbaresques.
Le Djurdjura à travers l’histoire, depuis l’Antiquité jusqu’à 1830
Organisation et Indépendance des ZOUAOUA
(Grande Kabylie)
J. BRINGAU ; Alger ; 1925
Pages 284 à 287
08:49 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook
Facebook
25/04/2010
Les jardins d’école (Eliaou Gaston GUEDJ)
Comment faire évoluer une société paysanne indigène sans aucune culture professionnelle vers une agriculture aux techniques modernes dans un monde qui se désintéresse totalement de cette activité ?
Le décret du 18 octobre 1892 qui précise et réglemente diverses questions de procédures énonce dans ses articles 20, 25, 27 et 28 les procédures à observer pour les créations d'écoles et dans son article 26 les conditions d'installations.
Cet article précise l'obligation qui est faite au promoteur d'une école d'enseignement indigène hors des villes de dégager un terrain attenant à l'école afin d'en faire un jardin d'école.
Il appartient dès lors à l'instituteur d'aménager avec les moyens du bord le terrain jouxtant l'école et d'y enseigner les premiers rudiments du jardinage à ses élèves. La préparation dans les sections spéciales des écoles normales de la Bouzaréa et de Constantine dans ce domaine se révèle efficace.
Le jardin d'école devient dès lors le centre de préparation d'une agriculture sérieuse aux environs immédiats de l'école.
Les colons qui utilisent déjà des méthodes importées d'Europe, soucieux de voir se développer une culture qu'ils ont eu tant de peine à implanter apportent sans hésiter leur concours à l'instituteur dans cette tâche pour laquelle il n'est pas préparé. L'intérêt des colons lors de leurs interventions est double. Tout d'abord le développement de leurs productions nécessitent une main d'œuvre qualifiée. De plus ils sentent l'indispensable nécessité de combler le fossé entre une agriculture coloniale en pleine expansion et une agriculture locale qui perpétue un mode de culture périmé.
Lorsque le jardin d'école est suffisamment important les enfants s'exercent à la culture maraîchère et arboricole. Les élèves qui sortent de l'école à treize ou quatorze ans savent planter, tailler, greffer les arbres fruitiers.
De retour dans leur milieu familial ils s'intéressent alors aux travaux qu'ils ont pratiqués au cours de leur scolarité. Ils sont alors à même de mieux tirer parti de leur jardin ou de leur terre, et sont aptes à devenir de bons ouvriers. Ils deviennent même de bons exploitants agricoles lorsqu'ils sont propriétaires de leurs terres.
Si l'action de l'instituteur dans sa classe se révèle prépondérante pour l'avenir agricole de l'Algérie, son action ne se limitera pas à ses élèves. Elle va s'étendre à toute la population indigène du milieu dans lequel il vit.
Le jardin d'école devient vite un modèle pour les fellahs qui viennent voir et essaient d'imiter leurs enfants. Par leurs enfants ils reçoivent des graines, des plants de légumes, des plants d'arbres. Ils en achètent même sur les indications de l'instituteur.
C'est grâce à cette action des instituteurs qu'ont été plantés dans la région de Fort-National les nombreux cerisiers qui embellissent et enrichissent les jardins de Kabylie.
La section spéciale créée à l'école normale de la Bouzaréa, chargée de préparer à leurs tâches particulières d'enseignement et d'éducation les indigènes d'Algérie accueille depuis 1891 des élèves-maîtres sortis des écoles normales de métropole ainsi que des instituteurs en exercice dans les départements français. Ils sont préparés à cette tâche particulière du développement des jardins d'école.
Si les instituteurs de la première heure ont été des pionniers, les nouveaux arrivants sortis de la Bouzaréa suivent leurs traces.
Si l'action de l'instituteur dans sa classe a été prépondérante pour le développement agricole des propriétés indigènes, son action ne va pas se limiter à ses seuls élèves. Elle va s'étendre à toute la population indigène vivant aux alentours de l'école.
L’enseignement indigène en Algérie
au cours de la colonisation
1832-1962
Éditions des Écrivains
Paris
2000
Pages 99-101
08:37 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
19/04/2010
LE DOUAR D’IMERIGUENE (ERWAN BERGOT)
IMERIGUENE (KABYLIE)
Décembre 1957.
La quille viendra, les bleus resteront
Pour laver les gamelles...
Hurlant leur refrain, brandissant des quilles de bois sculpté avec un soin maniaque depuis plusieurs semaines, les libérables sont entassés dans le G.M.C. garé au milieu de la cour du poste, sous l'oeil mi-envieux, mi-amical de leurs camarades, plus jeunes, qui assurent la relève. À leurs pieds s'entassent leurs paquetages et cette valise en carton à laquelle ils se cramponnaient, voici déjà deux ans, au moment de leur incorporation. Ils sont gais, de cette gaieté un peu forcée née, de l'alcool et de la surexcitation, et qu'il faut entretenir vaille que vaille si on ne veut pas qu'elle s'estompe. Pour la plupart d'entre eux, au-delà de la légitime satisfaction d'en avoir enfin terminé avec ce service militaire, avec l'Algérie, avec le poste-même, se profile déjà l'inquiétude du lendemain, de la vie civile.
Alors, ils chantent, ils braillent, le visage congestionné, le calot en bataille, créant eux-mêmes la dynamique de ce tumulte.
À l'avant, encore accroché par la main à la portière du camion, le sergent Rozic adresse un salut au sous-lieutenant Keller. Voici près d'un an qu'ils vivent ensemble, perdus tous deux dans ce poste d'Imériguène, bâti à la sueur de leur front sur la petite croupe qui jouxte le village. Pendant une année entière, le poste a été leur fief, leur maison, leur refuge. Rozic en connaissait toutes les pierres, tous les recoins, tous les défauts aussi. Rien qu'à une certaine densité du vent il pouvait, de nuit et les yeux fermés, dire dans quelle partie de la cour il se trouvait.
Comme il l'a haï, certains soirs de cafard où la pluie désespérante crépitait sur les tuiles mal jointes ! Comme il l'a aimé aussi, au retour d'une patrouille épuisante lorsqu'il apparaissait, quadrilatère grisâtre, au détour de la piste !
– Ecrivez-moi, lui demande le sous-lieutenant Keller.
– Comptez sur moi, mon lieutenant. Je ne vous oublierai pas.
Le G.M.C. démarre, lentement, salué d'un formidable « hourrah ». Les quilles s'agitent au-dessus des têtes, les bleus présentent les armes, d'une manière comique, en prenant des poses provocantes, cachant mal leur jalousie.
Le porche est franchi. Avant d'aborder le premier virage de la piste boueuse qui plonge vers la route, en bas du village, Rozic fait arrêter le camion. Sur le bord du chemin, quatre silhouettes en blanc sont alignées, bâton à la main, burnous sur le dos. Ce matin, les autorités d'Imériguène ont sorti leurs habits de cérémonie.
Rozic descend en voltige, avance vers les quatre hommes, rangés par ordre d'importance, d'abord, Si Hadj Bouterfaya, le chef du village, sa barbe soigneusement peignée, son chèche de notable noué avec soin, puis Sefta, à la fois cadi et instituteur coranique, Bouazza, le garde champêtre et, sa médaille militaire agrafée avec du fil de fer sur sa gandoura effrangée, Hamzaoui, le président des Anciens Combattants du village. Ils saluent tous les quatre, en portant la main à leur front et Rozic leur rend la politesse. Derrière, dans le camion, les libérables se sont tus, pour un instant, peut-être impressionnés par la démarche des Kabyles.
- Puisse Allah vous accompagner tous durant votre voyage, dit Bouterfaya, la voix rauque.
- Puisse Allah maintenir sa protection sur Imériguène, répond Rozic.
- Pourquoi ti-t'en vas ? interroge brusquement Hamzaoui en attrapant le sergent par sa manche. Tu sais bien que la guerre continue...
S'il y a un reproche dans le propos, il est discret, il est fondé aussi, Rozic le sait bien. Au temps où le caporal Hamzaoui Boubakeur servait au 1er régiment de tirailleurs, on ne rentrait à la maison que lorsque la guerre était gagnée.
- D'autres soldats sont là, répond-il. Imériguène n'a rien à craindre.
Il s'éloigne, avec brusquement l'impression désagréable de fuir. Cette ultime démarche, qui, d'un seul coup, lui a fait mesurer l'étendue de son attachement à cette terre, a balayé sa joie du départ. Il se penche par la portière tandis que le G.M.C. s'éloigne, et grave dans ses yeux la dernière image qu'il désire emporter, quatre silhouettes blanches et immobiles, plaquées sur le fond ocre du village, avec, dérisoire contre la montagne, le petit poste où il a vécu un an de sa vie.
Puis, d'un seul coup, tout perd de sa signification émotionnelle. La montagne n'est plus qu'un tas de rochers sur lesquels s'acharne la pluie, le village reprend cette aura de crasse et d'abandon qu'il lui avait trouvée à son arrivée et le poste, même le poste, redevient une construction sans art et sans âme, une verrue de parpaings sur une colline qui a la pelade.
- Comment, mais comment ai-je pu vivre dans un endroit pareil, comme un clochard ou comme un naufragé ?
C'est alors seulement que Rozic comprend qu'il est parti. Une page est tournée.
Et voici Palestro ; la petite ville a bien changé en vingt mois, mais pas dans un sens favorable.
…
LA GUERRE DES APPELÉS EN ALGÉRIE
(1956-1962)
PRESSES DE LA CITÉ
Paris ; 1980
Chapitre XII
08:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
14/04/2010
La violence sociale en Algérie (Slimane MEDHAR)
VIOLENCE DU POUVOIR
Pages 148-150 extraits
De 1965, date du coup d'État, à 1978, date de son ascension au pouvoir, Chadli était membre du Bureau politique et chef d'une région militaire. Il faisait donc partie du Système dont il a pleinement hérité par la suite. …
De 1978 à 1986, date du début de la crise, Chadli n'a fait que poursuivre le programme de son prédécesseur (Boumediene), tout en l'adaptant aux circonstances. …
Jusqu'à la crise financière
En matière de violence, Chadli a parcouru le trajet de son prédécesseur en sens inverse. Il a commencé par exercer une violence symbolique. Après avoir rassuré la Nation quant à sa détermination de parachever l'œuvre de Boumediene, il entreprit trois séries d'actions.
La première série concerna la dimension idéologique du Système. Celle-ci devint prépondérante. Le F.L.N., alors parti unique, prit une importance considérable. Disposé entre la direction politique et la "société civile", il assuma des fonctions de courroie de transmission dans le sens descendant, de filtre et de contrôle dans le sens ascendant. Le Président légiférait le plus souvent par ordonnance. L'Assemblée nationale jouait le rôle de caisse de résonance du pouvoir, les débats parlementaires qui s'y déroulaient consistaient à aplanir les difficultés qui pouvaient empêcher de formuler les directives politiques en termes législatifs.
La seconde série d'actions porta sur la dimension économique du Système. Les entreprises publiques entamèrent une restructuration dès 1982. La plupart de leurs directions centrales devinrent des entreprises disposant de l'autonomie de gestion. Parallèlement, les billets de banque de 500 DA, objet d'un change parallèle devenu inquiétant, furent retirés de la circulation, puis remplacés par des billets de 200 DA. Enfin, les pouvoirs publics décidèrent de mettre en vente les biens immobiliers (villas, appartements) qu'ils géraient depuis l'indépendance.
Conjuguant la violence physique et symbolique, la troisième série d'actions a eu pour objet la "société civile". Brutalement enclenchée, une campagne d'assainissement (1979) eut pour théâtre la capitale et devait s'étendre aux autres villes du pays. Tizi-Ouzou connut, en 1980, une intervention musclée ayant consisté à étouffer l'émergence du soubassement sociologique sous sa forme berbère, et dont la réhabilitation interviendra 15 ans plus tard. Quatre autres mesures devait faire oublier cette première épreuve et atténuer le mécontentement social : le programme anti-pénuries, la suppression de l'autorisation de sortie à l'étranger, l'augmentation de l'allocation touristique en devises, l'attribution de médailles aux militants de la période 1954-62 et la réhabilitation de certains d'entre eux à l'occasion du 30' anniversaire de la Révolution. Enfin, Constantine connut une épreuve brutale à la suite d'un soulèvement populaire en 1986.
Hormis les affaires kabyles et constantinoises qui, au moment où elles ont eu lieu, n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune critique d'envergure en dehors des régions concernées, les mesures relatives à la seconde et troisième séries d'actions furent en elles-mêmes positives et appréhendées comme telles lorsqu'elles ont été prises. Mais leur caractère positif n'a pas dépassé le stade politique. Leur réalisation fut un échec et c'est ce qui fut reproché à Chadli. Or cet échec était d'ordre technique. Les modalités d'application ont été inefficaces, révélant une rupture entre les décisions politiques et les concrétisations techniques, celles-ci ne pouvant devenir effectives sans la transformation de nombreuses dimensions sociales. Mais personne n'envisageait de transformer quoi que ce soit dans la société. Par conséquent, aucune critique ultérieure n'en signala l'omission. Tout dépendait du chef et de son charisme. Et Chadli, au même titre que ses prédécesseurs, ne s'en est pas privé, traitant à différentes occasions de tout, y compris des types d'organisation et des modalités de gestion devant assurer le succès des orientations politiques et des décisions économiques.
…
La violence sociale en Algérie
Thala Éditions
Alger 2009
2ème édition
08:54 | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook
Facebook