09/07/2007
La mort de Belkacem AMROUCHE (Fadhma Aïth Mansour)
Il faut savoir que toute ma vie j'ai tremblé pour lui, car il était sujet à des syncopes; sans raison apparente, il lui arrivait de se trouver mal - plusieurs fois à son bureau, un jour chez le dentiste - et il me racontait la chose à son retour à la maison. Je l’attendais devant la porte, quand il était en retard. En entrant, il me disait «On ne te changera jamais» Et j'étais si contente de le voir rentré, que je ne répondais rien.
Parfois, la nuit, lorsque je me réveillais, je rappelais si je ne l’entendais pas respirer «Amrar (1)! » Dès qu'il m'avait répondu, je me rendormais tranquille.
Même le matin quand il allait à la messe, j'étais angoissée jusqu'à son retour. À cette époque, dans le village chrétien, il n'y avait que le postier et sa femme, sa mère. Hubert et sa mère, Marie-Rose, ainsi que deux familles musulmanes qui avaient loué les maisons vides de Blanche et de Marie G'âmara. C'est dire combien l’ambiance était sinistre! Toute la nuit nous tremblions dès que nous entendions un bruit. Malgré la serrure et les verrous, nous avions peur de tout et de l’inconnu.
Le 3 janvier (1959), c'était un samedi. Le soir, mon mari avait achevé la lecture de son journal devant le poêle, à la lueur de la petite lampe à pétrole, car on avait abattu les poteaux électriques. Toute la journée, il avait été dehors, chez les marchands du village, chez Hubert. Au moment du couvre-feu, il était venu m'embrasser pour me dire bonsoir, et il se mit au lit en me disant « Je vais vite m'endormir. »
Il s'était soigneusement rasé pour se rendre à la première messe, et il s'était endormi.
Au bout de deux heures, je l’entendis se lever et me dire :
- « J'étouffe! J'étouffe! » Je lui répondis « Sors prendre l'air sur le balcon. » Je l'entendis encore dire : « J'étouffe! »
Il alla du côté de l’escalier, aux cabinets; je l'entendis encore, puis, plus rien... Et je m'inquiétai. Je me levai en chemise et pieds nus pour savoir la raison de ce silence. Je le trouvai assis sur le siège. Je criai - « Amrar! Amrar! »
Pas de réponse. Je le tirai par les mains et essayai de le soulever, mais il était trop lourd. Je le lâchai et courus à la fenêtre de la cuisine en appelant René Zahoual.
« René, viens vite! M. Amrouche se trouve mal, j'ai peur ! »
René fit le tour et j'allai lui ouvrir la porte de la rue. Il prit mon mari dans ses bras et le coucha dans son lit.
- « Faut-il aller chercher le docteur militaire? »
Mais il avait senti que le coeur avait cessé de battre. Il appela sa mère qui me tint compagnie. Pendant la nuit je me levai plusieurs fois pour voir s'il avait froid, et je tirai sur lui les couvertures, mais il n'avait plus besoin de rien.
Au matin, je réussis à m'endormir. Le bruit s'était déjà répandu dans le village. Les Sœurs, au sortir de la messe, s’étaient arrêtées; elles avaient apporté de l'eau bénite et lui avaient passé son chapelet autour des mains. Pour moi, j’étais abrutie, je ne comprenais rien. Je vis la maison se remplir des parents du haut village : il y avait parmi eux le fils du cousin Messaoud, qui voulut s'installer chez nous.
Hubert avait chargé l'armée de télégraphier aux enfants de Paris, pour qu'ils viennent assister aux obsèques(2) , mais personne n'ayant répondu, le Père Etienne vint me dire qu'il fallait procéder à l'enterrement sans eux.
C'est le lundi soir que mon compagnon de soixante années me quitta pour toujours. Pendant deux jours et deux nuits, ce fut un défilé de parents qui ne voulurent pas me laisser seule, mais qui parlaient de leurs affaires personnelles. Je compris que le fils de Messaoud entendait habiter ma maison, et cela ne me convenait pas. J'allai chez Marie-Rose, la mère d'Hubert, et lui demandai asile en attendant des nouvelles de France. Elle accepta. Je fis porter chez elle un petit lit, des couvertures, je donnai aux Sœurs toutes les provisions que le Papa avait amassées en ces temps de restrictions. Je vécus chez Marie-Rose du 6 janvier au 6 février, date à laquelle je partis pour la France en compagnie de Mère Louis de Carthage. C'est elle qui ouvrit le tiroir de la commode, qui me remit les papiers de la retraite, et l'argent qu'elle y trouva. Quelques jours avant sa mort, le Papa m'avait dit : « Tu vois cet argent ? prends-en soin, c’est ta réserve pour le cas où je viendrais à te manquer. »
1. « Maître » ou « Vieux » ; c'est ainsi que les femmes kabyles s'adressent à leur époux. Le mot comporte à la fois la notion d'âge et celle de respect, associées dans une société patriarcale, comme celle des Berbères.
2. Aucun télégramme ne parvint jamais à Paris. C'est quinze jours après que les enfants Amrouche apprirent, par recoupement, la mort de leur père.
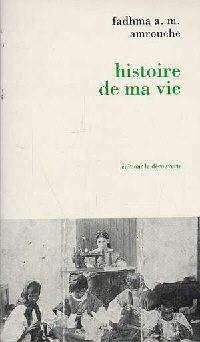
Faddhma Aith Mansour Amrouche
Histoire de ma vie
1ère édition :
François Maspero 1968
Actuellement :
La Découverte/Poche
06:55 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook
Facebook
30/06/2007
Premier voyage en Algérie (Mila YOUNES)
C'est à l'âge de douze ans que je m'étais rendue en Algérie pour la première fois. Mes parents m'avaient souvent parlé de leur pays, de leur souffrance due à la longue période de colonisation. Très jeune, ma mère avait perdu son père et travaillé pour les colons dans les champs. Tout ce qui avait trait à l'Algérie me semblait difficile, des épreuves qui n'en finissaient plus. Je n'avais jamais vu de photos du village, ni de mes grands-parents décédés. J'aurais tant aimé voir leur visage au lieu de celui que je m'étais inventé dans mon esprit. J'avais un besoin de sentir un lien avec ce passé si mystérieux. Quand mes parents me parlaient de mes grands-parents, ils étaient très tristes, mais en même temps, ils avaient cette résignation face au destin, ce fameux «mektoub» contre lequel on ne peut rien. Ils nous rappelaient qu'ils étaient venus s'installer en France, en grande partie pour nous, même si nous n'étions pas encore nés lorsqu'ils avaient quitté l'Algérie. Pourquoi étions-nous tenus responsables de l'absence et de la distance qui avaient séparé mes grands-parents de nos parents ?
Nous partîmes au mois de juillet de l'été 1965. Je craignais un peu ce voyage. J'allais finalement découvrir mon pays, mais il y avait au fond de moi de vieilles craintes d'enfant reliées à la condition des femmes dont j'avais été témoin à maintes reprises. L'aéroport d'Orly était bondé de travailleurs immigrés qui rentraient aussi au pays. Us avaient l'air aussi énervé que moi, mais pas pour les mêmes raisons.
Enfin, nous prîmes le couloir qui allait nous mener à l'avion. J'étais assise à côté de ma jeune soeur et nous nous tenions par la main; c'était notre premier voyage en avion. L'hôtesse annonça le départ. Par le hublot, je voyais la ville disparaître peu à peu. Finalement, nous arrivâmes au-dessus des nuages.
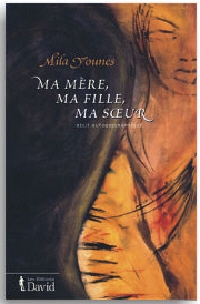
Ma mère, ma fille, ma sœur.
Mila YOUNES
Editeur : DAVID, Ottawa, France
Collection : Voix narratives et oniriques
19:10 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook
Facebook
24/06/2007
91 marches (Jean TENNIERE) : Lisea
Elle (Liséa) continua :
- Nous les Kabyles on n'est pas des arabes. Tu vois, je suis blonde et j'ai la peau blanche. Il y en a même qui ont des yeux bleus chez nous, mais on est Algériens. Mes enfants, ils aiment pas trop l'Algérie, ils disent que c'est un pays merdique mais c'est parce qu'ils connaissent pas. Tout le monde croit que c'est paumé là-bas, qu'on a rien, qu'y a que des intégristes, mais on a tout, c'est riche ! On a des plages privées avec des palmiers, des belles voitures, des hôtels de luxe, qu'est-ce que tu crois... J'ai fait construire là-bas. Bien sûr c'est paumé dans la montagne de grand-mère, mais c'est pas tout le pays. Tu verras si tu viens. Où j'ai fait construire c'est super moderne.
Elle se gratta la main gauche :
- C'est bon signe, c'est de l'argent qui rentre. Quand c'est la droite c'est mauvais signe, ça veut dire que tu vas perdre de l'argent mais là c'est la gauche... Tu veux pas me donner un peu plus ?
J'évitai de répondre et décidai de profiter de cette croyance dans les arts divinatoires et conjuratoires pour me faire mousser :
- Si tu veux, je te fais ton thème astral.
- Tu sais faire ça toi... Menteur ! répondit-elle, intéressée.
- Tu rigoles, évidemment je sais. Il me faut juste ton lieu de naissance et ta date de naissance à la minute près. Je t'ai déjà dit que tu n'en verrais pas deux comme moi.
- Te vante pas trop, j'ai encore rien vu. Tiens, je vais t'écrire la date sur un bout de papier pour que tu ne l'oublies pas.
Elle me tendit le bout de papier. Je fus stupéfait de constater qu'elle avait presque mon âge ! Dire que je lui avais donné à peine trente ans ! Elle avait trouvé que je faisais jeune mais c'était hallucinant comme le temps l'avait épargné !
Alors que je la complimentais en lui avouant combien elle m'avait surpris elle me répondit, dubitative :
- Merci Jean, c'est gentil, Jean ! Mais l'âge est là quand même et je le sens. On est tous les deux plus près de la fin que du début.
- Comment une aussi jolie femme peut-elle être aussi pessimiste... Je te répète que tu es jeune.
 Jean Tennière
Jean Tennière
La Compagnie littéraire-Brédys
Levallois-Perret, France
10:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
14/06/2007
Le chien de Titanic (Ali MALEK)
Les brigades anti-émeutes tentent par moments de charger, mais elles y renoncent devant le trop grand nombre de lanceurs de pierre. Une barricade de pneus en feu sépare les belligérants. Le face-à-face se prolonge le temps de trouver un exutoire au volcan des insurgés : le siège des Recettes et Impôts. Le beau bâtiment, vestige colonial, subira plus de dégâts que n’en auraient causé deux voitures piégées contre lesquelles, au cours des dix dernières années, le gouvernement a pris des dispositions en érigeant des murs en béton armé autour de tous les édifices publics. En investissant le siège des Recettes et Impôts, les gueux déchaînés passent à deux doigts de la fortune : on met la main sur le coffre-fort. Hélas, impossible de l’ouvrir. On ne s’y attarde pas trop. On traîne la masse de fer dehors et on s’en sert pour renforcer la barricade. Après quoi, la foule se rue sur le palais de justice, lui aussi joli bâtiment et legs gaulois. On a trouvé la force d’enfoncer le portail d’acier. D’ailleurs, enfoncer est peu dire : il est littéralement déchiqueté comme s’il avait été mâché par des dents inhumaines avant d’être avalé par un estomac non moins monstrueux. Le premier qui réussit à forcer l’entrée du prétoire est un farceur ; il grimpe sur le siège du juge et proclame, en employant le jargon du magistrat, que la justice ordonne le saccage de son palais : jamais sentence n’a été si promptement exécutée. Bientôt, de la rue, on voit de jeunes têtes apparaître aux fenêtres de l’édifice et balancer en l’air des cartons de dossiers, dans un fracas de rires, comme des élèves, à la veille des vacances, déchirent leurs cahiers en signe de rébellion contre le despotisme des professeurs. Quand il n’y a plus rien à détruire aux deux premiers étages, on monte au troisième, résidence du procureur. Ce dernier, par chance, n’est pas chez lui. La porte défoncée, les assaillants exultent à la vue des beaux meubles à offrir aux flammes de la barricade sous les yeux de gendarmes impuissants. Une voix cependant, à l’ultime seconde, arrête les mains destructrices au cri de :
— Saliha ! Saliha !
Et aussitôt, une idée traverse la meute : donner à cette malheureuse les meubles de Monsieur le Procureur. C’est une petite jeune femme si rabougrie que même un berger ne songerait pas à abuser d’elle. Jour et nuit, elle est dans la rue, son domicile. Récemment, des bonnes âmes lui ont bâti une piécette où elle couche, sur des cartons. Saliha n’a aucun meuble et, pour en obtenir, elle a l’habitude de s’adresser à tous, voyant en chacun, y compris les enfants, l’autorité compétente pour satisfaire sa requête. Elle est en train de dormir, et quand elle ouvre sa porte aux émeutiers, chargés comme des mulets, elle verse des larmes de joie. Mais ils n’ont pas fini de déposer le luxueux butin que Saliha se ravise :
— Et si le procureur venait me les reprendre ?
— Ne t’inquiète pas, nous serons toujours là … Sais-tu que Scotto a été blessé ? Il est à l’hôpital.
Elle s’est amourachée de ce garçon un peu borgne, mais au teint clair et aux traits fins, qui lui apportait souvent à manger de chez lui. Saliha se met aussitôt en route pour l’hôpital, avec l’affolement d’une mère. Elle trouve la rue bouleversée comme jamais, et si bondée de monde qu’elle a du mal à se frayer un passage. De toutes parts, on lui adresse qui une salutation, qui une plaisanterie sur le butin qu’elle vient d’acquérir, qui une acclamation, comme si elle était le chef de l’insurrection. Quelqu’un, enfin, lui donne des nouvelles de Scotto. Il n’a pas été blessé par balle, mais a seulement eu la main brûlée par une bombe lacrymogène qu’il tentait de saisir au vol. Saliha n’est toutefois pas rassurée : elle ne comprend pas la différence. Pour elle, la blessure fait naître l’évocation du sang coulant à flots et de l’âme prête à quitter le corps. À l’hôpital, les infirmiers, la voyant arriver, retrouvent soudainement leur humour perdu. Ils ironisent sur la folle passion qui amène Saliha. « Bande d’imbéciles !, s’écrie-t-elle, c’est mon fils ! ».
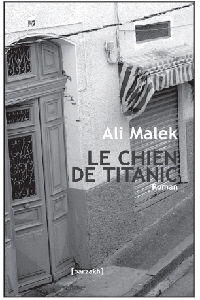
ALi MALEK
Le chien de Titanic
Editions BARZAKH
Alger 2006
08:15 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
05/06/2007
JE SUIS UN KABYLE D'ICI (Mo BOUTALEB)
« ô j'Aime ma Kabylie !
Je l'Aime plus que ma vie,
Mes racines et mon lit,
Où j'y dors quand je prie,
Je l'Aime, c'est important,
D'Aimer ce qu'on ressent,
Comme de croire à un Dieu,
De toute la force des yeux.
ô j'Aime ma Kabylie !
Je l'Aime malgré la pluie,
Qui s'abat chaque jour,
Sur l'âme de sa bravoure,
Une pluie rouge comme le sang,
Versé par de braves gens,
Venus dire leur Amour,
Au pays pour toujours. »
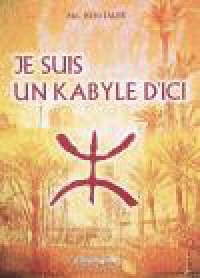
Mô Boutaleb
Genre : Poésie
Editeur : Ed. du Cosmogone,
Lyon, France
08:45 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook
Facebook






